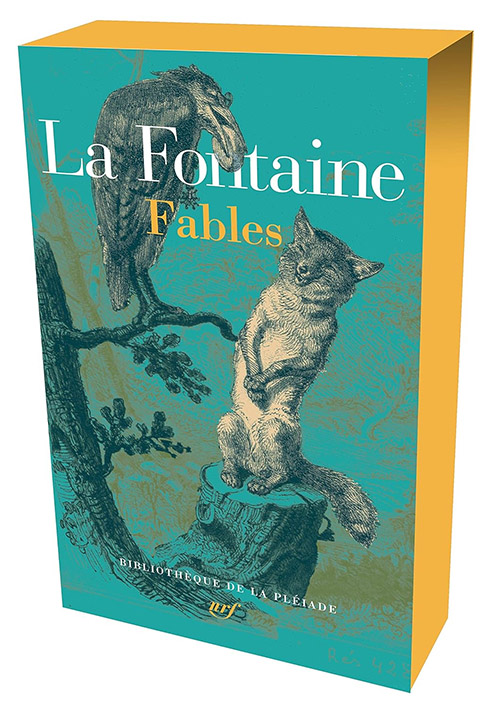Les Aventures de Tom Sawyer
Mark Twain
![]()
Préface
Les aventures que je raconte ne sont pas imaginaires, tant s’en faut. Elles ont été puisées en partie dans mon expérience personnelle, en partie dans celle de mes camarades d’école. Huck Finn est peint d’après nature ; Tom Sawyer aussi, quoiqu’il ne soit pas le portrait d’un seul individu. Trois des compagnons de mon enfance revivent en lui — il appartient donc à ce que les architectes nomment l’ordre composite.
Je n’ai pas non plus inventé les superstitions étranges attribuées à divers de mes personnages. À l’époque où se passe mon récit — c’est-à-dire il y a trente ou quarante ans — des croyances, non moins singulières, étaient répandues chez les enfants et les esclaves des États de l’Ouest.
Bien que ces pages semblent de nature à intéresser surtout la jeunesse, j’ose croire qu’elles amuseront les lecteurs d’un âge plus avancé. Elles rappelleront à ces derniers ce qu’ils ont été, leurs façons d’agir et de s’exprimer, aussi bien que les entreprises où ils s’engageaient au bon temps où l’école buissonnière leur paraissait la meilleure des écoles.
Chapitre I
TOM SAWYER ET LA TANTE POLLY

Tante Polly
— Tom !
Pas de réponse.
— Tom Sawyer !
Pas de réponse.
— Où donc a-t-il pu se cacher ? Ah ça, te montreras-tu, mauvais garnement ?
La vieille dame qui s’exprimait ainsi abaissa ses lunettes et regarda par dessus ; puis elle les releva et regarda par dessous. Il ne lui arrivait jamais de s’en servir autrement pour découvrir un objet aussi peu volumineux que maître Tom. Elle portait ce matin-là ses lunettes des grands jours dont la monture lui inspirait orgueil légitime, mais dont les verres, en dépit de leur transparence, gênaient sa vue presque autant qu’auraient pu le faire deux couvercles de casserole. La propriétaire de cet instrument d’optique d’une utilité contestable demeura un instant perplexe et reprit sans trop de colère, assez haut toutefois pour que les meubles pussent l’entendre :
— Si je mets la main sur toi, je…
Elle n’acheva pas sa phrase. Elle venait de se courber et lançait sous le lit des coups de balai si formidables qu’elle avait besoin de son haleine pour ponctuer chaque effort. Par malheur, elle ne réussit qu’à épouvanter le chat.
— Il me semblait bien l’avoir vu entrer ici, le vaurien, murmura-t-elle.
Déposant le balai dans un coin, elle se dirigea vers le seuil de la porte ouverte d’où elle contempla les couches de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient le jardin. Pas de Tom. Les mains allongées en guise de porte-voix, elle cria de nouveau à plusieurs reprises, de manière à être entendue au loin :
— Holà, Tom !
Au troisième appel, un léger bruit résonna derrière la vieille dame qui se retourna juste à temps pour saisir par le bas de sa jaquette un jeune garçon d’une dizaine d’années, à la mine éveillée, qu’elle arrêta dans sa fuite.
— Ah ! j’aurais dû penser à ce cabinet, s’écria-t-elle. Que faisais-tu là dedans, Tom ?
— Rien.
— Rien ? Regarde ta bouche.
— Je ne peux pas regarder ma bouche.
— Regarde tes mains alors. D’où vient ce barbouillage ?
— Je ne sais pas, ma tante.
— Ah ! vraiment ? En tout cas, tu sais ce que je t’ai promis si tu touchais encore à ces confitures. Avance ici.
Un rotin planait dans l’air. Le péril était imminent.
— Oh ! vois donc derrière toi, ma tante ! Est-ce que ça mord, ces bêtes-là ?
La vieille dame fit aussitôt volte-face, serrant ses jupes afin de parer au danger d’une morsure. Le coupable profita de cette diversion pour opérer sa retraite ; il escalada la clôture en planches qui entourait le jardin et eut bien vite disparu, pendant que sa tante brandissait le rotin inoffensif.
— Toujours la même histoire, pensa la vieille dame. Ne m’a-t-il pas déjà joué assez de tours de ce genre pour que je ne m’y laisse plus prendre ? Seulement il a soin de varier ses tours, de sorte qu’on ne sait jamais ce qui va arriver. Et puis, quand il ne parvient pas à s’échapper, il s’arrange de façon à me faire rire, et alors pas moyen de taper pour de bon. Je ne remplis pas mon devoir, je le sens. Qui aime bien châtie bien, la Bible a raison. Je ne lui rends pas service en le gâtant, pour sûr ; mais c’est le fils de ma pauvre sœur défunte, et le courage me manque trop souvent. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m’adresse des reproches, et chaque fois que je le corrige, mon vieux cœur saigne. Allons, il va encore faire l’école buissonnière cet après-midi, et me voilà forcée de le retenir à la maison demain. C’est dur de l’obliger à travailler un samedi, quand ses camarades ont congé ; mais il déteste le travail plus que toute autre chose, et il faut espérer que la leçon lui profitera. Quel dommage qu’il ne ressemble pas davantage à son jeune frère Sid. En voilà un qui ne me cause aucun tintouin !
Tom fit, en effet, l’école buissonnière et s’amusa beaucoup. Il rentra à peine à temps pour aider Jim, le négrillon, à scier le bois et à fendre les bûches qui devaient chauffer le souper. Du moins, il arriva assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que Jim abattait les trois quarts de la besogne. Sidney, dont on vient d’entendre l’éloge, avait déjà rempli sa part de la tâche et rentré une bonne provision de combustible. C’était un garçon très tranquille, et si les deux orphelins ne se ressemblaient pas, cela tenait sans doute à ce qu’ils n’étaient que demi-frères, Mme veuve Sawyer ayant jugé à propos de se remarier un an après la naissance de Tom.
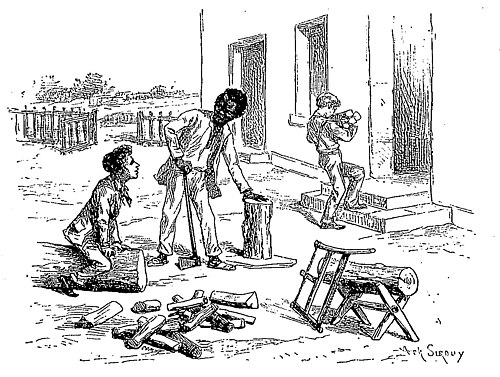
Tom travaille
Pendant que Tom faisait honneur au souper et bourrait ses poches de sucre dès qu’une occasion favorable se présentait, la tante Polly lui adressa une foule de questions insidieuses dont chacune cachait un piège. Comme beaucoup de bonnes âmes naïves, elle se piquait de posséder un talent diplomatique de premier ordre, et ses feintes les plus transparentes lui paraissaient des merveilles d’astuce. Mais il n’était pas facile d’arracher au rusé Tom des aveux compromettants.
— Tom, il a fait chaud à l’école aujourd’hui ? demanda la diplomate.
— Oui, ma tante.
— Très chaud, hein ?
— Pas si chaud qu’hier, ma tante.
— Tu n’as pas eu envie de te baigner, Tom ?
Tom se sentit un peu effrayé. Il consulta le visage de la tante Polly ; mais il n’y lut aucune certitude et se contenta de répondre :
— Je crois bien que j’ai eu envie de me baigner !
La vieille dame allongea la main et tâta la chemise de Tom,
— En tout cas, tu n’as pas trop chaud maintenant.
Et elle se flatta d’avoir découvert, sans que personne se fût douté du but de sa manœuvre, que le linge était parfaitement sec. Tom, qui voyait de quel côté soufflait le vent, se hâta de parer à une nouvelle attaque.
— Il y en a qui se sont amusés à se pomper de l’eau sur la tête. Mes cheveux sont encore un peu humides, sens.
La tante Polly fut vexée de n’avoir pas songé à ce moyen de s’assurer de la vérité. Soudain, elle eut une autre inspiration.
— Tom, tu n’as pas eu besoin de découdre ton col, puisque tu ne t’es mouillé que la tête, hein ? demanda-t-elle.
Le visage de Tom se rasséréna. Il ouvrit sa jaquette. Le col était solidement cousu à la chemise.
— C’est bon, c’est bon. Je me figurais que tu avais fait l’école buissonnière.
Elle était à moitié fâchée que sa sagacité eût été en défaut et à moitié satisfaite que Tom, une fois par hasard, n’eût mérité aucun reproche. Sidney vint tout gâter.
— Tiens, dit-il, je croyais que ce matin tu avais cousu son col avec du fil blanc, et ce soir le fil est noir.
— Mais oui, je l’ai cousu avec du fil blanc… Tom !
Tom n’attendit pas le reste ; il gagna la porte en criant :
— Sid, tu me payeras ça !
Dès qu’il se vit à l’abri de toute poursuite, notre héros s’arrêta pour examiner deux aiguilles piquées dans le revers de sa jaquette et garnies, l’une de fil noir, l’autre de fil blanc,
— Elle n’y aurait vu que du feu sans Sid, dit-il ; elle se sert tantôt de fil blanc, tantôt de fil noir, de sorte que je m’y perds. N’importe, Sid recevra une raclée qu’il n’aura pas volée.
Ce n’était pas un écolier modèle que Tom. Il ne s’enorgueillissait même pas d’avoir pour frère le modèle du village ; au lieu de le prendre pour exemple, il l’exécrait. Au bout de quelques minutes, il finit par oublier ses peines, non qu’elles fussent moins lourdes ou moins amères que celles d’un homme ; mais, en ce moment, un intérêt puissant lui permettait de les chasser de son esprit. Un nègre lui avait appris le matin même une nouvelle façon de siffler, et il tenait à étudier en secret la méthode avant d’émerveiller le public. Il s’agissait d’imiter certaine roulade d’oiseau, une sorte de gazouillement liquide qui se produit en touchant le palais avec la langue à de légers intervalles. Notre artiste, à force de s’exercer, fut bientôt à même de rivaliser avec son professeur. S’avançant le long des sentiers solitaires, les mains dans les poches, la bouche pleine d’harmonie, l’âme pleine de reconnaissance, il ressentait la joie que doit éprouver un astronome qui vient de découvrir une planète.
On était en été, et il ne faisait pas encore nuit. Soudain, Tom cessa de gazouiller. Un étranger, d’une taille un peu plus élevée que la sienne, se trouvait en face de lui. Or, dans la petite ville de Saint-Pétersbourg, la présence d’un visage nouveau, qu’il fût jeune ou ridé, causait une profonde sensation. D’ailleurs, ce garçon était bien vêtu, bien vêtu un jour de semaine ! Certes, on se serait étonné à moins. Coiffé d’une mignonne casquette, il se pavanait dans une jaquette de drap bleu qui lui serrait la taille et ne laissait voir aucune trace de déchirure ancienne ou moderne. Son pantalon n’était ni trop long ni trop court. Il portait des souliers, bien que ce ne fût pas dimanche. Il avait même une cravate, un brillant bout de ruban qui lui entourait le cou. Bref, sa mise de citadin excita l’envie de Tom qui, pour la première fois de sa vie peut-être, rougit de sa tenue débraillée. Les deux promeneurs se rapprochèrent, s’arrêtèrent à quelques pas de distance sans échanger une parole, puis se mirent à tourner l’un autour de l’autre en se tenant toujours face à face. Enfin Tom dit :
— Tu es plus grand que moi, mais je te rosserais si je voulais.

Essaye un peu
— Essaye un peu, répondit l’autre.
— Ça ne serait pas difficile.
— Seulement tu n’oses pas essayer.
— Tu crois ?
— J’en suis sûr.
Il y eut un moment de silence qui fut interrompu par Tom.
— On voit bien que tu ne connais pas Tom Sawyer. Comment t’appelles-tu, toi ?
— Ça ne te regarde pas.
— Si tu dis un mot, tu auras affaire à moi.
— Un mot, un mot, un mot !
— Tu te crois bien malin, n’est-ce pas ?… Capon !
— Capon toi-même.
— Je n’ai pas peur de toi.
— Si !
— Non !
L’entretien fut de nouveau interrompu. Les deux antagonistes continuèrent à se mesurer du regard et à se rapprocher obliquement ; bientôt leurs épaules se touchèrent. — Ne pousse pas ! s’écria Tom.
— Ne pousse pas toi-même.
En dépit de cette recommandation, ils demeurèrent arc-boutés sur un pied, se poussant de toute leur force sans que l’un ou l’autre parvînt à faire reculer son adversaire. Après avoir lutté jusqu’à ce que leurs visages eussent passé du rouge au cramoisi, ils se relâchèrent de leurs efforts avec une prudente lenteur, de façon à ne pas donner un avantage à l’ennemi. Alors Tom traça une ligne sur le sol avec son orteil et dit :

Crie assez !
— Dépasse seulement cette ligne et je t’étrillerai jusqu’à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Celui qui ne répond pas à ce défi volerait un mouton !
La provocation était trop forte ; l’autre franchit aussitôt la ligne.
— Là ! répliqua-t-il. Tu as menacé de m’étriller, étrille-moi donc !
— Pour deux sous, je le ferais.
Le jeune étranger tira de sa poche une pièce de monnaie et l’offrit poliment à Tom qui la fit sauter en l’air.
Un instant après les deux gamins roulaient sur le sentier, se tirant par les cheveux, se déchirant les vêtements, s’égratignant le visage et se bourrant de coups de poing. Bref, ils se couvrirent de poussière et de gloire. Le combat ne dura que quelques minutes. Bientôt le nuage se dissipa, et Tom apparut à cheval sur son adversaire renversé qu’il n’épargnait pas.
— Crie assez, quand tu n’en voudras plus ! L’autre cherchait toujours à se dégager et pleurait de rage.
— Crie assez !
Et les coups de poing continuèrent à pleuvoir.
Enfin le vaincu laissa échapper d’une voix étouffée un « assez » qui annonçait qu’il reconnaissait sa défaite, et Tom l’aida à se relever.
— Je ne t’en veux pas, dit-il avec une générosité dont on ne lui tint aucun compte. Seulement, une autre fois, tâche de savoir à qui tu as affaire avant de te moquer du monde, mon bonhomme.
Le bonhomme ne s’engagea nullement à profiter du conseil. Il s’éloigna sans avoir ouvert la bouche, secouant la poussière dont il était couvert, se frottant les côtes et se retournant de temps à autre. Arrivé à une certaine distance, il s’arrêta et menaça de prendre sa revanche à la prochaine rencontre. Tom répondit par des railleries peu chevaleresques et s’éloigna de son côté, enchanté de sa victoire. Dès qu’il eut tourné le dos, sa victime ramassa une pierre, la lança avec tant d’adresse qu’elle frappa Tom entre les épaules, puis s’enfuit à toutes jambes. Tom poursuivit en vain le traître, qui put se réfugier chez lui avant d’avoir été rejoint. Notre héros eut beau monter la garde devant la maison où son agresseur avait trouvé un abri et défier l’ennemi de sortir, l’ennemi, le visage contre une vitre, se contenta de lui faire des grimaces. Enfin, la mère de l’ennemi se montra et accabla Tom de tant d’épithètes malsonnantes qu’il se décida à lever le siège, quelque envie qu’il eût de se venger.
Il rentra assez tard ce soir-là, et bien qu’il prît la précaution de passer par la fenêtre, il tomba dans une embuscade. Quand la tante Polly vit dans quel état se trouvait les vêtements et le visage de son neveu, elle résolut de le priver de congé le lendemain.
Chapitre II
UN BADIGEONNAGE AUX ENCHÈRES
Nous voici au samedi matin. Une magnifique journée d’été où la terre elle-même semble se réjouir. Il y a une chanson dans tous les cœurs, et si le cœur est jeune, la chanson monte aux lèvres. On dirait que chaque visage reflète un rayon de soleil ; on se sent comme des ailes aux pieds. Les caroubiers sont en fleur, et leur doux parfum remplit l’air.
Tom sort du domaine de la tante Polly avec un baquet rempli de blanc de chaux et une brosse fixée au bout d’un long manche. Arrivé sur la chaussée, il contemple la clôture qui entoure le jardin. La nature n’a plus de charmes pour lui. Son visage s’allonge. Trente mètres de planches qui s’élèvent à une hauteur de neuf pieds ! La vie lui paraît amère et l’existence un lourd fardeau. C’est en soupirant qu’il trempe sa brosse dans le baquet. Il la passe le long de la planche la plus élevée, répète à deux reprises l’opération, compare l’étroite raie tracée par sa brosse au vaste espace qu’il s’agit de blanchir, s’assoit par terre et s’abandonne à un profond découragement. Au même instant, un négrillon sort par la porte du jardin, un seau vide à la main. Il arrive en sautillant et chante à tue-tête les Filles de Buffalo.
Tom n’aimait pas à aller puiser de l’eau. C’était une corvée qu’il laissait volontiers à Jim. Mais il se rappela que le matin surtout il y avait beaucoup de monde autour du puits. En attendant leur tour, ses camarades causaient, jouaient aux billes, se battaient ou échangeaient des jouets. Il se souvint aussi que, bien que le puits ne fût pas à plus de cinquante mètres de distance, Jim ne reparaissait guère qu’au bout d’une heure avec son seau. Encore était-on presque toujours obligé d’aller le chercher.
— Comment tu vas encore là-bas, mon pauvre Jim ? Tu dois être fatigué, hein ? J’irai à ta place, si tu veux donner un coup de badigeon.
Jim secoua la tête.
— Pas moyen, massa Tom, répliqua-t-il. Maîtresse ne veut pas que je m’amuse en route. Si massa Tom me demande de badigeonner, faut pas que je l’écoute, car elle garde l’œil ouvert, et gare à moi !
— Bah, Jim, elle parle toujours comme ça. Passe-moi le seau. Je serai revenu dans dix minutes ; elle n’y verra que du feu.
— Non, j’ose pas, massa Tom. Elle m’arracherait la tête, vrai ! Elle l’a dit.
— Elle ! Elle ne tape jamais pour de bon, tu le sais bien. Un coup de dé sur la caboche tout au plus. Qui fait attention à un coup de dé ? Tiens, je te donnerai cette bille.
Jim commençait à hésiter.
— Une belle bille en stuc, Jim. Elle vaut mieux qu’une agate.
— Oui, très belle, massa Tom ; seulement j’ai peur d’être battu.
Mais la tentation aussi était trop forte. Jim posa le seau à terre et prit la bille. Une minute plus tard, il descendait la rue au triple galop, l’épaule endolorie, un seau à la main ; Tom badigeonnait avec énergie, et la tante Polly se retirait avec une pantoufle qu’elle venait de ramasser.
L’énergie de Tom ne dura pas. Il songeait aux projets qu’il avait formés pour la journée qui débutait si mal. Bientôt ses camarades, libres après la classe du matin, allaient se montrer. Comme on se moquera de lui en le voyant travailler ! Cette pensée l’exaspère. Il tire de ses poches tous ses trésors et les examine. Hélas ! les billes et le reste ne suffiraient pas pour acheter une heure de liberté ! Ses moyens ne lui permettent pas de se procurer un remplaçant. Tout à coup il a une idée lumineuse, une véritable inspiration. Il ramasse sa brosse et se met tranquillement à l’ouvrage. Ben Rogers, celui dont il redoutait le plus les railleries, apparaissait à l’horizon.
 Jim posa le seau à terre et prit la bille
Jim posa le seau à terre et prit la bille
L’allure de Ben annonçait un cœur léger et la perspective d’une journée de plaisir. Il grignotait une pomme et lançait par intervalles un ordre mystérieux, suivi de l’imitation d’un bruit de cloche. Ben, en ce moment, se donnait à lui-même la représentation d’un steamer en marche. Peu à peu le navire ralentit sa course, fila au milieu de la chaussée, se pencha à tribord et hala non sans effort dans le vent, car le Grand Missouri ne tirait pas moins de neuf pieds d’eau. Ben était à la fois le navire, le capitaine, l’équipage, la machine à vapeur et la cloche. Il avait donc à s’imaginer qu’il se tenait debout sur la passerelle, donnant les ordres et les exécutant.
— Stop ! Drelin-din-din !
N’ayant presque plus d’eau à courir, le steamer se rapprocha lentement de l’habitation de la tante Polly. — Tribord la barre ! Bon quart devant ! Drelin-din-din !
Les bras de Ben se raidirent et restèrent collés à ses flancs.
— Ramène à bâbord ! Drelin-din-din ! Brouf… ouf… ouf !…
Le bras gauche se mit à décrire des cercles.
— Stop la roue de tribord ! Drelin-din-din ! Stop la roue de bâbord ! Laisse arriver ! Brouf… ouf… ouf ! Accoste le quai ! Jette l’amarre ! Lâche la vapeur ! Sht-sht-sht !
Les roues cessèrent de tourner, et le steamer s’arrêta tout près de Tom, qui avait continué son badigeonnage sans paraître prêter la moindre attention aux mouvements du navire. Ben, un peu surpris, le contempla bouche béante.
— Te voilà amarré aussi, toi, et pour toute la journée, hein ? dit-il enfin.
Tom faisait la sourde oreille ; la tête penchée, il examinait son dernier coup de pinceau avec l’œil d’un artiste.
— Ohé, mon pauvre vieux, Sid m’a raconté que tu es obligé de travailler, reprit le nouveau venu d’un ton compatissant.
— Tiens, c’est toi, Ben ?
— Comment, tu n’as pas entendu ? Dis donc, nous allons nous baigner. Tu voudrais bien nous accompagner, pas vrai ? Mais non, tu aimes mieux travailler, naturellement.
Tom regarda son interlocuteur d’un air étonné.
— Qu’appelles-tu travailler ?
— Ah ça, est-ce que tu ne travailles pas ?
Tom changea son baquet de place et répondit d’un air insouciant :
— Peut-être que oui, peut-être que non ; mais la besogne ne déplaît pas à Tom Sawyer.
— Voyons, tu ne me feras pas accroire que tu t’amuses !
La brosse continuait son petit train-train. — Crois ce que tu voudras. Seulement tu oublies qu’on n’a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture.
La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom passa délicatement son pinceau le long d’une planche, se recula pour admirer l’effet, ajouta une couche, puis recommença le même manège. Son compagnon, qui suivait chaque mouvement du peintre, se sentait de plus en plus intéressé. Bientôt il s’écria :
— Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner un peu.
Tom parut sur le point d’accéder à la requête, mais il changea d’avis.
— Non, non, dit-il, tu ne saurais pas, Ben. Vois-tu, tante Polly m’en voudrait à mort. Elle tient à ce que ce côté-là soit bien blanchi, parce qu’il donne sur la rue. Si c’était la clôture qui donne sur l’allée, ça lui serait égal et à moi aussi. Tu n’as pas d’idée combien elle est difficile. Elle ne s’en rapporte qu’à moi. Il n’y a pas un individu sur mille, et même sur deux mille, capable de la contenter.
— Vrai ? Allons, passe-moi la brosse, je m’en tirerai aussi bien que toi.
— Ben, je ne demanderais pas mieux que de t’obliger, « foi d’honnête Indien » ; mais tante Polly… Elle a envoyé promener Jim et Sid qui offraient de me remplacer. Si l’ouvrage n’était pas proprement fait, je serais dans de jolis draps !
— Sois tranquille, je ne suis pas manchot. Voyons, laisse-moi essayer. Je te donnerai la moitié de ma pomme.
— Eh bien… Non, Ben, tu gâcherais tout.
— Tiens, je te donnerai ce qui reste de ma pomme.
Tom céda comme à contre-cœur, bien qu’il fût ravi du succès de sa ruse. Tandis que l’ex-steamer Missouri travaillait en plein soleil, le ci-devant artiste, assis à l’ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, mordillait sa pomme et méditait le massacre d’autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. On voyait sans cesse arriver des écoliers désœuvrés qui, venus pour railler, s’arrêtaient pour badigeonner. Avant que Ben eût offert sa démission, la corvée était déjà adjugée à Billy Fisher, à qui elle coûta un cerf-volant en parfait état. Lorsque ce dernier se déclara éreinté, Johnny Miller s’empressa d’acheter la prérogative moyennant un beau rat mort, y compris une ficelle neuve qui permettait de balancer le rongeur décédé. Les marchés de ce genre se renouvelèrent d’heure en heure. Vers le milieu de l’après-midi, Tom, si pauvre le matin, roulait littéralement sur l’or, car il ne savait plus que faire de ses richesses. Outre les objets mentionnés ci-dessus, il possédait douze billes, l’embouchure d’un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clef qui n’ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, deux soldats d’étain, un bouton de porte en cuivre, deux têtards, un collier de chien — mais pas de chien — le manche d’un couteau, six pétards, un chat borgne, divers fragments de pelure d’orange et un châssis de fenêtre démantibulé. Par-dessus le marché, il avait flâné toute la matinée au lieu de travailler, il s’était vu entouré d’une nombreuse société, et la clôture resplendissait sous une triple couche de peinture ! Si sa provision de chaux n’eût pas été épuisée, tous les gamins du village se seraient trouvés en faillite.
 La clôture resplendissait sous une triple couche de peinture
La clôture resplendissait sous une triple couche de peinture
Tom se dit qu’en somme l’existence est fort supportable. Il avait découvert, sans s’en douter, une grande loi sociale : afin d’amener les hommes à convoiter quelque chose, il suffit de leur faire croire que la chose est difficile à atteindre. S’il eût été un profond philosophe, comme l’auteur de ce livre, il aurait su que le travail consiste dans une tâche que l’on doit accomplir bon gré, mal gré, et que le plaisir consiste dans une occupation quelconque à laquelle on n’est pas contraint de se livrer. Cela l’aurait aidé à comprendre pourquoi l’on travaille lorsqu’on fabrique une fleur artificielle, tandis que l’on s’amuse quand on s’éreinte à grimper jusqu’au sommet du mont Blanc. Il a existé en Angleterre des gentlemen très riches qui conduisaient chaque jour un mail-coach à quatre chevaux, pendant un long trajet, parce que le privilège de tenir les rênes leur coûtait une somme assez ronde ; mais ils auraient cru se livrer à un travail dérogatoire si l’on avait offert de les payer pour remplir les fonctions de cocher.
Chapitre III
TRISTESSE DE TOM
Ses collaborateurs congédiés, Tom se présenta devant tante Polly, qu’il trouva assise dans une salle confortable située sur le derrière de la maison, et qui servait à la fois de parloir et de chambre à coucher. La chaleur, le silence, le parfum des fleurs, le bourdonnement des abeilles avaient produit leur effet habituel, et la vieille dame dodelinait de la tête sur son tricot, car elle n’avait d’autre compagnon que le chat qui dormait sur ses genoux. Convaincue que Tom, selon sa coutume, avait depuis longtemps déserté, elle s’étonna qu’il osât affronter d’une façon aussi intrépide des reproches mérités.
— Est-ce que je ne puis pas aller jouer maintenant, ma tante ? demanda Tom.
— Comment, déjà ? Et ta besogne ?
— Elle est finie.
— Ne mens pas, Tom, cela m’exaspère.
— Je ne mens pas, ma tante.
En pareil cas, tante Polly ne se contentait pas d’un témoignage de ce genre. Elle sortit afin de se convaincre par ses propres yeux, et elle eût été satisfaite s’il n’était entré que vingt pour cent de vérité dans l’assertion de son neveu. Lorsqu’elle vit que non seulement la façade entière était badigeonnée, mais que l’on avait même blanchi une partie de la chaussée au pied de la clôture, sa surprise fut indicible.
— Par exemple, si je m’attendais à cela ! s’écria-t-elle. Tu sais travailler quand tu veux, Tom, il n’y a pas à le nier. Par malheur, il ne t’arrive pas souvent de vouloir. Allons, va jouer ; mais tâche d’être rentré à temps pour souper, ou gare à toi.
En attendant, elle fut si enchantée du zèle inusité dont Tom venait de faire preuve qu’elle l’emmena vers une armoire et lui remit la plus belle pomme qu’elle put trouver. Ce don fut accompagné d’un petit sermon sur la saveur particulière que prend un régal alors qu’il est la récompense d’un effort vertueux. Tandis qu’elle terminait son discours, Tom escamota deux biscuits.
Au moment où il s’éloignait, il aperçut Sidney qui gravissait avec une sage lenteur l’escalier extérieur conduisant au second étage. Des mottes de terre gisaient à portée — elles ne tardèrent pas à pleuvoir comme une grêle autour de l’écolier modèle. Avant que tante Polly eût eu le temps d’accourir à la rescousse, plusieurs projectiles avaient atteint leur but, et Tom disparut. Il y avait une porte ; mais, en général, notre héros était trop pressé pour sortir ou entrer par cette voie. Il escalada l’enclos avec d’autant plus de légèreté qu’il se sentait capable de sauter par-dessus la lune, maintenant que son compte avec Sidney était réglé.
Il se trouva bientôt à l’abri de toute poursuite et se dirigea en sifflant vers l’endroit où deux armées se donnaient rendez-vous tous les samedis avec l’intention de se livrer bataille. Tom était le général en chef d’une de ces armées, et Joseph Harper, son ami intime, commandait l’autre. Les deux chefs ne daignaient jamais payer de leur personne. Ils laissaient cela au menu fretin. Assis côte à côte sur une hauteur, ils dirigeaient les opérations par l’entremise de leurs aides de camp. L’armée de Tom, après un combat acharné, remporta une victoire éclatante. On compta les morts, les prisonniers furent échangés, les conditions de la prochaine dispute furent réglées, puis vainqueurs et vaincus se formèrent en ligne pour défiler sous les yeux de leurs commandants. Tom, demeuré seul, reprit enfin le chemin de la maison où on l’attendait pour souper.

Il aperçut dans le jardin une inconnue
Tandis qu’il passait devant la maison qu’habitait son ami Jeff Thatcher, il aperçut dans le jardin une inconnue — une ravissante petite créature aux yeux bleus, dont les cheveux jaunes retombaient sur son dos en deux longues nattes ; elle portait une robe blanche, des pantalettes aux volants ornés de broderie et des bottines trop mignonnes pour que l’on pût croire qu’elles avaient été fabriquées à Saint-Pétersbourg. Le général, que ses troupes victorieuses venaient d’acclamer, succomba sans même essayer de résister. L’image d’une certaine Amy Lawrence s’effaça aussitôt de son cœur. Un coup d’éponge sur une ardoise n’enlève pas plus promptement, plus efficacement les chiffres que l’on y a tracés. Huit jours à peine auparavant, Tom avait provoqué en duel (à coups de poing) un camarade qui se permettait d’effrayer Amy par une série de grimaces hideuses. Amy avait alors déclaré qu’elle ne voulait pas d’autre mari que son défenseur, et Tom, de son côté, avait pris des engagements sérieux. Et voilà que, à la vue d’une étrangère qu’il rencontrait pour la première fois, il oubliait toutes ses promesses !
L’inconstant adora la nouvelle idole à la dérobée jusqu’au moment où il se vit découvert. Alors il feignit de ne pas s’apercevoir de la présence de la jeune inconnue, dont il s’efforçait pourtant d’exciter l’admiration par toutes sortes de gamineries absurdes. Cette parade grotesque dura assez longtemps ; mais, au beau milieu d’un admirable saut périlleux, Tom vit que la petite fille se dirigeait vers la maison. Il retomba sur ses pieds, s’approcha de la haie et regarda par-dessus, espérant que celle qu’il avait voulu charmer par ses tours d’adresse renoncerait à s’éloigner. Elle se tint un instant sur le seuil, puis tourna le dos en riant. Tom poussa un gros soupir ; mais son visage s’illumina bientôt, car, avant de disparaître, elle fit soudain volte-face afin de lancer une giroflée qui tomba à quelque distance de l’acrobate. Celui-ci exprima sa joie par une nouvelle culbute, s’arrêta à un pas ou deux de la fleur ; puis, transformant une de ses mains en abat-jour, il se mit à regarder au bout de la rue, comme s’il eût tout à coup aperçu un objet qui l’intéressait vivement. Bientôt il ramassa un brin de paille qu’il se mit à balancer sur le bout de son nez, la tête penchée en arrière. Tout en maintenant l’équilibre avec une habileté qui aurait fait honneur à un jongleur indien, il se rapprochait peu à peu de la giroflée. Enfin son pied nu toucha la fleur, ses doigts agiles s’en emparèrent, il s’éloigna en sautillant et tourna le coin de la rue. Mais son absence fut de courte durée — le temps de fourrer la giroflée à l’intérieur de sa jaquette, contre son cœur ou peut-être contre son estomac, car il n’était pas fort en anatomie.
Il ne tarda pas à revenir et se promena devant la maison jusqu’à la tombée de la nuit, se livrant aux exercices les plus dangereux. Mais celle qu’il voulait captiver ne se remontra pas. Tom se consola un peu en pensant qu’elle s’était tenue en observation près de quelque croisée et qu’il n’avait pas perdu son temps. Comme cette conviction ne l’empêcha pas de sentir que l’heure du repas approchait, il résolut de ne pas s’attarder davantage.
Durant le souper, il fit preuve d’une gaieté si exubérante que tante Polly eut à peine le courage de le gronder à propos des mottes de terre dont Sid avait été le point de mire. Mais lorsqu’il essaya de dérober du sucre sous les yeux de sa tante, il reçut de rudes taloches. Au lieu de se révolter, il se contenta de dire :
— Tu ne tapes pas Sid quand il en prend.
— Sid ne me tracasse pas comme toi. Tu ne laisserais pas un morceau de sucre si je ne tenais pas l’œil ouvert.
Quelques instants après, elle entra dans la cuisine. Sid, fier de son impunité, heureux surtout d’une occasion de braver Tom, s’empara du sucrier ; mais le bol lui glissa entre les doigts, tomba par terre et se brisa en morceaux. Tom était ravi du malheur de l’hypocrite — tellement ravi qu’il contint son envie de rire. Il se promit de ne pas dire un mot lorsque sa tante reviendrait, de se tenir coi jusqu’à ce qu’elle sommât le coupable de se dénoncer. Alors seulement il parlerait. Ce serait drôle de voir l’écolier modèle recevoir enfin une bonne correction. Il garda donc le silence quand la vieille dame, attirée par le bruit, rentra dans la salle à manger et leva les bras au ciel en contemplant par-dessus ses lunettes les débris du sucrier.
— Qui a fait cela ? demanda-t-elle.
— Bon, nous allons rire, pensa Tom ; elle ne s’attend pas à trouver son chéri en faute.

Qui a fait cela ?
L’instant d’après, il roulait sur le parquet. Rien n’irritait la tante Polly comme le bris de sa vaisselle, et l’idée ne lui était pas venue de soupçonner Sidney. D’ailleurs, si elle avait frappé un peu fort, c’est que le coupable supposé, se tenant presque toujours sur la défensive, savait éviter les attaques qu’il prévoyait. Cette fois, il avait été pris au dépourvu ; aussi tante Polly resta-t-elle le bras en l’air, prête à recommencer et non moins surprise que son neveu. Ce dernier voulut alors transformer en scène d’attendrissement son coup de théâtre manqué. Il se releva de l’air d’un homme dont tous les membres sont rompus et murmura d’une voix dolente : — Allons, tu peux encore me casser un bras ou une jambe ! Par exemple, je ne sais pas pourquoi tu t’en prends à moi. C’est Sid qui a cassé le sucrier.
Tante Polly parut perplexe, et Tom espéra qu’elle allait s’efforcer de le consoler ; mais dès qu’elle fut revenue de son étonnement, elle s’abstint par politique de reconnaître ses torts.
— N’importe, dit-elle, je parie que tu as mérité une punition. Il suffit que je tourne le dos pour que tu fasses mille méchancetés.
Néanmoins, sa conscience lui adressait des reproches, et elle brûlait de manifester ses regrets par quelque parole aimante. Mais c’eût été avouer qu’elle avait eu tort, et un pareil aveu aurait compromis la discipline. Elle gronda Sidney pour la forme et vaqua à ses affaires, le cœur serré. Tom bouda dans un coin, exagérant ses griefs. Il devinait que, moralement, sa tante se tenait à genoux devant lui, et cela le flattait. Il était décidé à ne faire aucune avance et à n’en accepter aucune. Il savait qu’un regard plein de tendresse tombait sur lui de temps à autre — il refusa obstinément d’y répondre. Il se vit étendu sur son lit de mort ; il vit sa tante penchée à son chevet, le suppliant de prononcer un mot de pardon ; ce mot, il mourrait sans l’avoir dit, le visage tourné vers le mur. Quels remords elle éprouverait alors ! Puis il s’imagina qu’on le repêchait dans la rivière et qu’on le rapportait inanimé à la maison, les cheveux tout mouillés, les mains froides, le cœur à l’abri des souffrances terrestres. Comme elle se jetterait sur lui ! De grosses larmes couleraient le long de ses joues ; elle prierait le ciel de lui rendre son enfant, se promettant de ne plus le tarabuster. Mais il demeurerait immobile, les membres glacés, incapable de remuer un doigt, et elle regretterait trop tard de lui avoir préféré Sidney.
Il se laissa tellement attendrir par les visions pathétiques de son imagination qu’il dut avaler sa salive, car sa gorge se serrait. Sa vue était obscurcie par un nuage qui se condensait lorsqu’il abaissait la paupière et lui coulait le long du nez. Il éprouvait un plaisir si vif à dorloter ses griefs que toute consolation mondaine lui eût paru une insulte dont sa douleur avait le droit de s’indigner. Aussi se leva-t-il à l’approche de sa grande cousine qui revenait d’un village voisin, après une longue absence de huit jours, et sautait de joie à la vue du toit maternel. Sombre comme un héros de mélodrame — ou grognon comme un enfant mal élevé, si vous aimez mieux — il s’éloigna par une porte, tandis qu’une chanson et un rayon de soleil entraient par l’autre. Il erra loin des lieux fréquentés par ses camarades et chercha un endroit désert où aucun éclat de rire ne viendrait troubler sa douleur. Un train de bois amarré à la rive l’attira ; il s’assit au bord du radeau et contempla le vaste espace liquide qui se déroulait sous ses yeux, souhaitant de se voir noyé tout d’un coup, à l’improviste, sans éprouver aucune des sensations désagréables que cause l’asphyxie. Ensuite il songea à sa fleur. Il la tira de sa poche et la froissa entre ses doigts, ce qui contribua beaucoup à accroître sa lugubre félicité. Il se demanda si elle le plaindrait, elle, en voyant combien l’injustice dont il était l’objet le faisait souffrir. Pleurerait-elle ? Ou bien se détournerait-elle froidement sans prêter la moindre attention à sa douleur ? Ce dernier tableau lui causa une angoisse si pleine de douceur qu’il l’évoqua sous toutes les formes et vida le calice jusqu’au fond. Enfin, il se leva en poussant un gros soupir et s’éloigna dans l’obscurité. Il était neuf heures et demie ou dix heures lorsqu’il repassa devant la maison qu’habitait la petite inconnue. Il s’arrêta. La rue était déserte ; aucun bruit ne troublait le silence ; une chandelle éclairait d’une vague lueur une croisée du second étage. Était-ce là qu’elle reposait ? Il se faufila à travers la haie, pénétra dans le jardin, franchit à pas de loup les plates-bandes et s’arrêta sous la fenêtre éclairée. Il la contempla longtemps et avec émotion ; puis il s’allongea sur le sol, étendu sur le dos, tenant entre les mains sa pauvre fleur froissée. C’est ainsi qu’il mourrait, délaissé par le monde entier, sans abri au-dessus de sa tête, sans personne pour lui fermer les yeux, sans un visage ami penché au-dessus de lui. Et c’est ainsi qu’elle le verrait, le lendemain, lorsqu’elle ouvrirait sa croisée. Verserait-elle une larme sur son corps inanimé ? Paul avait déploré la fin prématurée de Virginie ; mais Virginie se serait peut-être consolée bien vite de la mort de Paul. Dans le doute, Tom se consola lui-même en songeant que sa tante du moins s’affligerait.
La fenêtre s’ouvrit tout à coup, la voix discordante d’une négresse profana le silence solennel, et un déluge d’eau inonda le martyr imaginaire.
Notre héros se redressa, éternua, se secoua ; un projectile fit siffler l’air ; on entendit un bruit de verre cassé, une forme indistincte sauta par-dessus l’enclos et disparut dans les ténèbres.
Une demi-heure plus tard, tandis que Tom, déjà déshabillé, contemplait, à la lueur d’une maigre chandelle, ses vêtements mouillés, Sid se réveilla ; mais si l’idée lui vint de faire quelque observation peu agréable, il changea d’avis et n’ouvrit pas la bouche, car son frère paraissait de mauvaise humeur. Ce dernier se coucha sans se donner la peine de faire sa prière, et Sid prit note de cette omission.
Chapitre IV
BILLETS ROUGES ET BILLETS BLANCS
Le soleil se leva sur un monde en repos et rayonna comme une bénédiction sur la petite ville de Saint-Pétersbourg. Le déjeuner terminé,
La toilette du dimanche.Tom se mit à l’œuvre pour apprendre par cœur les versets de l’Évangile qu’il devait réciter avant de se rendre à l’école du dimanche. Il savait à peu près sa leçon au moment où tante Polly le somma d’aller revêtir le costume qu’il ne portait que les jours de fête.

La toilette du dimanche
Sa cousine Marie lui ayant remis une cuvette remplie d’eau et un morceau de savon, il sortit, posa la cuvette sur un banc qui se trouvait près de l’entrée, plongea le savon dans le vase, releva ses manches, versa doucement l’eau sur le sol et rentra dans la cuisine où il se frotta le visage avec la serviette accrochée derrière la porte. Marie lui enleva la serviette en s’écriant : — Voyons, Tom, n’as-tu pas honte ? L’eau ne te fera pas de mal.
La cuvette fut remplie de nouveau. Cette fois, notre héros prit son courage à deux mains et, lorsqu’il reparut, un honorable témoignage ruisselait le long de ses joues sous la forme d’un liquide savonneux. Quand il fut habillé, sa cousine lui fit passer une inspection rigoureuse, donna un dernier coup de brosse à ses cheveux et arrangea ses boucles brunes d’une façon symétrique. Ces boucles faisaient le désespoir de Tom. Elles lui paraissaient efféminées, et il prenait une peine inouïe pour les plaquer contre son crâne. Marie boutonna ensuite sa jaquette, rabattit son vaste col sur ses épaules et le couronna d’un léger chapeau de paille. Ainsi accoutré, il avait vraiment bonne mine et se trouvait fort mal à l’aise. Il se sentait beaucoup moins gêné dans son costume de tous les jours.
Marie fut bientôt prête, et les trois enfants — l’aînée, malgré ses airs de petite maman, n’était pas beaucoup plus âgée que ses cousins — partirent pour l’école du dimanche. La classe, ce jour-là, durait de neuf heures à dix heures et demie ; puis l’on assistait au service divin. Sid et Marie restaient de leur plein gré, et leur compagnon restait aussi… par nécessité.
Arrivé près de la porte de la modeste église, Tom accosta un de ses condisciples.
— Dis donc, Jack, as-tu un billet jaune ? lui demanda-t-il.
— Oui.
— Veux-tu me le céder ?
— Qu’est-ce que tu m’en donnes ?
— Trois bâtons de réglisse et un hameçon.
— Montre-les.
Le marché et plusieurs autres du même genre furent vite conclus ; Tom échangea ainsi une foule d’objets précieux contre un certain nombre de billets rouges ou bleus, puis il s’arrêta. — Merci, j’ai mon compte, dit-il à un retardataire qui vint lui proposer un nouveau troc.
Enfin il pénétra dans l’église avec un essaim d’écoliers endimanchés, gagna son banc et, à peine assis, chercha querelle à son voisin de droite. Un catéchiste intervint ; mais, dès qu’il ne se sentit plus surveillé, Tom, qui ne pouvait rester tranquille, tira les cheveux du camarade placé devant lui. Lorsque ce dernier se retourna, le coupable était absorbé dans son livre, ce qui ne l’empêcha pas, une seconde plus tard, d’enfoncer une épingle dans le mollet de son voisin de gauche. Ce méfait lui valut une seconde remontrance, et il feignit de croire qu’elle s’adressait à sa victime.
Du reste, je le dis à regret, beaucoup de ses condisciples ne se conduisaient guère mieux. Si la plupart d’entre eux parvenaient à obtenir des bons points, c’est qu’il suffisait de réciter couramment deux versets des Écritures saintes pour avoir droit à un billet bleu. Dix bulletins bleus valaient un bulletin rouge, et dix rouges valaient un jaune. En échange de dix billets jaunes on remettait à l’heureux possesseur une Bible très modestement reliée. Beaucoup de mes lecteurs se résoudraient-ils à apprendre par cœur deux mille versets de l’Évangile, fût-ce pour gagner une Bible illustrée par Gustave Doré ? On citait pourtant un élève d’origine allemande qui avait remporté cinq ou six prix en accomplissant ce tour de force ; mais c’était là de l’histoire ancienne. Il arrivait bien rarement qu’un écolier eût assez de patience pour réunir la quantité de bulletins voulue, de sorte que la remise d’un de ces prix était un événement mémorable. Elle remplissait les élèves d’une ambition qui durait quelquefois une semaine entière. Cependant Tom, quoiqu’il brûlât de se distinguer d’une façon quelconque, n’avait jamais trop paru envier les lauréats.
À neuf heures précises, le directeur de l’école du dimanche s’installa devant la chaire et sollicita un moment d’attention. C’était un jeune homme d’une trentaine d’années, très aimé des écoliers, parce qu’il savait les amuser tout en leur donnant d’excellents conseils. Il portait un col de chemise formidablement empesé, une cravate blanche aussi large et un peu plus longue qu’un billet de banque, et des bottes dont les bouts, selon la mode du jour, se relevaient comme le brancard d’un traîneau moscovite. Les jeunes gens de l’époque n’arrivaient pas sans peine à donner à leur chaussure cette courbe élégante et peu commode. Il leur fallait demeurer assis pendant de longues heures, les doigts du pied pressés contre un mur. J’ignore si M. Walters employait ce moyen pénible pour gâter ses bottes. En tout cas, il remplissait ses fonctions gratuites avec zèle et avec un désir sincère de se rendre utile.
— Mes enfants, dit-il, je vous demande de vous tenir aussi tranquilles que possible et de m’accorder une minute ou deux d’attention. À la bonne heure, c’est ainsi que l’on doit se conduire à l’école du dimanche. J’aperçois une jeune personne qui regarde par la fenêtre — elle s’imagine sans doute que je suis quelque part là-bas — peut-être dans un arbre, adressant des conseils aux petits oiseaux. Elle se trompe ; ce n’est pas aux petits oiseaux que je parle. (Murmures et sourires approbateurs.) Je sais trop bien qu’ils ne m’écouteraient pas…
Il serait inutile de répéter jusqu’au bout le discours de M. Walters. Je me contenterai d’ajouter que le dernier tiers de sa courte harangue fut troublé par diverses reprises d’hostilité dont Tom donna le signal et par d’autres symptômes d’inattention. M. Walters aurait eu fort à faire s’il eût voulu rappeler à l’ordre tous ceux qui semblaient se figurer qu’il jetait sa poudre aux moineaux.
Une partie des chuchotements, dont l’orateur aurait eu le droit de s’indigner, avait été provoquée par un événement assez rare — l’entrée de visiteurs : l’avocat Thatcher, accompagné d’un gros gentleman à cheveux gris et d’une dame à la toilette imposante, était monté sur l’estrade qui s’élevait au bas de la chaire. La dame donnait la main à une petite fille que l’on voyait pour la première fois à l’église. Tom se sentit prêt à danser de joie. À peine eut-il aperçu la jeune personne en question qu’il s’efforça de se distinguer en bousculant ses voisins, en tirant tous les cheveux qui avaient le malheur d’être à sa portée, en distribuant des coups de poing à la ronde, c’est-à-dire en faisant ce qu’il fallait pour fasciner une demoiselle de huit ans. Une seule chose gâtait l’allégresse de Paul — le souvenir de l’humiliation qu’il avait subie dans le jardin de sa Virginie. Mais, après tout, Virginie ignorait peut-être l’affront infligé à Paul.

Un illustre visiteur
Les visiteurs furent installés à la place d’honneur, et M. Walters s’empressa de les présenter à l’assemblée. Le gros gentleman était le juge du district, rien de moins — le plus grand personnage que ces enfants eussent encore contemplé. Ils s’étonnaient qu’il daignât se mêler au commun des mortels. Il venait de loin, de très loin, de Constantinople, ville qui, aux États-Unis, se trouve à une distance de douze milles au moins de Saint-Pétersbourg. Il siégeait dans le tribunal du comté, dans un palais de justice abrité, à ce que l’on assurait, par un toit en zinc. Le respect que ces réflexions inspirèrent se manifesta enfin par un profond silence et par la fixité de dix rangées d’yeux démesurément ouverts. C’était là le fameux juge Thatcher, le propre frère de leur avocat, l’oncle de leur camarade Jeff Thatcher, qui ne tarda pas à s’avancer afin de causer familièrement avec le grand homme et d’exciter ainsi l’admiration envieuse de toute l’école.
M. Walters crut devoir se distinguer à son tour, et il remplit le rôle de la mouche du coche avec une activité peu commune. Il allait et venait, donnait des ordres et des contre-ordres, distribuait des remontrances ou des éloges à droite et à gauche. Le bibliothécaire courait çà et là avec une brassée de livres qu’il semait au hasard d’un air affairé. Les jeunes maîtresses se montraient à la hauteur de leur tâche ; elles levaient gentiment le doigt pour admonester les tapageurs ou passaient une main caressante sur la tête d’un bon sujet. Les catéchistes imberbes s’évertuaient à maintenir la discipline et se montraient fort sévères. Les petites filles se distinguèrent de mainte façon ; les écoliers mirent une telle ardeur à les éclipser que l’air fut bientôt rempli de boulettes de papier et de sourdes rumeurs. Le juge conservait une sérénité impassible ; il répandait sur la salle entière les rayons de son sourire majestueux et se chauffait au soleil de sa propre grandeur, car il posait aussi. Il ne manquait qu’une seule chose pour combler la joie de M. Walters, la chance d’exhiber un enfant prodige et de lui remettre un prix. Par malheur, il était allé aux informations, et on lui avait dit qu’aucun élève ne possédait un nombre suffisant de billets. Soudain, au moment où le directeur se résignait, Tom se présenta audacieusement, ses bulletins à la main, et réclama une Bible. Un coup de foudre éclatant dans un ciel serein aurait causé moins de surprise à M. Walters ; mais les bulletins étaient là, dûment estampillés ; il n’y avait pas moyen de les refuser sans provoquer un scandale. Tom fut donc invité à prendre place sur l’estrade où trônaient le juge et les autres gros bonnets. Lorsque la grande nouvelle fut officiellement proclamée, elle produisit une sensation si vive que l’on aurait entendu voler une mouche. Les garçons crevaient d’envie, surtout ceux qui se reprochaient d’avoir troqué leurs billets contre des trésors que Tom s’était procurés la veille en leur concédant le droit de travailler pour lui.

Tom réclame son prix
Le prix fut remis à Tom avec un petit speech où le directeur mit moins d’effusion que de coutume. Il devinait qu’il y avait là un mystère qu’il valait peut-être mieux ne pas éclaircir sur-le-champ. Comment supposer qu’un élève aussi peu assidu eût engrangé deux mille gerbes de la sagesse biblique ? L’hypothèse était absurde. Amy Lawrence, sans se laisser troubler par des doutes de ce genre, se sentait très fière du succès de son ami, et elle chercha à le lui faire comprendre par l’expression de son visage. Mais l’ingrat s’obstinait à ne pas la regarder. Elle s’étonna d’abord, puis un vague soupçon s’empara d’elle ; un regard furtif de Tom, qui ne s’adressait pas à elle, lui apprit bien des choses, et elle eut envie de pleurer.
Le lauréat, présenté à l’illustre visiteur, osait à peine ouvrir la bouche. Malgré son effronterie habituelle, il tremblait devant ce personnage imposant, qui avait d’ailleurs le mérite d’être le père de Virginie. Le juge, flatté de l’impression qu’il produisait, s’efforça de le rassurer ; il posa sa main sur la tête du lauréat, l’appela « mon brave petit homme » et lui demanda son nom.
— Tom, répliqua le lauréat.
— Non, pas Tom, c’est…
— Thomas, si vous voulez.
— À la bonne heure. Je pensais qu’il y en avait un peu plus long. Fort bien ; mais vous avez sans doute un autre nom, et vous voudrez bien me le faire connaître, n’est-ce pas ?
Comme le lauréat se taisait, le directeur vint à son aide.
— Est-ce que vous avez oublié votre nom de famille, Thomas ? demanda-t-il. Répondez au juge et dites-lui « monsieur ». Il faut être poli.
— Thomas Sawyer, monsieur.
— Nous y voilà. Bravo, mon petit homme. Très éveillé, très intelligent. Vous débutez bien, et vous irez loin, si vous persévérez. Soyez convaincu que vous ne regretterez jamais la peine que vous vous êtes donnée pour mériter un prix, car il n’y a rien qui vaille le savoir dans ce bas monde, rien, rien. C’est le savoir qui fait les bons citoyens et les grands hommes. Vous serez un bon citoyen et un grand homme un de ces jours, Thomas, pour peu que vous persistiez. Alors, vous regarderez en arrière et vous vous direz : je dois tout à la précieuse instruction que j’ai reçue à l’école du dimanche. Maintenant, vous ne refuserez pas de répéter, à cette dame et à moi, quelques-unes des choses que vous avez apprises, car nous sommes fiers de compter parmi nous des petits garçons studieux. Voyons, vous savez certainement les noms des douze apôtres. Voulez-vous avoir l’obligeance de me rappeler les noms des deux premiers ?
Tom tourmentait un des boutons de sa jaquette et paraissait fort troublé. Il rougit et demeura bouche béante. M. Walters était dans ses petits souliers.
— Allons, vous me répondrez à moi, une dame ne doit pas vous faire peur, Thomas ? dit la femme du juge. Les deux premiers disciples se nommaient… ?
— David et Goliath.
Hélas ! tirons le rideau de la charité sur le reste de la scène.
Chapitre V
LE CHIEN ET LE SCARABÉE
À dix heures et demie, la cloche fêlée de la petite église se mit en branle, et bientôt les fidèles commencèrent à se réunir, pour assister au prêche du matin. Les élèves de l’école du dimanche se dispersèrent sur tous les points de l’église afin de prendre place sur les bancs occupés par leurs parents, qui tenaient à les surveiller.

Marie, Sid et Tom à l’église
Tante Polly se montra une des premières ; Marie, Sid et Tom furent installés près d’elle, ce dernier étant relégué sur le bas côté, assez loin de la croisée ouverte, qui aurait pu lui occasionner des distractions. L’église ne tarda pas à se remplir. On vit arriver le vieux maître de poste, le maire et sa femme, le juge de paix, Mme Douglas, aimable veuve de quarante ans, dont le manoir, situé sur une colline voisine, était le seul palais dont Saint-Pétersbourg pût se targuer, palais hospitalier, s’il en fut ; l’avocat Hilpin, le nouveau notable, venu récemment on ne savait d’où ; la belle de l’endroit, suivie d’une troupe de prétendants vêtus de leurs plus brillants atours ; puis une bande composée de jeunes commis qui s’étaient tenus sous le vestibule, suçant le pommeau de leurs cannes, lissant leur chevelure pommadée, jusqu’à ce que la dernière demoiselle eût subi leur inspection. Enfin, apparut Willy Mufferson, le vrai parangon de l’école, qui prenait autant de soin de sa maman que si elle eût été en cristal. Il amenait toujours sa mère à l’église et faisait l’orgueil des matrones. Ses camarades l’exécraient. Il était trop bon, et on leur jetait sans cesse son exemple à la tête. Par un hasard qui se renouvelait chaque dimanche, le coin d’un mouchoir blanc pendait hors de sa poche. Cette ostentation hypocrite déplaisait fort aux écoliers qui n’avaient pas de mouchoir à montrer.
La cloche résonna une dernière fois pour avertir les retardataires. Alors il régna dans le temple un silence qui ne fut troublé que par les chuchotements des demoiselles réunies sous l’orgue, dans la galerie où elles remplissaient les fonctions de choristes. Chez nous, lorsque le chœur ne chante pas, il bavarde. J’ai entendu parler d’un temple où les choristes se conduisaient avec plus de bienséance ; mais cela date de trop loin pour que je sois à même de rien préciser. Je crois néanmoins pouvoir affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un temple américain.
Le pasteur débuta en lisant le cantique que les fidèles allaient entonner, et il le lut beaucoup mieux que ses ouailles ne le chantèrent ; car il passait à bon droit pour un lecteur incomparable.
Lorsque le chant et les derniers accords de l’orgue eurent cessé, il récita une prière fervente où personne ne fut oublié. Il intercéda pour les fidèles réunis sous ce toit ; pour les autres églises de la ville ; pour la ville elle-même ; pour le comté ; pour les États-Unis ; pour les fonctionnaires en masse ; pour le Congrès ; pour le président ; pour les marins ballottés par des flots orageux ; pour les malades ; pour les millions de malheureux écrasés sous le talon des monarchies européennes et des despotismes orientaux ; pour les païens ignorants ; pour ceux qui ont des oreilles et ne veulent pas entendre. Il conclut en demandant au ciel de lui inspirer des paroles capables de produire l’effet du bon grain tombant sur un sol fertile. Amen. Il y eut un froufrou de robes, et les fidèles s’assirent. Celui dont je raconte l’histoire n’aimait pas cette oraison préliminaire, pendant laquelle on était tenu de rester debout. Il n’écoutait pas ; mais il connaissait le terrain de longue date et la route que suivait invariablement le clergyman lui était familière. Si ce dernier abordait quelque point nouveau, Tom s’en apercevait bien vite et s’indignait ; il regardait toute addition de ce genre comme une déloyauté dont chacun avait le droit de se plaindre.
Au beau milieu de la prière, une mouche s’était posée sur le dossier du banc qui précédait celui où se tenait Tom. Elle se frottait les pattes de devant, qui semblaient se métamorphoser en tire-bouchon ; elle les enlaçait autour de sa tête, qu’elle polissait si vigoureusement qu’elle paraissait vouloir la détacher, et l’on voyait l’espèce de fil qui lui servait de cou ; elle époussetait ses ailes avec ses pattes de derrière et les rabattait contre son corps comme les pans d’une redingote. En un mot, elle procédait à sa toilette avec autant de calme que si elle se fût trouvée à l’abri de tout danger. En effet, aucun péril ne la menaçait pour le moment. Bien que les doigts de Tom lui démangeassent, il n’aurait jamais osé saisir cette proie avant que tout le monde fût assis ; mais, à la dernière phrase, sa main commença à se courber, et à peine le mot Amen eut-il été prononcé par le pasteur que la mouche était prisonnière. Heureusement, tante Polly avait l’œil ouvert, et elle obligea son neveu à relâcher la captive.
Le ministre débita son homélie d’une voix un peu monotone, et bien qu’il ne manquât pas d’une certaine éloquence, beaucoup d’auditeurs ne tardèrent pas à dodeliner de la tête. Tom se tenait éveillé en comptant les feuillets. À la sortie, il savait toujours de combien de pages se composait le sermon ; mais on lui aurait en vain demandé de citer une seule des phrases qu’elles contenaient. Ce dimanche-là, cependant, il s’abstint de compter jusqu’au bout, car il songea à un trésor qu’il ne possédait que depuis la veille, et il le tira de sa poche.
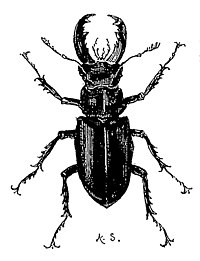
Le scarabée cerf-volant
C’était un grand scarabée noir à mâchoires formidables, qu’il appelait un hanneton à pinces et qu’il avait séquestré dans une boîte à pilules. Le premier soin de l’insecte fut de pincer un des doigts de son imprudent geôlier.
Il reçut une chiquenaude qui l’envoya dans un des bas-côtés de l’église, où il tomba sur le dos, tandis que Tom portait à sa bouche son doigt pincé. Le scarabée se tint là, agitant les pattes, se soulevant tantôt sur une élytre, tantôt sur l’autre, sans parvenir à prendre une posture moins incommode. Tom aurait bien voulu ressaisir le prisonnier évadé. Il n’y fallait pas songer : le fugitif, bien qu’incapable de profiter de sa liberté, était hors de portée. D’ailleurs, d’autres membres de l’assemblée trompaient leur ennui en contemplant les efforts désespérés du malheureux hanneton à pinces.
Bientôt un caniche nomade pénétra en flâneur dans le temple, l’oreille basse, l’œil morne ; sans nul doute il s’ennuyait aussi et trouvait les rues désertes trop calmes, la chaleur trop torride. Son regard tomba sur le scarabée ; sa queue se mit à frétiller. Il inspecta la proie, dont il fit le tour, la flaira à une distance respectueuse, passa une nouvelle inspection circulaire, s’enhardit et flaira de plus près ; puis il montra les dents, exécuta une série de charges à fond de train comme pour happer l’insecte, qu’il se gardait bien de toucher. Ce jeu semblait le divertir et divertissait certainement maître Tom. Enfin, las de ces gambades folichonnes, il se coucha sur le ventre, le scarabée entre ses pattes de devant, et continua ses expériences. Peu à peu il devint distrait ou indifférent. On eût dit qu’il s’assoupissait ; sa mâchoire s’abaissa et toucha l’ennemi, qui s’y accrocha. Alors un hurlement plaintif éclata ; le caniche secoua la tête et le scarabée alla tomber à deux pieds plus loin. Tom jubilait.
Le chien parut déconcerté ; toutefois, s’il se sentait humilié par sa défaite, il brûlait de prendre sa revanche. Il recommença son manège offensif, caracolant autour de son adversaire, s’abattant sur ses pattes de devant à moins d’un pouce de la bestiole et la menaçant même de plus près avec ses dents.

Un intrus
À la longue, ces cabrioles cessèrent de l’amuser ; il essaya de se distraire en s’occupant d’une mouche ; mais la mouche s’envola. Le nez collé au plancher, il suivit à la piste une fourmi et se fatigua vite des détours qu’elle l’obligeait à faire. Il bâilla, oublia le scarabée et s’assit dessus ! Un long glapissement d’angoisse couvrit la voix du pasteur. Le caniche remonta vers la chaire en poussant des cris de détresse, et revint au galop sur ses pas sans que son allure l’empêchât de hurler. Bientôt on ne vit plus qu’une planète laineuse qui parcourait son orbite avec une rapidité vertigineuse. Enfin l’infortuné s’écarta tout à coup de la voie orbiculaire, et bondit par-dessus la porte d’un des bancs pour aller s’abattre sur les genoux de son maître. Ce dernier s’empressa de jeter l’intrus par la fenêtre, et peu à peu la voix du martyr se perdit au loin.
Il n’était que temps. Une partie de l’assistance avait de la peine à garder son sérieux, et le prédicateur avait dû interrompre son sermon. Il reprit son discours ; mais il eut le bon esprit de l’abréger, car l’incident provoquait encore une hilarité profane fort nuisible à l’impression qu’il désirait produire.
Tom s’était tenu à quatre pour ne pas éclater de rire. Si une pareille manifestation eût été permise un dimanche, il aurait dansé tout le long du chemin en regagnant son domicile. Une seule chose gâtait sa joie : que son ami César jouât avec son hanneton, rien de mieux ; mais il trouvait que le caniche avait agi d’une façon peu honorable en emportant le bien d’autrui.
Chapitre VI
COMMENT ON SE DÉBARRASSE DES POIREAUX
Le lendemain, Tom Sawyer avait perdu sa gaieté. Il se sentait toujours très malheureux le lundi matin, qui inaugurait une nouvelle semaine de servage à l’école. Ce jour-là, lorsqu’il se réveillait, il commençait en général par regretter qu’il y eût eu un congé intermédiaire. Vingt-quatre heures de liberté ne servaient qu’à rendre l’esclavage plus odieux.
Tom s’abandonnait à de tristes réflexions. Bientôt l’idée lui vint que s’il avait la chance d’être malade il pourrait rester à la maison. Il passa en revue son organisme sans découvrir aucune sensation morbide. Un second examen lui révéla de vagues symptômes de nausée qu’il s’efforça d’encourager. Mais il eut beau faire : l’estomac était en bon état. Il réfléchit de nouveau.

Fausse alerte
Tout à coup il trouva quelque chose. Une de ses dents de devant branlait. Heureuse aubaine ! Tom allait se mettre à gémir, à sonner la cloche d’alarme », pour employer son expression, quand il se ravisa. Tante Polly n’acceptait pas ces arguments-là ; elle les arrachait, et cela faisait mal. Mieux valait tenir la dent en réserve et chercher ailleurs. Après s’être creusé la cervelle, il se rappela avoir entendu dire tout récemment par le docteur que la gangrène se met à une plaie que l’on néglige. Or l’orteil de son pied gauche portait la marque visible d’une écorchure dont il avait oublié de se plaindre. Il tira de sous la couverture le membre endommagé. Par malheur il ignorait les symptômes auxquels on reconnaît une plaie négligée. La peau était entamée, pas moyen de le nier, et son pied gauche lui parut beaucoup plus rouge que l’autre. On pouvait toujours essayer. Il se mit donc à geindre avec entrain.
Mais Sid avait le sommeil dur.
Tom s’indigna. Il crut ressentir dans l’orteil une douleur dont il s’inquiétait peut-être trop tard, et ses lamentations devinrent plus bruyantes.
Sid ne bougea pas. Ce manque de sympathie exaspéra Tom, qui enfonça son coude dans les côtes du dormeur. Certain du résultat, il recommença à geindre. Sid bâilla, s’étira, grommela, et contempla d’un air ébahi le malade, qui poussait des cris à fendre l’âme.
— Qu’est-ce qui te prend ? demanda-t-il.
— Ne remue pas tant, Sid, je t’en prie.
— Mais dis-moi donc ce que tu as. Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé plus tôt ? Faut-il appeler ma tante ?
— Non, n’appelle personne ; ça ne servirait à rien.
— Voyons, où souffres-tu ?
— Tiens, regarde comme mon pied est rouge. Le docteur Robinson a dit avant-hier que lorsque la gangrène s’y met, on est perdu. Eh bien, j’ai la gangrène, voilà tout, et l’on en meurt. Oh ! là ! là !
Tom était si bien entré dans l’esprit de son rôle et avait frotté son pied avec tant de persistance qu’en ce moment l’orteil gangrené lui faisait vraiment mal ; aussi ses gémissements paraissaient-ils de bon aloi.
Sid, effrayé, sauta à bas du lit, descendit l’escalier quatre à quatre et s’écria : — Viens, viens, tante Polly ! Tom est en train de mourir.
— En train de mourir !
— Oui, ma tante. Viens vite !
— Bast ! je n’en crois rien.
Néanmoins elle gravit les marches à la hâte, suivie de Marie et de Sid. Arrivée au chevet du moribond, elle demanda d’une voix haletante, d’un ton moitié inquiet, moitié railleur :
— Tu n’es pas encore mort, Tom ?
— Non, pas encore, ma tante ; mais mon pied écorché est tout rouge : j’ai la gangrène !
Tante Polly regarda l’écorchure, se laissa tomber sur son siège ; elle rit un peu, pleura un peu, puis elle se mit à rire et à pleurer tout à la fois. Lorsqu’elle se fut ainsi soulagée, elle dit :
— Mauvais garnement, quelle peur tu m’as faite ! Allons, tais-toi, en voilà assez.
Les gémissements cessèrent, et les douleurs lancinantes de l’orteil disparurent comme par enchantement. Tom se sentit déconcerté.
— Tante Polly, je t’assure que j’ai cru que mon pied avait la gangrène ; je souffrais tant que je ne songeais plus à ma dent.
— Ta dent ? Qu’est-ce qu’elle a, ta dent ? Ouvre la bouche. Oui, en voilà une qui ne tient guère ; mais on ne meurt pas de ça. Marie, va me chercher une bonne aiguillée de soie et un tison, — le feu de la cuisine est déjà allumé.
— Non, ne l’arrache pas, ma tante ! s’écria Tom. Elle ne me fait plus mal — du moins pas assez pour m’empêcher de sortir.
— Ah ! ah ! la mèche est éventée, hein ? Tu voulais rester à la maison au lieu d’aller à l’école ?
Marie venait d’arriver avec les instruments de chirurgie dentaire. La vieille dame noua autour d’une incisive branlante le bout d’un fil de soie dont elle attacha l’autre extrémité à un des poteaux du lit ; puis elle saisit le tison embrasé que tenait sa fille et le fourra presque sur le visage de Tom. Une seconde plus tard, la dent se balançait au pied du lit.
Mais à quelque chose malheur est bon. Ce matin-là, lorsque notre héros se dirigea vers l’école, il excita l’envie de tous ses camarades. La lacune laissée dans sa bouche lui permettait d’expectorer d’une façon originale dont on ne se lassait pas de s’extasier. Chemin faisant, il rencontra le jeune paria de la ville, Huckleberry Finn, enfant abandonné dont il enviait la position indépendante.

Huck Finn
Comme on avait défendu aux écoliers de fréquenter Huckleberry, Tom s’empressait de jouer avec lui dès que l’occasion se présentait. Huckleberry, gentleman de douze ans, portait une redingote dont les pans lui battaient les talons. Son chapeau était une ruine effondrée, aux bords de laquelle on avait arraché un large croissant. Une seule bretelle soutenait un pantalon dont le fond formait un sac qui ne renfermait rien, et dont le bas aurait traîné dans la poussière s’il n’avait pas été retroussé. Par nécessité, Huckleberry se montrait toujours affublé d’un costume de rebut dont il ne paraissait ni fier ni honteux. Il allait et venait à sa guise. L’heure de ses repas était incertaine ; mais, toujours prêt à faire une commission ou à donner un coup de main, il ne risquait pas qu’on le laissât mourir de faim. L’été, il dormait sur les marches de la première maison venue, et, en hiver, il couchait dans quelque écurie. Il se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation quand l’envie lui en prenait. On ne le grondait pas lorsqu’il se battait. Il veillait aussi tard que cela lui convenait. Bref, il jouissait de toutes les libertés qui rendent la vie précieuse. Du moins telle était l’opinion des écoliers de Saint-Pétersbourg, gênés et harassés par les mille freins qu’imposent les convenances sociales.
— Holà ! Huck, s’écria Tom dès qu’il aperçut maître Finn.
— Holà ! toi-même.
— Qu’est-ce que tu as là ?
— Un chat mort.
— Où l’as-tu trouvé, Huck ?
— Je l’ai acheté à Jem en échange d’une balle.
— À quoi est-ce bon, un chat mort ? demanda Tom.
— À quoi ? On s’en sert pour guérir les poireaux.
— L’eau de pluie vaut mieux, Huck.
— Allons donc ! Bob Tanner a essayé, et ça n’a pas réussi.
— Comment s’y est-il pris ?
— Il est tout bonnement allé dans la forêt, et il a trempé ses mains dans un tronc d’arbre pourri où il y avait de l’eau.
— En plein jour et sans rien dire, je parie ? Si tu te figures qu’on guérit les poireaux sans se donner plus de peine ! Il faut aller la nuit dans le bois, à l’endroit où l’on a vu un creux d’arbre plein d’eau. Juste à minuit, on s’avance à reculons jusqu’au trou, et l’on y fourre la main en criant : « Eau de pluie, avale mes poireaux ! » Ensuite, on fait onze pas, les yeux fermés ; on tourne trois fois sur soi-même, et l’on rentre sans parler à personne. Si l’on parle à quelqu’un, le charme est flambé. J’essayerai un de ces soirs. Mais le remède de la fève n’est pas mauvais non plus.
— Oui, on m’en a parlé, dit Huck. Voyons ta recette.
— C’est simple comme bonjour, répondit Tom. On prend une fève, on la fend en deux, et l’on coupe le poireau de façon à le faire saigner ; alors on met un peu de sang sur une moitié de la fève, que l’on enterre, à minuit, un soir où la lune ne brille pas. Le morceau où se trouve le sang tire et tire pour tâcher de ramener le reste de la fève, de sorte qu’il aide le sang à enlever le poireau.
— Oui, c’est bien ça, Tom. Seulement, lorsqu’on enterre la fève, il faut dire : « Reste là, fève — va-t-en, poireau ! » — Maintenant, dis-moi comment tu guéris les poireaux avec un chat mort.
— On va le soir au cimetière avec son chat, et l’on se cache près d’une fosse où un réprouvé a été enterré le matin même. À minuit, le diable arrive — il y en a quelquefois plus d’un, mais on n’a pas peur, parce qu’ils ne s’occupent que du mort. Vous entendez comme un bruit de vent ou peut-être un bruit de voix ; alors vous devinez qu’ils ont pris l’individu, et vous lancez le chat à leurs trousses en criant : « Diable, emporte le chat ; chat, emporte mes poireaux ! » Ça ne rate jamais. Je le tiens de la mère Hopkins.
— Elle doit s’y connaître ; car on dit qu’elle est sorcière.

La mère Hopkins
— On dit ! répéta Huck. C’est certain, Tom. Un jour que mon père passait près d’elle, il a bien vu qu’elle lui jetait un sort ; il a ramassé une grosse pierre qui l’aurait assommée si elle n’avait pas baissé la tête. Eh bien, ce jour-là il s’est cassé un bras en tombant dans un fossé, à dix pas du cabaret.
— Comment a-t-il su qu’elle lui jetait un sort ?
— Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Elle le regardait de travers et marmottait, signe qu’elle récitait une prière à rebours.
— Et quand comptes-tu essayer ton chat, Huck ?
— Ce soir. J’ai idée qu’ils viendront chercher le vieux Williams à minuit.
— Mais on l’a enterré hier.
— Est-ce que tu te figures que le diable pourrait emporter quelqu’un le dimanche ?
— Je ne pensais pas à ça. Laisse-moi aller avec toi, hein ?
— Je veux bien, si tu n’as pas peur.
— Peur, moi ? s’écria Tom d’un ton indigné. Tu me préviendras ce soir en miaulant. Viens me chercher, et tu verras si j’ai peur.
— Convenu. Tu miauleras à ton tour dès que tu m’entendras. La dernière fois, tu m’as tenu si longtemps à faire miaoû que le père Hayes a ouvert sa fenêtre et m’a flanqué une bouteille vide à la tête en m’appelant vilain matou. Pour ne pas être en reste avec lui, je lui ai envoyé une brique qui a cassé au moins un carreau.
— Sois tranquille. L’autre soir, je n’ai pas pu te répondre parce que tante Polly veillait. Tiens, tu as de la chance ! Où as-tu ramassé ce cheval d’or ? Qu’est-ce que tu en veux ?
— Je veux le garder.
— Il est joliment petit.
— Oui, oui, tout le monde peut débiner un cheval d’or qui ne lui appartient pas. — Avec cela qu’ils sont rares !
— C’est le premier que je rencontre cette année.
— Je te donne cette dent en échange, dit Tom, qui tira de sa poche un bout de papier qu’il déroula avec soin.
— Elle n’est pas fausse ? demanda Huckleberry, qui la contempla d’un air de convoitise.
Tom souleva sa lèvre supérieure.
— Tope là, dit Huckleberry.
Tom renferma l’insecte dans la boîte qui servait naguère de prison au scarabée, et les deux amis se séparèrent, chacun d’eux se croyant plus riche qu’il ne l’était avant ce marché.
Lorsque Tom atteignit la petite maison isolée où se tenait l’école, il entra du pas allègre d’un élève, sans peur et sans reproche, qui se pique de n’avoir pas perdu une seconde en route. Il accrocha son chapeau à une patère et s’installa à sa place habituelle. Le bourdonnement soporifique qui régnait dans la salle cessa tout à coup, et le maître, assoupi dans sa chaire, se réveilla.
— Thomas Sawyer ?
Tom savait par expérience que lorsqu’on prononçait son nom sans employer le diminutif, cela ne présageait rien de bon.
— Monsieur ?
— Avancez à l’ordre. Pourquoi arrivez-vous encore en retard ?
Tom allait invoquer une excuse banale, quand il aperçut deux nattes de cheveux qu’il voyait pour la première fois à l’école, mais qu’il reconnut parfaitement, et à côté de celle dont ces nattes ornaient le dos se trouvait la seule place vide qui existât sur le banc des filles. Il répondit aussitôt :
— Je me suis arrêté pendant quelques minutes pour causer avec Huckleberry Finn.
Le professeur demeura bouche béante. Le bourdonnement fut interrompu de nouveau. On se demandait si Tom, dont on connaissait pourtant l’audace, avait perdu la tête.
— Pour causer avec qui ? reprit enfin le maître. Je crois avoir mal entendu.
— Avec Huckleberry Finn, répéta Tom.
Cette fois, il n’y avait pas à s’y tromper.
— Thomas Sawyer, voilà un aveu qui me confond. Vous n’en serez pas quitte pour de simples coups de férule. Ôtez votre jaquette.
Et le bras du magister fonctionna jusqu’à ce qu’il fût fatigué et jusqu’à ce que le jonc qu’il employait dans les grandes occasions fût brisé.
— Maintenant, dit-il, prenez vos livres et allez vous asseoir du côté des filles. Que cela vous serve de leçon.
Les ricanements qui accueillirent notre héros semblèrent le remplir de confusion ; mais en réalité, son but était atteint. Lorsqu’il s’assit au bord du banc, son idole se recula en hochant la tête d’un air dédaigneux. Les autres élèves échangèrent des coups de coude et des clins d’œil. Tom se tint coi, les yeux fixés sur un livre dont il ne lisait pas un mot. Peu à peu, un murmure confus annonça que la ruche reprenait son travail. Tom commença à lancer des regards furtifs à sa voisine qui fit la moue et lui montra le dos. Lorsqu’elle se retourna, il y avait sur son cahier une pêche qu’elle repoussa sans trop d’animosité. Tom replaça son offrande au même endroit et se mit à dessiner sur son ardoise en affectant de cacher son œuvre. La demoiselle feignit d’abord de ne pas s’occuper de lui ; mais il ne fallait pas une forte dose de perspicacité pour reconnaître que son attention était éveillée. Tom continua à dessiner, sans paraître se douter qu’on l’observait. Enfin, la petite curieuse, après avoir en vain essayé de regarder par-dessus l’épaule du dessinateur, dit tout bas, avec un peu d’hésitation :
— Laissez-moi voir. Tom découvrit alors une atroce caricature d’une maison ornée de trois cheminées d’où s’échappaient des tire-bouchons de fumée. Tandis que l’architecte ajoutait, après coup, la porte et les fenêtres, sa voisine témoigna le plus vif intérêt ; puis elle murmura :
— C’est une très belle maison. Faites un monsieur qui va entrer.

Une conversation interrompue
Tom s’empressa de dessiner un personnage qui ressemblait à tout ce que l’on voudra, excepté à un homme, et qui aurait pu enjamber la maison. Sa voisine ne se montra pas difficile ; elle se déclara même très satisfaite du monstre et demanda :
— Pourriez-vous faire mon portrait ?
Tom dessina sans hésiter un sablier surmonté d’une pleine lune, avec des fétus de paille en guise de jambes et des bras d’une maigreur phénoménale. Il arma un des bras de pattes de mouche qui étaient censées tenir un éventail prodigieux.
— Comme je voudrais savoir dessiner ! dit l’original de ce portrait. — C’est très facile. Je vous apprendrai.
— Bien vrai ? Quand ?
— Après la classe si vous voulez. Comment vous appelez-vous ?
— Becky Thatcher. Et vous ? Oh ! je me souviens ! Thomas Sawyer.
— Ce n’est pas là mon nom d’amitié, répliqua Tom en se frottant les côtes. Vous m’appellerez Tom, n’est-ce pas ?
— Oui.
Tom se mit à griffonner sur son ardoise, cherchant à cacher ce qu’il écrivait. Cette fois, Becky n’y alla pas par quatre chemins.
— Je veux voir, dit-elle.
Tom écarta peu à peu la main, et Becky put lire sur l’ardoise : « Je vous aime joliment. »
— Moi qui croyais que c’était un beau dessin ! lui dit-elle. Je vous aime bien aussi, car je vous trouve drôle.
Au même instant, Tom, saisi par l’oreille, se sentit enlevé et entraîné à travers la salle jusqu’à sa place habituelle, sous un feu roulant de regards railleurs. Le maître se tint une minute ou deux derrière lui, puis s’éloigna sans prononcer une parole et remonta sur son trône. Mais bien que l’oreille de Tom lui causât une vive douleur, il ne songea pas à se plaindre.
Chapitre VII
LES FIANÇAILLES
Plus Tom cherchait à fixer son attention sur son livre, plus son esprit battait la campagne. À la longue, entre un soupir et un bâillement, il renonça à lutter. Il lui semblait que l’heure de la récréation ne sonnerait jamais. La chaleur était accablante ; aucune brise n’agitait l’air. Le murmure somnifère de vingt-cinq ou trente voix d’écoliers produisait une sorte d’engourdissement moral. Par une croisée ouverte, on voyait les collines de Cardiff dont les pentes vertes apparaissaient au loin sous une brume empourprée ; quelques rares oiseaux planaient dans l’air à une grande hauteur ; aucun autre être vivant ne se montrait, si ce n’est quelques vaches, et les vaches dormaient.
Tom brûlait d’impatience. Au lieu de travailler, il comptait les secondes, ce qui ne servait qu’à faire paraître les minutes plus longues. Par hasard, il porta la main à sa poche, et son visage s’illumina. Il en tira furtivement la boîte à pilules et relâcha le carabique dont Huck ne s’était défait qu’à contre-cœur. La pauvre bête se mit aussitôt à courir le long du pupitre avec une vivacité qui témoignait du bonheur qu’elle éprouvait de sortir de sa cage obscure. Hélas ! sa joie était prématurée. À peine eut-elle commencé son voyage que Tom, l’arrêtant avec une épingle, l’obligea à revenir sur ses pas.
Le propriétaire du carabique avait pour voisin de droite son camarade Joe Harper, qui ne tarda pas à prendre un vif intérêt à ce divertissement. Bien que les deux écoliers se rencontrassent chaque samedi à la tête d’une armée ennemie, cela ne les empêchait pas d’être les meilleurs amis du monde. Aussi Joe s’empressa-t-il de s’armer d’une plume afin d’aider son condisciple à exercer le prisonnier. Le jeu devint de plus en plus attachant. Néanmoins, Tom déclara bientôt que l’on ne savait jamais à qui « était le tour ». Il posa donc sur le pupitre une ardoise où il traça une ligne perpendiculaire,
— Si le cheval d’or va de ton côté, dit-il alors, tu pourras l’émoustiller et je le laisserai tranquille. Tant qu’il ne passera pas la ligne, tu ne t’en mêleras pas. De cette façon, ce sera un vrai jeu.
— Ça va ! répondit Joe. Donne-lui un coup d’éperon.
Au bout d’une minute, l’insecte échappa à Tom et franchit le Rubicon ; mais, harcelé par Joe, il ne tarda pas à gagner le camp ennemi. Ces incursions se renouvelaient sans cesse, au grand amusement des deux intéressés. Tandis qu’un des joueurs tourmentait la victime, l’autre la suivait de l’œil avec impatience, la tête penchée sur l’ardoise. Enfin la chance favorisa Joe. Le cheval d’or, qui semblait aussi excité que son maître, changeait constamment de direction, courait à droite, à gauche, en avant, en arrière ; puis, au moment où Tom se croyait sur le point de triompher, au moment où les doigts lui démangeaient, la plume de son adversaire barrait la route à l’agile insecte. Enfin Tom ne put se contenir ; il avança la main et faillit manquer aux conventions qu’il venait de dicter. Joe se fâcha tout rouge.
— Tom, pas de tricherie, dit-il.
— Je veux seulement l’émoustiller un peu.
— Tu n’en as pas le droit,
— Sac à papier, je ne le pousserai pas !
— Je te dis de le laisser tranquille. Il est de mon côté de la ligne. Tu n’y toucheras pas !
— Nous allons voir ; il est à moi, et j’en ferai ce que je voudrai… Aïe ! Un formidable coup de rotin venait d’arracher cette exclamation à Tom, et pendant deux minutes au moins un nuage de poussière voltigea sur les épaules des coupables. Ils avaient été trop absorbés par leur jeu pour remarquer le silence solennel qui régnait dans la salle depuis que le maître, descendu de sa chaire, s’était avancé à pas de loup pour s’installer derrière eux. Le traître avait même assisté en tapinois aux dernières évolutions du cheval d’or avant d’interrompre la partie par un dénouement inattendu.

La leçon de dessin
Quelques instants plus tard, la classe fut congédiée. À la sortie, Tom s’empressa de courir vers Becky Thatcher et lui dit à l’oreille :
— Mettez votre chapeau et faites semblant de rentrer chez vous. Pendant que les autres causeront, vous les planterez là pour remonter par la petite allée. Je m’en irai de mon côté, et je reviendrai par le même chemin.
Les complices s’éloignèrent avec deux groupes différents et se rejoignirent bientôt au bas de la petite allée. Quand ils eurent regagné la salle d’étude, elle était vide. Ils s’assirent sur la marche d’entrée, une ardoise devant eux, et Becky prit sa première leçon de dessin. Le professeur donna un crayon à son élève dont il guida la main. On créa ainsi une maison surprenante et d’autres œuvres non moins merveilleuses. Peu à peu, on cessa de s’intéresser aux beaux-arts, et on se mit à causer.
— Aimez-vous les rats ? demanda Tom. — Non, je les déteste.
— Moi aussi, lorsqu’ils sont vivants. Mais je parle de rats morts que l’on balance autour de sa tête avec une ficelle. Je vous en donnerai un.
— Merci, je n’y tiens pas. Un écureuil, je ne dis pas.
— Je crois bien ! Je voudrais en avoir un. Êtes-vous jamais allée au cirque ?
— Pas souvent ; papa n’aime pas à sortir le soir.
— Moi, j’y suis allé je ne sais combien de fois. Quand je serai grand, je veux être clown.
— Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux être juge ? demanda Becky.
— Peuh ! les juges s’habillent comme tout le monde.
— C’est vrai, et ils ne se mettent pas toutes sortes de couleurs sur la figure.
— Et les clowns gagnent un tas d’argent — au moins un dollar par jour. L’ennuyeux, c’est qu’ils ne peuvent pas toujours s’habiller comme au cirque… Dites donc, Becky, avez-vous un promis ?
— Un promis ? Je ne sais pas ce que c’est.
— On promet à un garçon de ne se marier qu’avec lui ; on s’embrasse, et alors il est votre promis.
— Pourquoi s’embrasse-t-on ?
— Pour être plus sûr. Vous vous rappelez ce que j’ai écrit sur l’ardoise et ce que vous m’avez répondu ? Eh bien, je vous aime ; vous me trouvez drôle, je vous embrasse. Maintenant, vous êtes ma promise, je suis votre promis, et vous ne vous marierez jamais, jamais, jamais avec personne que moi.
— Et vous, vous ne vous marierez jamais, jamais, jamais qu’avec moi, n’est-ce pas, Tom ?
— Bien entendu. Si vous me rencontrez en allant à l’école, vous ne causerez qu’avec moi, et nous danserons toujours ensemble. Amy Lawrence fera une fameuse moue, mais ça m’est égal. Becky ouvrit de grands yeux. Tom vit qu’il venait de commettre une bévue, et il s’arrêta tout déconcerté.
— Ô Tom, vous avez aussi promis de vous marier avec elle lorsque vous serez clown ! s’écria Becky, qui se mit à pleurer.
— Voyons, Becky, ne pleurez donc pas ; je ne peux pas me marier avec elle, puisque c’est vous qui êtes ma promise.
Cette réponse pleine de logique n’ayant produit aucun effet, Tom passa le bras autour du cou de celle qu’il voulait rassurer et s’efforça de la consoler ; mais Becky, le visage tourné du côté du mur, le repoussa d’un coup de coude. Tom fit une seconde tentative sans meilleur résultat. Alors il se fâcha à son tour et sortit à grands pas de la salle d’étude. Il se promena dans la cour, l’œil fixé sur la porte, espérant que Becky viendrait le rejoindre. Bien que son amour-propre lui conseillât de ne pas faire de nouvelles avances, il se décida à rentrer. Becky boudait toujours dans son coin. Tom s’approcha et se tint un moment silencieux, car il ne savait trop par où débuter. Enfin il dit de sa voix la plus persuasive :

La brouille
— Becky, je t’aime mieux que personne ; je me moque pas mal d’Amy Lawrence.
Becky ne bougea pas.
— Est-ce que nous ne sommes plus amis ? Veux-tu que je te dessine un cheval ?
Cette offre tentante demeura sans réponse. Tom fouilla dans ses poches, dont il retira son trésor le plus précieux, une boule de cuivre qui, la veille encore, ornait un chenet. Il avança le bras de façon que sa promise pût admirer la boule et dit d’un ton insinuant :
— Je te la donne, Becky ; prends-la, je t’en prie.
D’un revers de main, Becky fit tomber la boule par terre. Il est des bornes à la patience humaine. Tom gagna de nouveau la cour et disparut avec l’intention bien arrêtée de ne plus reparaître à l’école ce jour-là. Lorsque Becky, que le silence inquiétait, courut vers la porte, il était déjà hors de vue.
Chapitre VIII
ROBIN HOOD
Tom, dont l’amour-propre était froissé, s’éloigna d’abord au pas accéléré, filant par des sentiers détournés. Il ne modéra son allure que lorsqu’il fut à peu près certain de ne pas rencontrer les élèves qui retournaient à l’école. Il franchit à plusieurs reprises un ruisseau afin de faire perdre sa piste. C’était là une précaution d’une efficacité d’autant plus infaillible que personne ne le poursuivait. Au bout d’une demi-heure, il gagna le sommet de la colline de Cardiff et disparut derrière le manoir de Mme Douglas. De cette hauteur on apercevait à peine l’école, que le fugitif ne tenait pas du reste à revoir, même de loin.
Tom pénétra dans un petit bois touffu dont il connaissait trop bien tous les arbres et tous les fourrés pour que l’absence de sentiers lui causât le moindre embarras. Las de sa marche forcée, il s’allongea sur la mousse au pied d’un chêne dont les branches le protégeaient contre l’ardeur du soleil. La nature était plongée dans une morne torpeur. Aucune brise n’agitait les feuilles. La chaleur était telle que les oiseaux eux-mêmes oubliaient de chanter. De temps en temps résonnait le coup de marteau d’un pivert ; mais ce bruit ne servait qu’à faire paraître le silence plus profond et la solitude plus complète.
Tom, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains, s’abandonna à sa tristesse. L’idée lui vint d’échapper à tous les tracas de l’existence en se construisant une cabane dans ce bois, où il vivrait comme Robinson Crusoë dans son île déserte. Il dut renoncer à ce projet ; de longues explorations lui avaient prouvé que la forêt ne lui fournirait d’autres provisions de bouche que des mûres et des noisettes, nourriture dont il n’était nullement disposé à se contenter. D’ailleurs, ses camarades ne lui laisseraient pas la libre jouissance de son île imaginaire, rendez-vous ordinaire des écoliers en rupture de ban, qui ne manqueraient pas de le déranger et révéleraient sa retraite. Ah ! s’il pouvait mourir — rien que pour un jour ou deux — Becky se repentirait peut-être quand il serait trop tard.

La forêt de Robin Hood
À défaut d’un trépas provisoire, qui ne lui aurait pas déplu, il chercha un moyen de vengeance plus réalisable. S’il décampait pour de bon et disparaissait mystérieusement ? S’il s’en allait au loin dans des pays inconnus, au-delà des mers, pour ne plus jamais revenir ? C’est alors que Becky se repentirait ! La pensée de s’enrôler dans un cirque forain lui sourit de nouveau — elle fut bien vite écartée. Un clown doit toujours rire, et ce rôle ne convenait pas à un malheureux qui voyait tout en noir. Non ; il se ferait soldat et ne regagnerait sa ville natale qu’au bout de longues années, couvert de gloire et de cicatrices, avec un bras ou deux jambes de moins. Mieux encore, il se joindrait à quelque tribu indienne, chasserait les taureaux sauvages et brandirait le tomahawk sur les montagnes et dans les plaines immenses du far west. Il deviendrait un grand chef et ne reparaîtrait à Saint-Pétersbourg que coiffé de plumes, hideusement tatoué, la ceinture ornée de chevelures enlevées aux ennemis de sa tribu. Il tomberait ainsi un beau matin au milieu des élèves de l’école du dimanche, poussant à l’improviste un cri de guerre sauvage qui épouvanterait les plus braves. Cependant on avait déjà vu des Indiens à Saint-Pétersbourg ; malgré les plumes et le cri de guerre, son entrée pourrait donc ne pas produire l’effet voulu. Tout bien réfléchi, il serait pirate. Oui, c’est cela ! Là-dessus, son avenir lui parut tout tracé, entouré d’une auréole d’une splendeur inimaginable. Le bruit de ses audacieux exploits se répandrait d’un bout à l’autre de l’univers, et son nom seul ferait trembler le monde. Avec quelle rapidité son léger navire, le Roi des tempêtes, fendrait les flots à la poursuite d’un galion espagnol chargé de doublons ! Avec quelle fierté il arborerait son sinistre drapeau noir ! Lui, Tom, arpenterait le pont avec ce calme imperturbable qui distingue les forbans. Il monterait toujours le premier à l’abordage. Impitoyable durant le combat, il épargnerait les vaincus et brûlerait la cervelle du premier de ses hommes qui s’aviserait de menacer un blessé. S’il se trouvait une princesse à bord du galion, il l’épouserait. Cela vexerait Becky ; mais à qui la faute ? Au moment où la gloire du vaillant corsaire serait à son apogée, il apparaîtrait soudain dans sa ville natale avec son visage basané, son pourpoint et son haut-de-chausses de velours noir, ses bottes à l’écuyère, son écharpe rouge, sa ceinture garnie de coutelas et de pistolets, son chapeau tromblon orné de plumes d’autruche et brandissant un drapeau noir où se détacherait une tête de mort brodée en rouge. Avec un gonflement d’orgueil, il entendrait chacun s’écrier avec effroi :
— C’est Tom Sawyer, le pirate noir !
Oui, c’était décidé. Il avait choisi sa carrière. Il partirait dès le lendemain matin. Il fallait donc faire ses préparatifs et rassembler tout ce qu’il possédait. Il s’approcha d’un tronc d’arbre et se mit à creuser le sol avec son faux bowie knife, dont la lame de bois ne tarda pas à toucher un objet qui rendit un son creux. Il plongea la main dans le trou et prononça d’un ton solennel l’adjuration suivante :
— Que ce qui n’est pas venu vienne ! Que ce qui est venu reste !
Puis, écartant la terre, il retira du trou une arche de Noé d’assez grande dimension. Il secoua la boîte, regarda à l’intérieur et parut abasourdi en voyant qu’elle ne renfermait qu’une seule bille. Il se gratta la tête d’un air perplexe, jeta au loin la bille avec un geste de mauvaise humeur et demeura plongé dans une profonde méditation.
Il y avait certes de quoi s’étonner. Une recette que la superstition locale déclarait infaillible venait de rater. Tout le monde sait que, si l’on enterre une bille en prononçant une certaine incantation, il suffit de la laisser tranquille pendant quinze jours et d’ouvrir alors la cachette en répétant les paroles que Tom venait de prononcer pour rentrer en possession de toutes les billes que l’on a perdues dans l’intervalle, à quelque distance qu’elles se soient dispersées. Lui-même avait maintes fois tenté l’expérience ; mais il oubliait que jamais il n’avait pu retrouver la cachette. Après avoir réfléchi, il s’arrêta à la conclusion qu’une sorcière avait dû intervenir pour rompre le charme. L’esprit plein des contes que débitent les nègres, il résolut de s’en assurer et chercha autour de lui jusqu’à ce que son regard eût rencontré un endroit sablonneux où le sol se déprimait en forme d’entonnoir. Il se baissa, approcha la bouche de l’entonnoir et cria :
« Creuseur, creuseur, laisse-toi voir,
Dis-moi ce que je veux savoir. »
Le sable commença à dévaler ; bientôt un fourmi-lion se montra pendant une seconde et disparut non moins vite dans sa galerie.
— Le creuseur n’ose pas sortir. Je savais bien qu’une sorcière s’en était mêlée !
Autant vaudrait poser un cautère sur une jambe de bois que d’essayer de lutter contre une sorcière, personne ne l’ignore. Aussi Tom n’y songea-t-il pas. Ce n’était pas une raison pour sacrifier la bille qu’il avait jetée dans un moment de dépit. Mais ses recherches furent vaines. Il revint à l’arche de Noé, se plaça exactement à la place où il se tenait lorsqu’il avait lancé l’objet perdu, tira une seconde bille de sa poche et l’envoya dans la même direction en disant :
— Frère, va rejoindre ton frère !
Il courut à l’endroit où elle venait de tomber, à ce qu’il croyait ; mais il ne trouva rien, revint sur ses pas et renouvela l’expérience. La troisième fois le charme opéra — le frère rejoignit son frère, à la grande joie de Tom, qui avait perdu deux billes pour en retrouver une.
Au même instant une sonnerie de trompette retentit dans les profondeurs du bois. Elle n’annonçait nullement l’approche d’une escouade de cavalerie, car l’oreille la moins exercée eût reconnu qu’elle provenait d’un jouet d’étain à l’usage des enfants. Tom parut comprendre ce signal, car il retira aussitôt sa jaquette et son pantalon, transforma une de ses bretelles en ceinture, puis écarta quelques branches mortes amassées près de l’arche de Noé. Cette seconde cachette renfermait une arbalète, une flèche, un sabre de bois et un cornet à bouquin. En un clin d’œil, notre héros saisit ces objets et bondit en avant, les jambes nues. Arrivé sous un grand orme, il s’arrêta et fit résonner son cor. Après avoir ainsi bruyamment prévenu l’ennemi de sa présence, il dit à voix basse à des compagnons invisibles :

Armé en guerre
— Silence, mes braves archers ! Ne bougez pas et attendez le signal.
Alors il s’avança sur la pointe des pieds, regardant avec précaution autour de lui. Au bout de quelques minutes, apparut Joe Harper, aussi légèrement vêtu et aussi formidablement armé que son camarade.
— Arrête ! s’écria Tom. Qui donc a l’audace de pénétrer dans la forêt de Sherwood sans mon autorisation ?
— Sache que Guy de Gisborne n’a besoin de l’autorisation de personne ! Et qui donc es-tu pour… pour…
— Pour oser me tenir un pareil langage ? souffla Tom, car dans leur jeu improvisé nos écoliers se conformaient au texte d’un livre qu’ils avaient lu plus d’une fois.
— Pour oser me tenir un pareil langage ? répéta Joe.
— Qui je suis, maraud ? Je suis Robin Hood, ainsi que tu l’apprendras à tes dépens, pour peu que tu tentes de poursuivre ta route. — Quoi, tu serais ce célèbre proscrit ? Guy de Gisborne connaît ta valeur, mais il est aussi brave que toi et n’a jamais reculé devant une menace. En garde !
Les deux antagonistes brandirent leurs sabres. Le duel débuta d’une façon très dramatique. Les adversaires imitaient les attitudes et les passes de deux marins qui s’étaient livré au cirque maint combat acharné. On reculait, on avançait à tour de rôle ; on rendait coup pour coup. Une, deux ! Une, deux ! Par degrés la lutte devint plus animée, bien que les sabres seuls fussent endommagés. Enfin, Tom s’écria d’une voix haletante :
— Tombe, tombe donc ! Pourquoi ne tombes-tu pas ?
— Je ne tomberai pas ! Tu as reçu plus de coups que moi.
— Cela ne fait rien. Tu sais bien que le livre dit : « Alors, d’un coup de revers, il tua l’infortuné Guy de Gisborne ».
Il n’y avait pas moyen de récuser un document historique de la valeur de celui que l’on venait d’invoquer ; Joe reçut donc son coup de sabre et tomba.
— Maintenant, dit-il en se relevant avec prestesse, c’est à mon tour de te tuer.
— Ah ! mais non. Les choses ne se passent pas ainsi dans le livre.
— Ça n’est pas juste.
— Eh bien, Joe, puisque te voilà mort, tu peux être le moine Tuck et m’assommer à coups de trique.
Joe accepta ce compromis, et son antagoniste passa un vilain quart d’heure. Enfin, Tom, qui pour rien au monde n’aurait renoncé au rôle du fameux proscrit, succomba dans une lutte contre douze archers représentés par Joe.
— Mes fidèles compagnons, dit-il alors à une bande de ses amis venue trop tard à son aide et toujours représentée par Joe Harper, donnez-moi mon arc, et là où tombera ma dernière flèche, vous enterrerez le pauvre Robin Hood, qui veut être enseveli dans ces bois qu’il a si vaillamment défendus contre les oppresseurs de son pays.
Alors, après avoir lancé la flèche, il se laissa choir sur l’herbe et il serait mort s’il ne s’était pas assis sur une ortie, ce qui l’obligea à se relever plus vite qu’il ne convient à un cadavre. Sur ce, nos écoliers s’habillèrent, cachèrent leurs armes et s’éloignèrent de la forêt de Sherwood, regrettant qu’il n’y eût plus de proscrits et se demandant ce que la civilisation moderne a fait pour compenser cette lacune.
Chapitre IX
L’ASSASSINAT
Le même soir, vers neuf heures, tante Polly envoya les enfants se coucher. Sid ne tarda pas à s’endormir ; mais Tom demeura éveillé, comptant les minutes avec une impatience fiévreuse. Il s’attendait presque à voir paraître le jour lorsque dix heures sonnèrent ! De crainte de troubler le repos de Sid, il n’osait frétiller, ainsi que l’exigeait l’état de ses nerfs. Il se tint coi, contemplant les ténèbres et trouvant le silence lugubre. Soudain, le tic-tac d’un de ces insectes auxquels on a donné le nom sinistre d’horloge de la mort, résonna dans le mur, au chevet de sa couchette. Ce tic-tac monotone — tout le monde sait cela, ou du moins personne ne l’ignorait à Saint-Pétersbourg — annonce que les jours de quelqu’un sont comptés, et Tom n’aimait pas à l’entendre. Il se demandait si le temps avait cessé de marcher, quand le sommeil s’empara enfin de lui. Le coucou qui se trouvait au bas de l’escalier sonna onze heures ; mais le dormeur n’entendit que des miaulements mélancoliques qui se mêlaient aux péripéties d’un rêve confus. Le bruit d’une croisée qui s’ouvrait, d’une voix qui criait : « Veux-tu décamper, vilain matou ! » et d’une bouteille qui se brisait contre un mur de planches, le réveilla en sursaut. Quelques minutes plus tard, il était habillé, se glissait par la fenêtre et rampait le long d’une espèce d’auvent. Il miaula avec prudence à plusieurs reprises durant ce périlleux trajet, puis sauta sur le toit d’un hangar et de là à terre. Huckleberry l’attendait avec son chat mort. Les deux amis s’éloignèrent à la hâte et disparurent dans l’obscurité. Une demi-heure après, ils s’avançaient avec intrépidité à travers les hautes herbes du cimetière, qui leur montaient jusqu’aux genoux.
C’était un cimetière tel que l’on en voyait à cette époque dans les provinces de l’Ouest, c’est-à-dire fort mal entretenu. Situé sur une colline, à un mille et demi environ de la ville, il était entouré d’une clôture délabrée dont les planches se penchaient les unes en avant, les autres en arrière, et dont aucune ne tenait droit. Les mauvaises herbes poussaient à foison. Des croix de bois, rongées par les vers, chancelaient sur les fosses, cherchant un appui qu’elles ne trouvaient pas. Sur la plupart d’entre elles, on n’aurait pas pu lire, même en plein jour, l’inscription que l’on y avait peinte autrefois.
Une faible brise gémissait à travers les arbres, et Tom s’imagina que les morts se plaignaient. Les deux amis parlèrent peu et sans élever la voix ; en dépit de leur bravoure, l’heure, le lieu, le silence solennel qui régnait autour d’eux, ne laissaient pas de les effrayer un peu. Ils trouvèrent la tombe nouvelle qu’ils cherchaient, et se mirent à couvert sous trois grands ormes qui s’élevaient à quelques pieds de la fosse.
Ils attendirent en silence pendant cinq ou six minutes qui leur parurent durer des siècles. La huée d’un hibou fut le seul bruit qui troubla la paix du cimetière. Enfin les réflexions de Tom devinrent tellement lugubres qu’il éprouva le besoin de parler.
— Hucky, demanda-t-il, est-ce que tu crois que les morts aiment à nous voir ici ?
— Je voudrais bien le savoir, répondit Huckleberry à voix basse. Je suis presque fâché d’être venu.
— Moi aussi, répliqua Tom.
Après un court intervalle de silence, il reprit :
— Dis donc, Huck, est-ce que tu penses que le borgne nous entend parler ? — Parbleu ! Du moins son esprit nous entend. Tu aurais bien pu l’appeler M. Williams.
— Je ne songeais pas à le vexer. Tout le monde l’appelait le Borgne et il ne se fâchait pas.
— Ce n’est pas une raison ; il y a des morts qui sont mauvais coucheurs.
Cette réponse peu rassurante jeta un froid, et l’entretien fut de nouveau interrompu. Tout à coup Tom saisit son compagnon par le bras.
— Pristi, tu m’as fait peur, s’écria Huckleberry. Qu’est-ce qu’il y a ?
— Chut ! pas si haut. Tu n’as pas entendu ? Tiens, écoute.
Les deux amis se pelotonnèrent l’un contre l’autre.
— Oui, j’entends à présent, dit Huckleberry. Pour le coup, on vient chercher M. Williams. Qu’allons-nous faire ?
— Tu ne veux pas jeter ton chat à leurs trousses ?
— Ma foi, non, je n’en ai plus envie. Tant pis pour mes poireaux.
— Bah ! ils ne nous verront pas.
— Allons donc ! ils voient la nuit aussi bien que le jour.
— Nous ne sommes pas des morts ; si nous ne bougeons pas, ils ne feront pas attention à nous.
Un son de voix étouffées, qui se rapprochait, arriva de l’autre bout du cimetière. Les deux amis se serrèrent l’un contre l’autre.
— Regarde par là, murmura Tom. Qu’est-ce que c’est que cela ?
— Un feu follet, une âme en peine… Ah ! si j’avais su !
Trois formes, que l’on ne distinguait que vaguement à la faible lueur des étoiles, s’avançaient avec lenteur ; l’une d’elles balançait une lanterne qui émaillait le sol d’innombrables paillettes de lumière.
— Pour sûr, ce sont les suppôts du diable, dit Huck avec un frisson d’épouvante qu’il communiqua à son compagnon. Il y en a trois : nous sommes fichus ! Nous devrions peut-être nous agenouiller et réciter un bout de prière. Au lieu de s’agenouiller, Huck se mit tout à coup à fredonner un refrain de chanson nègre.
— Tais-toi donc ! s’écria Tom. Si c’est comme ça que tu pries !
— Je me moque d’eux, répliqua Huck. Ce ne sont pas des diables. Je reconnais la voix de Jack Potter. Cachons-nous derrière les arbres. Celui-là ne sera pas assez fin pour nous découvrir. Il doit être ivre, selon son habitude.
— N’importe, tiens-toi tranquille. Ils s’avancent de notre côté. Ils ont l’air de chercher quelque chose… Tu ne te trompais pas, Huck, c’est bien Jack Potter, et voilà Joe l’Indien.
— Ce satané métis ! J’aimerais presque autant avoir affaire au diable. Que viennent-ils chercher ici ?
Les chuchotements cessèrent, car les nouveaux venus, arrivés près de la fosse où gisait Williams le Borgne, n’étaient plus qu’à quelques pieds de la cachette des gamins.
— Nous y sommes, dit une troisième voix. Celui qui parlait leva la lanterne qu’il tenait et révéla ainsi le visage du jeune docteur Robinson.
Potter et Joe l’Indien portaient un brancard sur lequel se trouvaient une corde et deux bêches. Ils posèrent leur fardeau à terre et s’apprêtèrent aussitôt à ouvrir la tombe. Le docteur, après avoir placé la lanterne sur le brancard, s’assit, le dos appuyé contre un des ormes. Il s’était installé si près de Tom que ce dernier aurait pu le toucher en allongeant le bras.
— Vivement, Jack, dit-il. La lune peut se montrer d’une minute à l’autre.
Les travailleurs grommelèrent une réponse et se mirent à creuser. Pendant quelque temps, on n’entendit que le grincement des bêches et le bruit du terreau ou des gravats qu’elles jetaient de côté. Enfin un des outils résonna sur le bois du cercueil, que les deux hommes eurent bientôt enlevé de la fosse. Ils firent sauter le couvercle et jetèrent sans façon le cadavre sur le sol. Au même instant, les nuages qui voilaient la lune s’écartèrent et montrèrent le visage livide de feu Williams. On rapprocha le brancard, sur lequel on attacha le défunt. Potter tira de sa poche un couteau-poignard dont il fit jouer le ressort et coupa un bout de la corde qui pendait ; puis il se tourna vers le docteur.

Le cimetière
— Mon carabin, dit-il, votre sujet est prêt ; maintenant, vous allez abouler un autre billet de cinq dollars, ou il restera en panne.
— Bien parlé ! ajouta Joe l’Indien.
— Drôles ! s’écria le docteur d’une voix irritée, vous n’aurez pas un cent de plus, Vous avez exigé vos cinq dollars d’avance, et je vous les ai remis.
— Oui, et vous avez fait mieux que cela, répliqua Joe l’Indien en s’avançant vers le docteur, qui venait de se lever. Il y a trois ans, vous m’avez chassé de la cuisine de votre père en me traitant de voleur, et parce que j’ai juré que je vous revaudrai cela tôt ou tard, on m’a coffré comme vagabond. Vous avez peut-être cru que je vous manquerais de parole ? Mais je n’ai pas pour rien du sang indien dans les veines, Je vous tiens, et nous allons régler nos comptes.
Le bras levé, il menaçait de frapper le docteur au visage, lorsque ce dernier lui allongea soudain un vigoureux coup de poing, qui l’envoya rouler sur le sol. Potter lâcha son couteau.
— Pas de ça ! s’écria-t-il. Faut pas taper sur mon associé.
L’instant d’après, le docteur et l’associé de Joe s’étaient saisis à bras-le-corps et luttaient de toute leur force, foulant l’herbe, imprimant leurs talons dans la terre molle. Joe l’Indien, un peu étourdi d’abord, fut bientôt debout ; ses yeux étincelaient de colère. Il aperçut le couteau qu’il s’empressa de ramasser. Alors, dans l’attitude d’un chat-tigre qui guette sa proie, il tourna autour des deux lutteurs. Tout à coup, le docteur se dégagea, saisit le couvercle du cercueil vide et étendit Potter à ses pieds. Le métis profita de l’occasion pour enfoncer jusqu’à la garde la lame du couteau dans la poitrine du jeune homme, qui chancela et tomba sur le second résurrectionniste, qu’il inonda de son sang. Un nuage qui couvrit la lune cacha cet horrible spectacle, et les deux enfants effrayés s’enfuirent dans les ténèbres. La lune ne tarda pas à se montrer de nouveau. Joe l’Indien, penché sur sa victime, la contempla d’un œil sinistre. Le docteur laissa échapper quelques paroles indistinctes et poussa un long soupir ; puis tout retomba dans le silence.
— Notre compte est réglé et bien réglé, docteur, murmura le métis.
Il fouilla alors dans les poches de sa victime, s’empara de ce qu’elles contenaient, mit le couteau dans la main droite de Potter et s’assit sur le cercueil vide. Trois, quatre, cinq minutes s’écoulèrent avant que Potter remuât. Enfin il commença à gémir. Ses doigts se fermèrent sur le manche du couteau ; il leva le bras, contempla l’arme ensanglantée et la laissa tomber avec un frisson d’horreur. Puis il se redressa, repoussa le cadavre, et se tint assis, regardant autour de lui d’un air intrigué.
— Qu’est-ce que cela veut dire, Joe ? demanda-t-il enfin.
— Vilaine affaire ! répliqua Joe. Pourquoi diable as-tu joué du couteau ?
— Moi ? Je n’en suis pas capable.
— Bah ! on ne se lave pas avec des mots.
Potter se mit à trembler et devint très pâle.
— Je me croyais un peu dégrisé, dit-il ; mais je me sens encore plus ivre qu’à notre départ. La tête me tourne et je ne me rappelle presque rien. Voyons, Joe, est-ce que c’est moi qui… ?
— Dame, tu as sauté sur lui parce qu’il m’avait frappé ; il t’a renversé avec le couvercle du cercueil, et je croyais ton affaire bâclée ; mais tu t’es relevé et tu lui as enfoncé ton couteau dans le corps.
— C’est la faute du whisky, Joe. Aussi vrai que je suis là, je n’ai pas voulu le tuer. Il m’a guéri quand j’avais le délire tremblant. Jamais de ma vie je ne me suis servi d’un couteau ; je ne me bats qu’à coups de poing, tout le monde sait ça. Nous avons toujours été bons camarades, Joe, ne me dénonce pas ! Le malheureux se jeta aux genoux du meurtrier impassible et leva vers lui des mains suppliantes.
— Tu l’as tué parce qu’il m’attaquait, et je ne suis pas capable de dénoncer un ami, répliqua Joe. Là, que veux-tu que je te dise de plus ? En voilà assez. Ce n’est pas le moment de pleurnicher. Filons chacun de notre côté. Il ne faut pas qu’on nous rencontre ensemble. Allons, en route, et ne laisse rien de compromettant derrière toi.
Potter éclata en lamentations ; mais Joe finit par le décider à suivre son conseil et le regarda s’éloigner,
— Il est aussi étourdi par le coup qu’il a reçu que par le whisky, se dit-il. Il ne pensera au couteau que lorsqu’il sera trop loin pour oser revenir tout seul.
Quelques minutes plus tard, les deux cadavres, le cercueil vide et la fosse ouverte ne se trouvaient plus exposés à d’autres regards que ceux de la lune.
Chapitre X
LE SERMENT
Les deux enfants, pâles d’effroi, coururent d’abord côte à côte dans la direction de la ville sans échanger une parole. Ils retournaient la tête de temps en temps et regardaient par-dessus leur épaule, comme des gens qui craignent d’être poursuivis. Dans chaque tronc d’arbre qui se dressait sur la route ils croyaient voir un homme et un ennemi, si bien que la peur leur coupait la respiration. Tandis qu’ils passaient devant les cottages disséminés à l’entrée de la ville, les aboiements des chiens de garde semblaient leur mettre des ailes aux pieds.
— Si nous pouvions seulement arriver jusqu’à la vieille tannerie, dit enfin Tom d’une voix haletante et sans s’arrêter. Je ne me tiens plus sur mes jambes.
— C’est comme moi, répliqua Huckleberry.
Malgré les plaintes que leur arrachait la frayeur plutôt que la fatigue, ils continuèrent leur course, les yeux fixés sur le but désigné par Tom. Enfin, ils gagnèrent une masure abandonnée, se précipitèrent ensemble par la porte ouverte et se laissèrent tomber derrière un mur protecteur. Peu à peu leur pouls battit moins fort et Tom dit à voix basse :
— Quelle histoire, Huck !
— J’aurais presque autant aimé voir le diable !
— Comment ça finira-t-il ?
— Si le docteur meurt, ça finira par une pendaison.
— Tu crois ?
— J’en suis sûr.
— Mais qui racontera la chose ? Nous ?

— Nous ? Oh, non ! Si nous dénoncions Joe l’Indien, il nous tuerait un jour ou l’autre, j’en mettrais ma main au feu.
— C’est justement ce que je pensais, Huck. — Laissons parler Jack Potter.
— Jack Potter n’a rien vu, donc il ne pourra rien raconter, répliqua Tom.
— Hein ? Qu’est-ce que tu me chantes là ?
— Il venait d’être assommé lorsque Joe l’Indien a frappé le docteur. Comment veux-tu qu’il sache quelque chose ? Et puis le coup l’a peut-être tué,
— Je te parie que non, répondit Huck. Il était gris, comme toujours, et mon père avait l’habitude de dire que quand un individu est ivre, on lui cognerait la tête avec une église sans lui faire trop de mal.
Après avoir réfléchi un moment, Tom demanda :
— Huck, es-tu certain de pouvoir garder le secret ?
— Oh ! oui, car si j’ouvrais la bouche, Joe ne se gênerait pas pour me noyer comme un chien. N’aie pas peur, va, Tom ; je ne parlerai pas.
— N’importe, nous allons jurer de ne pas souffler mot.
— C’est cela, jurons.
Et joignant le geste à la parole, Huck leva la main et se disposa à prêter le serment demandé.
— Attends un peu, Huck ; il ne s’agit pas d’un petit serment de rien du tout, interrompit son compagnon. Pour une affaire sérieuse il faut des écritures et du sang.
L’occasion de signer un contrat de son sang ne se rencontre pas souvent ; elle ne se présentait même qu’une seule fois dans les livres que Tom avait lus. L’heure, le lieu, les circonstances donnaient en outre à la cérémonie un caractère solennel. Il s’empressa donc de ramasser un large copeau de bois blanc que les rayons de la lune semblaient lui désigner, chercha un bout de crayon parmi les trésors que contenaient ses poches et traça, avec beaucoup plus d’application qu’il n’en mettait d’ordinaire à ce genre d’exercice, les lignes suivantes :
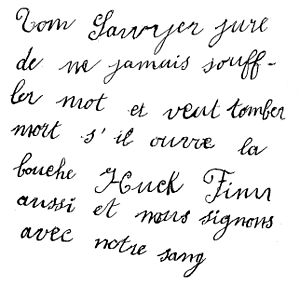
Huckleberry s’extasia devant la calligraphie de Tom et admira la clarté de son style.
— À présent, dit ce dernier, il s’agit de signer.
Il déroula le fil qui entourait une des aiguilles fichées dans le revers de sa jaquette, piqua son pouce, qu’il pressa afin d’en faire sortir une gouttelette de sang. Après avoir fait saigner la piqûre à diverses reprises, il parvint, à l’aide d’un clou qui lui servit de plume, à orner le document de ses initiales. Il guida ensuite la main de Huck qui traça, tant bien que mal, un H et un F. Le contrat qui liait la langue des deux témoins du meurtre fut enterré à l’endroit même où il avait été signé.
— Tom, demanda Huck, ça tient pour toujours ces machines-là ?
— Naturellement, puisque c’est signé avec notre sang. Quoi qu’il arrive, motus, à moins que tu n’aies envie de tomber mort.
Là-dessus les deux amis prirent congé l’un de l’autre, complètement oublieux du remède infaillible contre les poireaux qui avait motivé leur malencontreuse expédition.
Lorsque Tom se faufila dans sa chambre à coucher il faisait presque jour. Il se glissa dans le lit avec une prudence extrême, convaincu que personne ne se doutait de son escapade. Il ignorait que le doux Sid, qui ronflait alors comme un sabot, veillait depuis plus d’une heure.
Quand il rouvrit les yeux, son frère était levé et parti. Pourquoi ne l’avait-on pas appelé, comme d’habitude ? Tante Polly savait-elle quelque chose ? Il s’habilla en toute hâte et descendit. La famille se trouvait déjà à table. On ne lui adressa aucun reproche. Il s’assit et s’efforça de paraître gai. Vains efforts. Ses plaisanteries, ses sourires demeurèrent sans réponse. Évidemment Sid l’avait dénoncé.
Dès qu’il eut achevé son repas, sa tante le prit à part. Il espéra qu’il allait recevoir une correction. Son espoir ne se réalisa pas. Tante Polly commença par pleurer sur lui ; puis elle lui demanda comment il pouvait ainsi briser son vieux cœur et finit en l’engageant à continuer, s’il tenait à la voir descendre dans la tombe avant l’heure. Mille coups d’étrivière auraient produit moins d’impression sur Tom dont le cœur était plus sensible que la peau. Il pleura, promit de se réformer et fut congédié ; mais il comprit qu’il n’avait obtenu qu’un pardon incomplet et que ses promesses n’inspiraient qu’une faible confiance. Il se retira trop abattu pour garder rancune à Sid, de sorte que le dénonciateur aurait pu se dispenser de battre aussi promptement en retraite par la porte de derrière.
Ce fut le cœur gros et d’un pas alourdi que notre héros gagna l’école. La punition qui l’attendait pour avoir fait l’école buissonnière la veille ne le préoccupait guère.

Il la subit de l’air d’un homme qui supporte de si rudes épreuves que de pareilles bagatelles le laissent indifférent ; puis il s’installa à sa place, les coudes sur son pupitre, la mâchoire dans les mains, et se mit à contempler le mur avec le regard fixe d’un infortuné qui se demande s’il n’a pas atteint les dernières limites de la souffrance humaine. Son coude pressait une substance dure — peu lui importait une meurtrissure de plus ou moins ! À la longue, cependant, il changea de posture et prit d’un air distrait l’objet en question qui se trouvait enveloppé dans un vieux journal. Il déplia le papier. Un long soupir s’échappa de sa poitrine et son cœur se serra. C’était la belle boule de cuivre qui ornait naguère une paire de chenets désormais dépareillée. Cette dernière goutte d’amertume fit déborder le vase.
Chapitre XI
JACK POTTER
Un peu avant midi, la ville de Saint-Pétersbourg fut soudain mise en émoi par une horrible nouvelle. Personne, à l’époque où se passe ce récit, ne songeait au télégraphe électrique. Néanmoins, un courant invisible transportait la nouvelle de groupe en groupe, de maison en maison, avec presque autant de rapidité que si l’appareil de Morse ou celui de Hughes eût déjà fonctionné. Naturellement le maître d’école donna congé à ses élèves pour cet après-midi. Les citoyens de Saint-Pétersbourg auraient eu une piètre opinion de lui s’il eût agi autrement.
Un couteau couvert de sang avait été trouvé à quelques pas de la victime dont chacun déplorait la fin prématurée. La rumeur publique ajoutait que ce couteau avait été reconnu comme appartenant à Jack Potter, et qu’entre cinq et six heures du matin un citoyen attardé avait aperçu ledit Potter qui se lavait les mains au bord de la rivière et qui s’était enfui à son approche — circonstances bien faites pour éveiller des soupçons, surtout celle des ablutions, qui n’entraient pas dans les habitudes du vieil ivrogne. On ajoutait que les constables avaient parcouru la ville à la recherche du meurtrier — le public avait prononcé son verdict bien avant le jury — mais que l’on n’était pas encore parvenu à le découvrir.
Les curieux se dirigeaient vers le cimetière. Tom, oubliant que son cœur était brisé, se joignit à eux. Au fond, il aurait mille fois préféré suivre un autre chemin que celui-là ; mais une fascination inexplicable l’attirait. Arrivé à l’endroit fatal, sa petite taille lui permit de se faufiler à travers la foule, et il contempla le lugubre spectacle. Il lui sembla qu’un siècle s’était écoulé depuis la perpétration du crime dont il avait été témoin. Quelqu’un lui pinça tout à coup le bras et il se mit à frissonner. Il se retourna et son regard rencontra celui de Huckleberry. Ils feignirent de ne pas se reconnaître, se demandant si quelqu’un avait remarqué le coup d’œil qu’ils venaient d’échanger ; mais leurs voisins causaient, absorbés par la scène sinistre qui se déroulait devant eux.

Jack Potter
— Pauvre garçon ! disait l’un.
— Il nous aurait tous guéris, s’il avait vécu, disait un autre.
— Que cela serve de leçon aux voleurs de cadavres !
— Ce gredin de Potter sera pendu, si on le prend.
Telles furent quelques-unes des observations que l’on échangea. Soudain, Tom frissonna de nouveau à la vue du visage impassible de Joe l’Indien. Au même instant la foule se mit à osciller et des voix crièrent :
— C’est lui ! c’est lui ! il vient se livrer !
— Qui ? Qui ? demanda-t-on.
— Jack Potter !
— Le voilà qui s’arrête ! Attention — ne le laissez pas partir.
Des spectateurs, perchés dans les branches d’un arbre au-dessous duquel se tenait Tom, déclarèrent que l’assassin ne faisait pas mine de s’éloigner. Il semblait seulement ahuri et perplexe.
— Quel aplomb infernal ! s’écria un des membres du jury populaire. Oh ! les meurtriers commettent toujours de ces bévues-là. Il ne comptait pas trouver tant de monde ici !
La foule s’écarta et le shérif s’avança, tenant Potter par le bras. Le visage du pauvre diable était livide et révélait la peur qu’il ressentait. Lorsqu’il se trouva en face du cadavre du docteur, un tremblement convulsif agita tous ses membres ; il se cacha le visage dans les mains et fondit en larmes.
— Je n’y suis pour rien, mes amis, dit-il en sanglotant, ma parole d’honneur, ce n’est pas moi. Je n’ai jamais voulu le tuer.
— Qui vous accuse ? dit une voix dans la foule. Le coup parut porter. L’ivrogne leva la tête et jeta autour de lui un regard hébété : il aperçut Joe et s’écria :
— Ah, Joe l’Indien, tu m’avais promis…
— Ce couteau est-il à vous ? demanda le shérif, qui tenait à la main la pièce de conviction.
Potter chancela sur ses jambes ; il serait tombé si on ne l’avait pas soutenu et aidé à s’asseoir par terre.
— Quelque chose me disait que si je ne venais pas le chercher…, murmura-t-il.
Puis il leva les bras avec le geste découragé d’un homme qui s’avoue vaincu et ajouta :
— Tu peux leur raconter comment les choses se sont passées, Joe c’est pas la peine de lutter contre le sort…
Alors, Tom et Huckleberry, muets de stupeur, les yeux écarquillés, entendirent l’assassin donner, avec une sérénité imperturbable, une foule de détails mensongers sur le meurtre de la veille. Bien qu’aucun nuage ne ternît l’azur transparent du ciel, ils s’attendaient à chaque minute à voir la foudre écraser le faux témoin et s’étonnaient que la vengeance divine fût si tardive. Tout d’abord ils furent tentés de manquer à leur serment et de disculper le prisonnier ; mais lorsque Joe, après avoir terminé son récit sans sourciller, demeura sain et sauf, ils ne songèrent plus à le dénoncer. Il était clair que ce mécréant avait vendu son âme au diable et qu’il serait dangereux de s’attaquer à lui.
— Pourquoi n’êtes-vous pas parti ? Pourquoi êtes-vous revenu ? demanda quelqu’un à Potter.
— Ah ! pourquoi ! répéta le malheureux. Je n’ai pas pu m’en empêcher. J’ai voulu me sauver et mes jambes m’ont ramené ici.
Quelques minutes plus tard, sous le sceau du serment, Joe l’Indien répéta sa déposition devant le jury d’enquête avec le même calme que la première fois. Notre héros et son ami, voyant que le ciel ne s’ouvrait pas pour foudroyer le faux témoin, demeurèrent plus persuadés que jamais qu’il avait vendu son âme au diable.
Joe l’Indien aida à relever le cadavre du malheureux qu’il avait assassiné et à le poser sur le brancard qui était resté là. Un frémissement parcourut la foule lorsqu’un spectateur déclara que la blessure avait saigné. Huck espéra que cet indice infaillible allait mettre la justice sur la voie ; mais une vieille femme s’écria : « Cela n’est pas étonnant, puisque Jack Potter se trouvait à moins de trois pieds de sa victime » ; et la manifestation cadavérique, réelle ou imaginaire, fut attribuée au voisinage de l’infortuné ivrogne.
Pendant plusieurs semaines le sommeil de Tom fut sans cesse troublé. Un matin, à déjeuner, Sid adressa à ce sujet des reproches à son frère.
— Tom, tu te remues toute la nuit et tu parles tant dans ton sommeil que tu m’empêches de dormir.
Tom pâlit.
— C’est mauvais signe, dit tante Polly. Qu’as-tu sur la conscience ? — Rien, rien du tout, répliqua Tom.
Mais sa main trembla tellement qu’il versa sur la nappe la moitié du contenu de sa tasse de café.
— Et puis tu marmottes un tas de bêtises, reprit Sid. Hier tu as crié je ne sais combien de fois : « C’est du sang ! » et après tu as dit : « Ne me tourmentez pas, je raconterai tout ». Qu’est-ce que tu raconteras ?

Joe l’Indien
Par bonheur, tante Polly vint sans le savoir à l’aide de son neveu.
— Bah ! dit-elle, cet affreux assassinat lui donne le cauchemar. Tâche de ne plus y penser, Tom.
Tom n’aurait pas mieux demandé que de ne plus y penser ; mais ses compagnons de classe ne se fatiguaient jamais de tenir des enquêtes sur un chien ou un chat mort et de raviver ainsi ses tristes souvenirs. Sid remarqua que Tom refusait de remplir l’emploi de coroner dans ces enquêtes, si habitué qu’il fût à accaparer le rôle principal dans tous les jeux nouveaux. Il remarqua aussi que Tom s’abstenait de figurer, même comme témoin, et, dans ces enquêtes, qu’il évitait d’y assister en qualité de simple spectateur. Enfin les enquêtes cessèrent d’être de mode et de torturer la conscience de Tom.
Tous les jours ou tous les deux jours, Tom saisissait une occasion favorable pour courir à la fenêtre grillée de la geôle et pour jeter à l’assassin les bons morceaux dont il avait pu s’emparer. Les offrandes qu’il apportait ainsi en cachette contribuaient beaucoup à calmer ses remords. La geôle était un petit édifice en briques situé à l’entrée de la ville, et comme elle était rarement occupée, on réduisait autant que possible les frais de garde. Personne d’ailleurs ne songeait à délivrer le prisonnier ou à devancer l’arrêt de la justice par une exécution sommaire. Le shérif le savait. Il savait également que ses administrés n’auraient pas demandé mieux que de pendre Joe l’Indien ; mais Joe était si redouté que nul n’osait prendre l’initiative. Il avait eu soin, en racontant la lutte dont il prétendait n’avoir été que le témoin, de ne pas se compromettre, et l’on avait ajourné le procès dans l’espoir de l’incriminer comme résurrectionniste.
Chapitre XII
TANTE POLLY, MÉDECIN
Si le cauchemar qui avait troublé le sommeil de Tom ne pesait plus sur lui, c’est qu’un nouvel intérêt l’absorbait. Becky Thatcher avait cessé de venir à l’école. On la disait malade. Si elle allait mourir ? Cette pensée désespérait notre héros, qui ne songea plus à se faire clown, chef d’une tribu sauvage ou même pirate. Il laissa de côté son cerceau, sa balle, ses billes. Tante Polly s’inquiéta ; elle le crut indisposé et lui administra toutes sortes de remèdes. C’était une de ces bonnes âmes qui ont foi dans les médecines brevetées. On n’inventait aucune drogue qu’elle n’eût envie d’essayer, non sur elle-même — car sa santé ne laissait rien à désirer — mais sur quiconque lui tombait sous la main. Elle recevait une de ces feuilles périodiques qui apprennent à leurs abonnés à mourir sans l’aide du médecin, et prenait pour paroles d’Évangile les réclames que les charlatans font insérer dans ces publications populaires. Forte de ses connaissances hygiéniques, elle prodiguait les consultations gratuites au grand dommage de ses voisins.
À cette époque, une nouvelle panacée devenait à la mode. Tante Polly avait appris que l’hydrothérapie était un spécifique souverain contre l’apathie et contre bien d’autres malaises. Tom avait évidemment besoin de stimulants. Chaque matin, au saut du lit, il fut installé devant une des cloisons du bûcher, inondé d’eau froide et frotté avec une serviette de grosse toile qui produisait l’effet d’une râpe et donnait à sa peau la couleur d’un homard bouilli. Ensuite on enveloppait le patient dans un drap mouillé, on le roulait dans une couverture et on le laissait transpirer selon la formule.
En dépit de ce traitement énergique, Tom se montra de plus en plus triste, de plus en plus découragé, de plus en plus énervé. Tante Polly consulta son journal et ajouta au déluge d’eau froide des bains chauds. Tom ne retrouva pas sa gaieté d’autrefois. Tante Polly aida l’hydrothérapie en astreignant le malade à un régime sévère et en lui collant sur la peau divers papiers chimiques. Elle lui fit en outre avaler plus de médecines brevetées qu’il n’en fallait pour guérir ou tuer un cheval.
À la longue, Tom se soumit avec indifférence à une persécution sanitaire contre laquelle il s’était d’abord révolté. Cette phase inattendue de la maladie consterna la vieille dame. À tout prix il importait de vaincre une inertie aussi alarmante. Par bonheur elle entendit alors parler du fameux Élixir réconfortant. Elle s’en procura aussitôt plusieurs flacons. Elle goûta l’élixir et bénit l’inventeur. C’était tout simplement du feu liquide. Elle délaissa l’hydrothérapie et les autres remèdes en faveur de l’élixir. Elle en donna une cuillerée à Tom et attendit le résultat avec une vive anxiété. Le résultat fut tel que l’inquiétude dont elle souffrait depuis plusieurs semaines s’évanouit en un clin d’œil. L’indifférence de Tom semblait vaincue — il s’était mis à danser et à gambader.
— Tu vois, dit tante Polly ; j’ai enfin mis la main sur le bon remède ; rien ne résiste à cela.
Tom, en proie à un incendie intérieur, sentit qu’il serait temps de se réveiller. L’existence négative qu’il menait pouvait convenir à des malheureux qui, comme lui, ne s’intéressaient plus à quoi que ce fût ; mais il commençait à en avoir assez et à trouver qu’on l’assujettissait à des épreuves par trop variées. Il songea donc à se soustraire aux expériences de sa tante et résolut de feindre d’aimer l’élixir réconfortant. Il en demanda si souvent que sa tante finit par l’inviter à se servir lui-même et à la laisser tranquille. S’il se fût agi de Sid, elle n’aurait redouté aucun subterfuge ; mais elle se méfiait de Tom et surveilla en cachette le flacon. Elle vit que le niveau de l’élixir s’abaissait avec une régularité satisfaisante et l’idée ne lui vint pas que le malade se servait de la médecine pour guérir une fente qui existait dans le plancher du parloir.
Un jour que Tom était en train d’administrer une dose à la fente en question, le chat jaune de sa tante s’approcha en ronronnant et regarda la cuiller d’un œil plein de convoitise. Tom lui dit :
— N’en demande pas, Roméo, si tu n’en veux pas.

L’élixir réconfortant.
Mais Roméo donna à entendre qu’il en voulait.
— Bien sûr ?
Roméo ronronna.
— Alors je vais te céder ma part, parce que je ne suis pas un goulu. Seulement, si la médecine te déplaît, tu ne t’en prendras qu’à toi ?
Roméo accepta cette condition. Tom le prit d’une main caressante, le tint serré entre ses genoux, lui ouvrit la mâchoire et lui versa dans le gosier une cuillerée de l’élixir. Roméo se dégagea, sauta à une hauteur de deux pieds, poussa un miaulement qui ressemblait au cri de guerre d’un Peau-Rouge et courut à travers la chambre en bondissant par-dessus les meubles ; puis il se dressa sur ses pattes de derrière, exécuta un cavalier seul qu’un maître de danse eût certes admiré, et laissa échapper un second miaulement que Tom regarda comme une expression de joie ineffable. Après avoir ainsi remercié son bienfaiteur, le chat se livra à une nouvelle course au clocher. Tante Polly arriva juste à temps pour voir son favori exécuter une dernière pirouette et s’enfuir par la croisée en entraînant deux pots de fleurs, Elle demeura muette de surprise, regardant par-dessus ses lunettes et se demandant si elle devait en croire ses yeux. Tom, qui se roulait par terre et se tenait les côtes, fut bien vite debout.

Tom, qu’a donc Roméo ?
— Tom, qu’a donc Roméo ? demanda la vieille dame.
— Je ne sais pas… J’ai tant ri que je n’en puis plus. — Je ne l’ai jamais vu se démener de la sorte. Que lui est-il arrivé ?
— Il a peut-être vu une souris. Les chats dansent quand ils voient une souris… du moins on me l’a dit.
Tom ne riait plus ; sa tante, qui regardait autour d’elle d’un air soupçonneux, venait d’apercevoir le flacon. Bientôt elle ramassa la cuiller révélatrice et la brandit d’un geste menaçant. Tom baissa les yeux. Il se sentit soulevé par l’oreille et reçut deux ou trois coups de cuiller sur la tête.
— Voyons, comment as-tu pu traiter ainsi un pauvre animal qui ne peut pas se plaindre ?
— Je l’ai fait par charité, parce qu’il n’a pas de tante.
— Pas de mauvaises plaisanteries, Tom !
— Ce n’est pas une plaisanterie. J’ai eu pitié de lui, parce qu’il n’a personne pour lui brûler l’estomac avec un tas de drogues.
Tante Polly éprouva un remords de conscience. La situation lui apparut sous un nouveau jour. S’il y avait de la cruauté à droguer un chat, peut-être n’était-il pas moins cruel de bourrer son neveu de remèdes. Elle s’attendrit, une larme mouilla ses yeux ; elle posa la main sur la tête de Tom et dit d’un ton ému :
— J’ai agi pour le mieux, et puis cela t’a fait du bien.
Tom regarda à la dérobée l’endroit où il avait versé tant de cuillerées d’élixir et répliqua avec beaucoup de gravité :
— Je sais que tu as agi pour le mieux, ma tante ; moi aussi, et cela a fait du bien à Roméo. C’est la première fois qu’il danse.
— Allons, vilain garnement, je vois que tu n’as plus besoin de médecine. Cours à l’école et tâche de ne plus me chagriner.
Tom arriva à l’école avant l’heure de la classe. Du reste, depuis quelque temps, il se présentait toujours un des premiers et son exactitude inusitée avait attiré l’attention de ses camarades. Ces derniers remarquaient aussi qu’au lieu de jouer comme autrefois avec eux, il rôdait seul à l’entrée de la cour. Il se disait malade. Ce jour-là, il se tint à son poste habituel, surveillant la route. Chaque fois qu’une robe se montrait à l’horizon, il était prêt à danser de joie ; mais dès que la robe se rapprochait, il retombait dans son abattement. Enfin, les robes cessèrent d’apparaître et il entra dans la salle d’étude déserte pour broyer du noir tout à son aise en regardant par la croisée. À peine se fut-il installé qu’il vit arriver Becky. L’instant d’après, il était dehors, criant, courant, riant, décoiffant ses camarades, bondissant par-dessus la clôture, se tenant debout sur la tête, bref, exécutant les nombreux tours de force qu’une longue expérience lui avait rendus faciles. Becky ne semblait pas faire la moindre attention à lui. Se pouvait-il qu’elle ignorât sa présence ? Il porta ses exploits dans le voisinage immédiat de la nouvelle venue ; il décrivit des cercles autour d’elle en poussant des cris effroyables ; il saisit la première casquette qui lui tomba sous la main et la lança sur le toit de l’école ; il se précipita tête baissée au milieu d’un groupe de joueurs, les culbuta dans toutes les directions et vint s’abattre aux pieds de celle qu’il voulait charmer et qu’il faillit renverser. Ce fut à peine si Becky daigna regarder l’acrobate déconfit ; mais elle hocha la tête d’un air dédaigneux. Le sang monta aux joues de Tom. Il se releva et s’éloigna l’oreille basse.
Chapitre XIII
LE REPAIRE DES PIRATES
La résolution de Tom était prise. Tout le monde le repoussait. Soit. Il mènerait désormais l’existence d’un proscrit. Lorsqu’on apprendrait son départ, on se repentirait peut-être de l’avoir poussé à bout. Tandis qu’il se livrait à ses sombres réflexions, le futur proscrit était arrivé à une certaine distance de la ville, et la cloche de l’école résonna au loin pour appeler les élèves à la classe du soir. L’idée qu’il n’entendrait plus, jamais plus, ces sons familiers l’attrista. C’était dur, mais on l’y forçait.
Soudain il se trouva face à face avec Joe Harper, qui, lui aussi, avait à se plaindre de ses semblables, à en juger par sa mine renfrognée. Tom s’empressa d’annoncer à son ami intime qu’il était décidé à se soustraire aux mauvais traitements et au manque de sympathie. Il ne savait pas encore où il dirigerait ses pas ; mais il allait s’éloigner pour ne plus revenir.
Or, par un étrange hasard, Joe Harper courait depuis deux heures à la recherche de Tom, à qui il voulait adresser une confidence du même genre. Il venait de recevoir une correction humiliante — et cela sans motif encore — on l’accusait d’avoir bu un bol de lait dont il ignorait jusqu’à l’existence ! Puisque sa mère était lasse de lui, il s’en irait. Il espérait seulement que l’injustice qu’elle avait commise ne causerait pas trop de remords à la coupable. Les deux martyrs, après s’être apitoyés sur leur destinée, firent serment de ne se séparer que lorsque la mort viendrait mettre un terme à leurs souffrances. Joe aurait voulu se faire ermite, se réfugier dans une caverne où il se nourrirait de racines et périrait un jour ou l’autre de chagrin. Tom lui rappela qu’un ermite doit se passer de compagnons, lui démontra qu’une vie de crime présentait des avantages évidents, et son ami reconnut qu’il valait mieux devenir pirate. Il objecta toutefois que si un ermite doit se passer de compagnons, des pirates ne peuvent se passer d’un navire.
— Le navire viendra plus tard, riposta Tom. J’ai déjà trouvé un repaire, c’est là l’essentiel. Que penses-tu de l’île Jackson ?

Le serment
— Fameux ! répliqua Joe Harper. Il n’y pousse pas de légumes ; mais nous y trouverons plus de poissons et d’œufs de tortue qu’il ne nous en faudra.
À une lieue au-dessous de Saint-Pétersbourg, à un endroit où le Mississippi n’a guère qu’un mille de largeur, s’étend une longue île boisée dont une plage basse, située à une de ses pointes, rend l’abord facile. Elle offrait un abri d’autant plus sûr que personne ne l’habitait, et elle touchait presque l’autre rive du fleuve, en face d’une forêt non exploitée. Certes, nos forbans ne pouvaient souhaiter un meilleur repaire. Quant à savoir quelles seraient les victimes de leurs pirateries, c’était là un détail dont nos deux écoliers ne se préoccupèrent pas pour le moment.
— Je songe à une chose, dit Tom, lorsque le point capital eut été réglé. Nous ne sommes que deux, ce n’est pas assez.
— Tâchons d’enrôler Huck, répliqua Joe. Il s’agit seulement de le décider assez tôt. Si je ne pars pas ce soir, je suis capable de ne plus vouloir partir du tout.
— Sois tranquille, répondit Tom. Nous avons du temps de reste. Les pirates ne se mettent jamais en route en plein jour. Huck sera ravi d’en être. C’est justement l’homme qu’il nous faut ; il connaît notre repaire mieux que nous.
En effet, Huckleberry Finn, qu’ils rencontrèrent flânant sur la grande place, consentit sans peine à se joindre à eux, car toutes les carrières lui semblaient bonnes, pour peu qu’elles eussent le charme de la nouveauté. Tom exposa son plan de campagne, et il fut décidé qu’ils se retrouveraient à minuit — l’heure de crime — à un endroit désert situé à deux milles au-dessus de la ville. Il y avait là un petit radeau dont on s’emparerait à l’abordage, afin de gagner le repaire. Chacun devait apporter sa canne à pêche et les vivres qu’il pourrait se procurer.
Vers minuit, Tom arriva avec un jambon bouilli et diverses autres provisions. Son premier soin fut de se cacher dans un épais taillis au sommet d’une colline qui dominait le lieu du rendez-vous. Les étoiles brillaient et rien ne bougeait. Il prêta l’oreille ; aucun bruit ne troublait le silence. Alors il siffla doucement. Un coup de sifflet lui répondit du bas de la colline. Il répéta deux fois ce signal avec le même résultat, puis une voix cria :
— Qui va là ?
— Tom Sawyer, le corsaire noir ! Nommez-vous !
— Huck Finn aux mains rouges !
— Joe Harper, la terreur des mers !
C’est Tom qui avait fourni à ses complices ces surnoms empruntés à un de ses livres favoris.
— C’est bien. Donnez le mot d’ordre.
Deux voix caverneuses répliquèrent en chœur :
— Sang et tonnerre !
Sur ce, Tom, lançant son jambon le long de la colline escarpée, prit le même chemin, au grand dommage de sa peau et de ses vêtements. Il aurait pu rejoindre ses amis en suivant un sentier très commode ; mais cette route n’offrait aucun des dangers, aucune des difficultés que recherchent les flibustiers.
Terreur-des-mers avait apporté une flèche de lard et un petit sac de biscuits. Finn aux mains rouges s’était approprié une poêle à frire, une quantité de tabac en feuilles et des balles de maïs dont on se sert aux États-Unis pour fabriquer des fourneaux de pipe. Corsaire-Noir, à la vue d’un foyer qui couvait sur la plage, s’écria :
— Mille sabords ! j’ai oublié d’emprunter un briquet et de l’amadou. Il faut nous procurer les moyens d’allumer un feu de bivouac. Que serions-nous devenus si je n’avais pas songé à cela ?
Nos pirates se dirigèrent donc vers le brasier à moitié éteint. L’expédition fut menée d’une façon très imposante. On s’arrêtait de temps à autre, un doigt sur les lèvres ; on se remettait en route à pas de loup, la main sur le manche d’un poignard imaginaire ; on se baissait pour écouter.
— Chut ! disait Tom ; si l’ennemi bouge, enfoncez la lame jusqu’à la garde !
Il savait fort bien que les débardeurs se trouvaient dans la ville, en train de boire ; mais ce n’était pas une raison pour ne pas agir en vrais forbans.
Après avoir ainsi débuté dans la carrière du crime en dérobant quelques tisons qui furent déposés avec soin dans la poêle à frire, on gagna le radeau et on fit voile, pour employer l’expression du capitaine. Joe pagayait à l’avant, Huck à l’arrière. Tom commandait. Debout sur la passerelle — c’est-à-dire au centre du radeau — il se tenait les bras croisés, les sourcils froncés, donnant ses ordres. — Lofez !… Barre à tribord !… Ferlez les huniers… Toutes voiles dehors !… Pare à virer !
Comme l’équipage se bornait à amener le radeau dans le courant, il semblait entendu que ces ordres n’étaient donnés que pour la forme. Nos nautoniers, du reste, savaient conduire une embarcation et ne traversaient pas pour la première fois le Mississippi. Le radeau gagna le milieu du fleuve ; les rameurs pointèrent leurs avirons dans la direction de l’île et cessèrent de pagayer, laissant agir le courant qui les menait vers l’île. On se tut tandis que le radeau passait devant la petite ville endormie dont quelques faibles lueurs indiquaient l’emplacement. Corsaire-Noir, les bras toujours croisés, jetait « un dernier regard » sur le théâtre de ses souffrances passées. Il souhaitait que Becky pût le voir bravant les colères de l’Océan, avec un sourire amer sur les lèvres. Il n’eut pas un grand effort d’imagination à faire pour transporter l’île Jackson à une distance incalculable de Saint-Pétersbourg. Ses compagnons contemplèrent la petite ville avec des idées moins romanesques. Ils la contemplèrent même si longtemps, qu’ils faillirent dépasser la pointe de l’île et se laisser entraîner par le courant ; mais ils découvrirent le danger assez tôt pour l’éviter. Vers une heure et demie du matin, le radeau échoua sur la barre à une centaine de mètres de l’endroit où ils voulaient aborder. Les corsaires durent accomplir plusieurs voyages, plongés dans l’eau jusqu’à la ceinture, afin de débarquer leur légère cargaison. Une partie du gréement du radeau se composait d’une vieille voile dont on s’empara et qui, étendue entre deux arbres, devait servir de tente pour abriter les provisions. Quant aux flibustiers, ils comptaient dormir à la belle étoile, selon la coutume des gens de leur profession.
Après avoir allumé un grand feu dans une éclaircie du bois, ils apprêtèrent quelques tranches de lard dans la poêle à frire et diminuèrent considérablement leur provision de biscuits. Ils étaient fiers de se régaler ainsi en toute liberté, sur une île déserte, loin des lieux fréquentés par les hommes, et ils déclarèrent qu’ils renonçaient à jamais à la vie civilisée. Les flammes du foyer éclairaient leurs visages d’une lueur rougeâtre qui leur donnait le teint de gens habitués à affronter tous les climats. Du moins, c’est ce qu’affirma Tom.

Les pirates
Lorsque la dernière tranche de lard et la ration de biscuit eurent disparu, les corsaires s’étendirent sur l’herbe avec un soupir de satisfaction béate. Ils auraient pu trouver un lieu de repos plus frais ; mais un feu de camp leur semblait une des nécessités pittoresques de la situation.
— Que diraient les autres, s’ils nous voyaient ! s’écria Joe Harper. — Ce qu’ils diraient ? répliqua Tom. Ils mourraient d’envie de nous rejoindre, pus vrai, Hucky ?
— Tu peux le parier. En tout cas, le métier de pirate me va. On a de quoi manger, et il n’y a pas ici un tas de gens pour me rembarrer sans cesse.
— C’est justement là l’avantage d’une île déserte, dit Tom. On se lève, on se couche quand on veut. Pas d’école et personne pour coudre votre col de chemise avec du fil blanc ou du fil noir, afin de découvrir si vous vous êtes baigné en cachette.
— J’aime mieux être un pirate qu’un ermite, maintenant que j’ai essayé, dit Joe Harper.
— Je crois bien ! Vois-tu, un ermite serait obligé de dormir sur la pierre la plus dure de l’île, de vivre tout seul, de se cingler les épaules à coups de corde, de porter une robe qui lui écorcherait la peau et de s’arroser la tête de cendres.
— Pourquoi ça ? demanda Huck.
— Je n’en sais rien. Tous les ermites le font.
Huck ne poussa pas plus loin son interrogatoire. Il venait de vider une balle de maïs, d’y adapter un roseau, de la bourrer de tabac, et il allumait sa pipe. Il aspira la fumée d’un air si satisfait, que ses compagnons résolurent d’acquérir avant peu ce talent viril. Enfin il demanda :
— Qu’est-ce que les pirates ont à faire ?
— Ils n’ont qu’à s’amuser, répliqua Tom. Ils prennent à l’abordage les navires qu’ils rencontrent ; ils emportent dans leur repaire les piastres, les bijoux et les plats d’or ; ils tuent ceux qui leur résistent et les jettent à l’eau.
— Ils ne tuent pas les femmes, ajouta Joe Harper.
— Jamais, dit Tom. Ils sont trop généreux pour leur faire le moindre mal.
— Et les femmes aiment les pirates, parce qu’ils portent des habits plus beaux que ceux des écuyers du cirque, des habits tout couverts d’or et de diamants, reprit Joe.
Huck jeta un regard penaud sur son pantalon rapiécé.
— Je n’ai pas l’air d’un pirate, dit-il.
Ses amis le rassurèrent. Pour commencer, il n’y avait pas besoin d’être bien mis, quoique certains pirates eussent l’habitude de se munir dès le début d’une riche garde-robe.
Pau à peu la conversation devint moins animée ; les paupières des jeunes fugitifs s’alourdirent. La pipe glissa entre les doigts de Huck, qui fut le premier à fermer les yeux. Terreur-des-mers et Corsaire-Noir eurent plus de peine à s’endormir. Chaque fois que le sommeil approchait, un intrus venait le chasser. Cet intrus était la conscience, qui leur adressait déjà de vagues reproches. Enfin, la fatigue aidant, ils s’assoupirent à leur tour.
Chapitre XIV
SYMPTÔMES DE NOSTALGIE
Lorsque Tom se réveilla le lendemain matin, il demeura tout étonné de ne pas se retrouver dans sa chambre. Il se redressa et se frotta les yeux. Il faisait à peine jour ; l’aube grise transformait le paysage que le feu du bivouac avait éclairé la veille. L’air était frais ; pas une feuille ne bougeait, aucun bruit ne troublait le silence de la forêt. La rosée émaillait de perles les feuillages et les hautes herbes. Une couche de cendres blanches couvrait le foyer, d’où montait en ligne droite une mince colonne de fumée bleue. Joe et Huck dormaient encore. Bientôt la voix d’un oiseau se fit entendre ; d’autres oiseaux répondirent à cet appel. Peu à peu l’aube blanchit. Le merveilleux spectacle de la nature secouant le sommeil se révéla aux yeux du jeune spectateur. Une petite chenille d’un vert d’émeraude se mit à onduler sur une feuille humide de rosée, soulevant par moments les deux tiers de son corps en l’air, flairant à droite et à gauche, puis continuant sa promenade. Elle se dirigea vers Tom, qui se tint immobile. À plusieurs reprises elle parut sur le point de changer de route et il se dépita. Enfin l’insecte, après avoir longuement réfléchi, la tête en l’air, s’aventura sur la jambe de Tom et monta le long de son pantalon, de son gilet, de sa jaquette. Notre écolier ne se sentit pas de joie. « Elle prend ma mesure », se dit-il. Sans nul doute il allait être avant peu habillé à neuf et endosser un superbe uniforme de pirate ! Bientôt une procession de fourmis se montra. Elles marchaient toutes dans la même direction avec cet air affairé qui les distingue, courant çà et là comme des gens qui ont perdu quelque chose, mais qui sont trop pressés pour se livrer à des recherches sérieuses. Une seule d’entre elles avait fait une trouvaille — une araignée morte, cinq fois plus grosse qu’elle — et luttait bravement pour escalader une pierre sans lâcher son butin. Une coccinelle aux élytres brunes tachetées de noir avait grimpé à une hauteur vertigineuse… jusqu’au sommet d’un brin d’herbe. Tom se pencha sur elle et lui dit :
Bête à bon Dieu, regagne ta demeure,
Ta maison brûle et ta famille pleure.
La coccinelle s’envola aussitôt et alla voir ce qui en était. Tom n’éprouva aucune surprise. Il savait de vieille date que les coccinelles sont crédules en fait d’incendie, et ce n’était pas la première fois qu’il abusait ainsi de leur naïveté. Ensuite vint un vilain scarabée, ou plutôt la compagne d’un vilain scarabée, qui se donnait beaucoup de mal pour rouler en lieu de sûreté une boule de fumier où elle avait déposé ses œufs. Tom toucha l’insecte afin de le voir ramener ses pattes sous son abdomen et faire le mort. Il tourmentait sans scrupule les pauvres bêtes qui lui tombaient sous la main ; mais pour rien au monde il ne les aurait tuées, surtout en plein air, où elles étaient chez elles, ainsi que le répétait tante Polly.
Pendant que Tom se livrait à ces expériences entomologiques, la gent emplumée avait entonné son concert matinal et s’en donnait à cœur joie. Un oiseau moqueur, le mimus carolinensis, qui appartient à la famille des merles, s’abattit sur un arbre au-dessus de la tête de Tom et imita ses voisins avec un talent qui dut les tromper. Puis un geai passa comme un éclair bleu, se percha sur un rameau presque à la portée de notre pirate, pencha la tête et examina les étrangers d’un air goguenard. Deux écureuils gris, qui se poursuivaient de branche en branche, s’arrêtèrent et s’assirent pour inspecter les intrus. C’était sans doute la première fois qu’ils voyaient un être humain et ils ne savaient pas s’ils devaient s’effrayer. La nature était bien réveillée maintenant ; le soleil dardait de longs rayons qui perçaient çà et là l’épais feuillage et quelques papillons vinrent égayer la scène.
Tom secoua ses compagnons, qui furent bien vite debout. Deux ou trois minutes plus tard nos corsaires étaient déshabillés et s’ébattaient dans l’eau limpide du Mississippi, sur un banc de sable blanc. Un courant ou une crue passagère avait emporté leur radeau. Loin de se désoler, ils se félicitèrent de cet accident qui brûlait, pour ainsi dire, leurs vaisseaux.
Ils regagnèrent leur camp, le cœur léger et très affamés. Le feu du bivouac flamba bientôt de nouveau. Huck découvrit une source d’eau fraîche ; on fabriqua des coupes avec les larges feuilles d’un rumex et l’on déclara que cette simple boisson, servie dans des tasses d’une forme aussi inusitée, remplaçait avantageusement le café. Joe venait de découper quelques tranches de lard pour le déjeuner, quand Tom et Huck l’engagèrent à ne pas se presser. Ils se dirigèrent vers une anse et tendirent leurs lignes. Joe n’avait pas eu le temps de s’impatienter, lorsqu’ils revinrent avec plusieurs belles carpes, deux perches et un petit brochet : de quoi fournir un repas à une nombreuse famille. Ils firent frire les carpes avec le lard et furent surpris de le trouver si bon, car jamais poisson ne leur avait semblé plus délicieux. Ils ignoraient combien le poisson de rivière gagne à être apprêté au sortir de l’eau. Ils ne songeaient pas non plus que l’exercice en plein air, un bain froid et une forte dose d’appétit sont une sauce merveilleuse.
Leur repas terminé, ils se reposèrent à l’ombre d’un chêne, tandis que Huck fumait sa pipe, puis ils partirent pour un voyage d’exploration. Ils errèrent à l’aventure sous les arbres, se frayant un chemin à travers les buissons, écartant les vignes folles ou d’autres plantes grimpantes qui, après s’être enroulées autour d’un tronc d’arbre, retombaient en festons du haut des branches. Parfois ils rencontraient des éclaircies tapissées d’herbe et émaillées de fleurs.
L’île avait environ trois milles de long sur un quart de mille de large et n’était séparée de la terre ferme la plus proche que par un étroit

Les pirates à l’œuvre
canal dont la largeur ne dépassait nulle part deux cents pieds. Nos corsaires profitaient de leur liberté pour prendre un bain toutes les heures, de sorte que l’après-midi était à moitié écoulé lorsqu’ils regagnèrent leur camp. Ils avaient trop faim pour pêcher ; ils se rabattirent sur le jambon et les biscuits, dont ils se régalèrent copieusement ; puis ils s’allongèrent sur l’herbe pour causer. Mais l’entretien ne tarda pas à languir. Le calme solennel des bois et le sentiment de la solitude agissaient sur l’esprit des explorateurs fatigués. Ils se mirent à songer. Une tristesse dont ils ne comprenaient pas le motif s’empara d’eux et prit bientôt une forme moins vague. La nostalgie du foyer domestique se faisait déjà sentir. Finn aux mains rouges lui-même rêvait aux granges et aux hangars hospitaliers de Saint-Pétersbourg.
Depuis quelque temps ils avaient conscience d’un bruit sourd qui semblait venir de loin et auquel ils ne prêtèrent d’abord qu’une attention peu soutenue. Comme le bruit mystérieux, qui se renouvelait à des intervalles assez réguliers, allait se rapprochant, ils se regardèrent d’un air interrogateur et tendirent l’oreille. Une sourde détonation retentit de nouveau et parut rouler le long du fleuve.
— D’où ça peut-il venir ? demanda Joe.
— Chut ! dit Tom. Ne parlons pas, écoute.
Ils attendirent pendant quelques minutes ; le même son voilé par la distance troubla le silence du bois.
— Allons voir, s’écria Joe.
Ils coururent du côté de l’île le plus rapproché de la ville et regardèrent le long du fleuve. Le petit steamer qui servait de bac entre les deux rives du fleuve se montrait à un mille au-dessous de Saint-Pétersbourg et suivait doucement le courant. Il y avait beaucoup de monde sur le pont et un grand nombre de barques, montées par des rameurs ou marchant à la voile, escortaient le vapeur ; mais on ne pouvait distinguer le mouvement des équipages. Bientôt un jet de fumée blanche s’échappa de l’avant du petit navire et, tandis que la fumée se dilatait en formant un léger nuage, le bruit se répéta.
— Je sais ce qu’ils cherchent, s’écria Tom.
— Moi aussi, dit Huck. Ils cherchent un noyé et tirent le canon pour le faire remonter. Ils ont essayé ça l’été dernier quand Bill Turner a disparu. — Je voudrais joliment savoir qui c’est ! dit Joe, lorsqu’on eut en vain attendu une nouvelle détonation.
Tom eut tout à coup une idée lumineuse.
— Quelle chance ! s’écria-t-il. Les noyés, c’est nous !
Nos pirates se sentirent aussitôt transformés en héros. Quel triomphe ! On les cherchait, on les regrettait ; on se rappelait les actes de cruauté, d’injustice dont ils avaient été victimes ; on s’abandonnait à des remords tardifs.

Quelle chance !
Bien mieux, les pirates méconnus étaient le sujet de toutes les conversations, et leur brillante notoriété devait exciter l’envie de leurs camarades. Cela valait la peine d’être pirates !
Vers l’heure du crépuscule le vapeur retourna à son poste habituel, les barques disparurent et les pirates regagnèrent leur camp, très fiers de la célébrité qu’ils avaient acquise. Une pêche abondante leur fournit un souper auquel ils se sentaient disposés à faire honneur. Leur faim apaisée, ils se remirent à bavarder, cherchant à deviner ce que l’on disait d’eux à Saint-Pétersbourg. Les tableaux qu’ils se tracèrent de l’anxiété publique semblaient flatter leur amour propre ; mais lorsque la nuit vint, ils cessèrent peu à peu de jaser, et, bien que leurs regards restassent fixés sur le feu du bivouac, leur pensée voyageait vers un foyer plus familier. Leur repaire avait déjà perdu le prestige de la nouveauté. Tom et Joe ne purent s’empêcher de songer à certaines personnes qui ne devaient pas se réjouir de cette escapade. Un soupir leur échappa à leur insu. Enfin Joe lança un ballon d’essai, tâtant le terrain afin de découvrir si ses compagnons songeaient à un retour à la civilisation — non pas tout de suite, mais…
Tom répondit à cette avance par un ricanement sardonique digne du corsaire noir dont il avait emprunté le nom. Huck, qui ne s’était pas encore compromis, suivit l’exemple de son chef ; toute velléité de révolte fut donc étouffée pour le moment.
Huck ne tarda guère à s’assoupir et finit par ronfler. Joe en fit bientôt autant. Tom se tint assez longtemps immobile, la tête appuyée contre un tronc d’arbre. Enfin il se leva et, après avoir cherché dans l’herbe, qu’éclairait la lumière vacillante du feu de camp, il ramassa plusieurs cylindres semi-circulaires formés par l’écorce blanche d’un sycomore. Il en choisit deux qui parurent lui convenir, s’agenouilla près du foyer et traça péniblement quelques lignes avec son crayon sur chacun des morceaux d’écorce. Il en roula un qu’il mit dans la poche de sa jaquette et plaça l’autre dans le chapeau de Joe où il déposa aussi certains trésors d’une valeur inestimable, entre autres, un morceau de craie, une balle élastique, trois hameçons et une douzaine de billes dont deux en cristal. Alors il s’éloigna à pas de loup, disparut derrière les arbres et se mit à courir vers la pointe de l’île dès qu’il jugea que le bruit de ses pas ne pouvait plus réveiller les dormeurs.
Chapitre XV
L’ÉLOGE FUNÈBRE DE TOM
Cinq ou dix minutes plus tard, Tom barbotait dans l’eau peu profonde de la barre et s’avançait vers la côte la plus rapprochée de l’île. Avant que l’eau eût atteint sa ceinture, il était à mi-chemin. Comme le courant ne lui permettait plus de continuer sa marche, il se jeta à la nage pour franchir les derniers cent mètres, gagna la rive et se mit à courir. Un peu avant dix heures, il atteignit une baie située presque en face de Saint-Pétersbourg. Au-dessous de lui il aperçut le bac, dont la cheminée lançait des jets de fumée. Il dévala le long de la berge, se glissa dans l’eau, fit deux ou trois brassées, grimpa dans le canot arrimé à l’arrière du vapeur et attendit. Bientôt une cloche fêlée résonna et une voix qu’il connaissait bien cria : « Au large ! » Une minute ou deux plus tard l’avant du canot était soulevé dans le sillage de son remorqueur, et le voyage commençait. Tom se réjouit d’être arrivé juste à temps, car il n’ignorait pas que le bac ne traverserait plus le fleuve ce soir-là. Au bout d’un quart d’heure les roues cessèrent de tourner et Tom nagea jusqu’à terre, abordant à une certaine distance du débarcadère afin d’éviter la rencontre des autres passagers. Il franchit au pas de course les rues déjà désertes, et se trouva bientôt derrière la maison de sa tante. Escaladant la clôture de planches, il s’approcha de la croisée du parloir où il voyait briller une lumière. Là se trouvaient tante Polly, Sid, Marie et la mère de Joe Harper, qui parlaient évidemment des noyés, à en juger par leur mine attristée. Le parloir, je l’ai déjà dit, était aussi la chambre à coucher de tante Polly. On se tenait près du lit à quatre colonnes dont le chevet se trouvait adossé au mur, et qui s’étendait entre les causeurs et la porte entrebâillée. Tom la poussa doucement, et se faufila presque à plat ventre par l’ouverture.

L’éloge funèbre de Tom
— Qu’a donc cette chandelle ? demanda tante Polly. Bon, la porte est ouverte. Va donc la fermer, Sid.
Tom s’était déjà glissé sous le lit, mais pas une seconde trop tôt.
— Comme je vous le disais, reprit tante Polly, continuant une conversation interrompue, il n’était pas méchant au fond. Un peu étourdi, voilà tout ; pas plus responsable qu’un poulain qu’on lâcherait dans un pré. Et tante Polly se mit à pleurer.
— C’est comme mon Joe, dit Mme Harper en sanglotant. Plein de diableries, mais aussi peu égoïste qu’il est possible de l’être. Quand je songe que je l’ai corrigé pour avoir bu cette crème, sans me rappeler que je l’avais jetée moi-même parce qu’elle était tournée ! Ah ! j’ai bien mérité de ne plus le revoir, le pauvre enfant !
— J’espère que Tom est au ciel, dit Sid ; mais s’il s’était mieux conduit…
— Sid !
Tom, bien qu’il ne pût rien voir, reconnut la voix qui prononçait le nom de son frère et devina l’expression qui animait en ce moment le regard de celle qui prenait sa défense.
— Sid ! pas un mot contre mon Tom, maintenant qu’il n’est plus… Oh ! madame Harper, je ne me consolerai jamais de l’avoir perdu, malgré les transes continuelles qu’il me causait.
— Oui, c’est bien dur, répliqua Mme Harper. L’autre jour, Joe a fait partir un pétard juste sous mon nez et je l’ai rudement secoué. S’il recommençait ce soir, je lui sauterais au cou pour l’embrasser.
— Je comprends ça, madame Harper ; personne ne le comprend mieux que moi. La semaine dernière, Tom a bourré Roméo d’élixir réconfortant ; j’ai cru que la malheureuse bête allait devenir enragée et, Dieu me pardonne, j’ai…
Ce souvenir émut si vivement la vieille dame qu’elle ne put achever la phrase. Tom aussi versa quelques larmes ; seulement, au lieu de compatir à la douleur des siens, il s’apitoyait sur son propre sort. À force d’entendre énumérer les bonnes qualités de celui que l’on regrettait, il commença à croire que tout le monde l’avait méconnu jusqu’alors et qu’il possédait une foule de vertus dont il ne s’était jamais douté. Néanmoins il fut tenté de se montrer à l’improviste. Les aventures du Brigand de la Sonore contenaient maintes scènes de ce genre qui l’avaient attendri. Il résista à la tentation et se borna à écouter. En rattachant divers lambeaux d’un entretien un peu décousu, il apprit que l’on supposait que ses compagnons et lui s’étaient noyés en prenant un bain. On était au mercredi et, si le dimanche suivant on restait sans nouvelles, on renoncerait à tout espoir et l’on réciterait la prière des morts. Tom eut d’abord un frisson ; mais bientôt son visage se rasséréna, et il remit en place le rouleau d’écorce qu’il avait tiré de sa poche.

Tante Polly endormie
Mme Harper se leva pour partir. Tante Polly, restée seule, s’agenouilla et fit une courte prière où le nom du prétendu noyé revint à plusieurs reprises. Lorsqu’elle se fut couchée, Tom demeura longtemps sans bouger, car maintenant il tenait plus que jamais à ce que sa visite demeurât ignorée. Enfin il se glissa hors de sa cachette, prit la chandelle sur la table, parut hésiter un moment, puis s’approcha du chevet qu’il abrita avec sa main contre la lumière, posa les lèvres sur le front de la dormeuse et s’éloigna sur la pointe des pieds. Il regagna l’endroit où stationnait le bac, reconnut que le champ était libre et se hissa sans hésiter sur le pont, À cette heure, il ne restait à bord qu’un vieux chauffeur, qui allait se coucher dès que ses camarades avaient disparu. Tom sauta dans le canot, détacha l’amarre et descendit le courant à la rame. Arrivé à un mille au-dessus de la ville, il traversa le fleuve en biaisant et atteignit la baie où il s’était embarqué. Ce trajet, qu’il avait souvent accompli, n’était qu’un jeu pour lui. La pensée lui vint de s’emparer du canot. Puisqu’un pirate a le droit de faire main basse sur un navire, il est à plus forte raison autorisé à capturer une simple barque. Mais Tom craignit qu’on ne se livrât à des recherches qui pourraient aboutir à la découverte de son repaire. Il renonça donc à son projet, mit pied à terre et se reposa en luttant contre le sommeil ; puis il songea à rejoindre ses amis. La nuit touchait à sa fin et il faisait grand jour lorsqu’il se trouva en face du banc de sable. Il se reposa de nouveau avant de se mettre à la nage, et peu de temps après il arrivait, tout ruisselant, en vue du bivouac. Ses compagnons étaient déjà debout, et il allait se montrer quand il entendit Joe qui disait :
— Non, Tom n’est pas un lâcheur, Huck. On peut compter sur lui, il ne désertera pas. Il sait que ce serait une honte pour un pirate. Je suis sûr qu’il manigance quelque chose.
— En attendant, il nous laisse le bec dans l’eau. Où diable peut-il être ? En tout cas, ce qu’il a mis dans ton chapeau est à toi.
— Pas encore, Huck. Je vais te relire ce qu’il a écrit : « Si le corsaire noir n’est pas revenu pour déjeuner… »
— Le corsaire noir est revenu ! s’écria Tom, dont l’entrée en scène produisit un effet des plus dramatiques, qu’il gâta en ajoutant : et j’ai une faim de loup !
Un somptueux repas, composé de lard et de divers relevés de poisson, fut bien vite préparé. Tandis que l’on y faisait honneur, Tom raconta (en les enjolivant) les dangers qu’il avait courus. Lorsqu’il eut terminé son récit, ses auditeurs se montrèrent aussi fiers que s’ils eussent été les héros de l’aventure. Enfin le corsaire noir, qui tombait de fatigue, se coucha à l’ombre et dormit jusqu’à midi ; les autres pirates, qui éprouvaient le besoin de se dégourdir les jambes, coururent vers l’endroit où le poisson ne semblait demander qu’à mordre.
Chapitre XVI
LE SECRET
Après dîner, les pirates partirent à la recherche d’œufs de tortue. Ils enfonçaient un bâton dans le sable et, dès qu’ils rencontraient un endroit mou, ils s’agenouillaient afin de déblayer le sol avec leurs mains. Parfois un seul trou contenait cinquante ou soixante œufs, ronds comme une bille et à peu près aussi gros qu’un cerneau. Il y eut un fameux souper d’œufs frits ce soir-là.
Le lendemain, ils passèrent une bonne partie de la journée dans l’eau peu profonde de la barre. Ils se poursuivaient, s’éclaboussaient, se saisissaient à bras-le-corps, et la lutte finissait presque toujours par un plongeon général. Vainqueurs et vaincus disparaissaient un moment ; on n’apercevait plus qu’un enchevêtrement de bras et de jambes ; puis ils regagnaient la plage, s’étendaient sur le sable chaud pour se sécher et ne tardaient pas à recommencer leurs ébats aquatiques.
Enfin l’idée leur vint que leur peau imitait assez bien un maillot couleur de chair. Ils tracèrent un vaste cercle sur le sable et ouvrirent un cirque. La troupe se composait de trois clowns, car aucun des artistes ne voulait renoncer à ce rôle. Aussi la représentation, qui manquait de variété, ne dura-t-elle guère. Joe et Huck retournèrent à l’eau comme de vrais canards. Cette fois, Tom ne se joignit pas à eux. Il s’était aperçu qu’en donnant un dernier coup de pied pour se débarrasser de son pantalon, il avait détaché le cordon qui retenait autour de sa cheville les grelots d’un serpent à sonnettes. Comment, privé de ce talisman, avait-il pu nager sans attraper une crampe ? Lorsqu’il eut retrouvé l’amulette protectrice, ses compagnons ne tenaient plus qu’à se reposer. Ils ne paraissaient même pas avoir envie de causer, et s’assirent à l’écart. Comme ils regardaient tous les deux du côté de Saint-Pétersbourg, Tom s’inquiéta et s’empressa de les rejoindre. Joe releva à peine la tête à son approche. Huck aussi commençait évidemment à broyer du noir. Tom se rassura en songeant qu’il possédait un secret qui ne pouvait manquer d’enrayer une mutinerie ; mais ce secret, il craignait que la mauvaise humeur de ses compagnons ne l’obligeât à le révéler trop tôt.
— Allons, mes braves, s’écria-t-il, remuons-nous. Je parie qu’il y a eu des pirates avant nous dans cette île. Ils ont dû enterrer leur trésor quelque part. Que diriez-vous si nous tombions sur un coffre plein d’or et de bijoux ?
Ces paroles furent accueillies avec peu d’enthousiasme. Tom fit deux ou trois autres vaines tentatives pour relever le prestige de son repaire. Le visage de Joe s’assombrissait de plus en plus.
— J’en ai assez, dit-il enfin. On s’ennuie trop dans ton repaire.
— Par exemple ! répliqua Tom. On prend plus de poisson ici en dix minutes que là-bas en une heure. Et puis, où trouveras-tu un meilleur endroit pour te baigner ?
— L’endroit est bon ; mais je n’ai plus de plaisir à me baigner, maintenant que personne ne me le défend.
— Pauvre bébé, il veut revoir sa maman !
— Eh bien, oui, je veux la revoir ; et je ne suis pas plus un bébé que toi ! répondit Joe qui, malgré son assertion, pleurnichait un peu.
— On se passera de lui, pas vrai, Huck ? Nous n’avons pas envie de nous en aller, nous, n’est-ce pas ?
— N…o…n, répliqua Huck, d’un ton peu convaincu.
— Qu’il parte, continua Tom. Si on le montre au doigt, si on l’appelle la terreur des mé-mères, ce ne sera pas notre faute. Un joli pirate ! Nous nous passerons de lui.

Un déserteur
Au fond Tom n’était pas rassuré, car le déserteur s’habillait avec une hâte fiévreuse, et le silence de Huck, qui suivait d’un œil attristé ces préparatifs de départ, lui parut de mauvais augure. Il se reprocha l’imprudence qu’il avait commise en racontant à ses amis avec quelle facilité il avait regagné la terre ferme. Enfin, Joe, sans adresser un mot d’adieu à ses compagnons, entra résolument dans l’eau. Le cœur de Tom se serra. Il se tourna vers Huck et répéta :
— Bah ! nous nous passerons bien de lui.
— J’ai envie de repartir aussi, répliqua Huck.
— Comment, toi aussi !… Eh bien, déguerpis, si ça te plaît. Qui t’en empêche ?
— Voyons, reprit Huck d’un ton de remontrance, viens avec nous. Je n’aime pas le laisser seul ; mais vrai, là, un repaire, c’est trop assommant. Réfléchis un peu. Tu vas t’ennuyer. Nous t’attendrons sur l’autre rive.
— Vous m’attendrez longtemps !
Huck s’éloigna avec lenteur. Tom le suivit des yeux, espérant qu’il s’arrêterait. Les révoltés continuèrent leur route, et le corsaire noir, qui se sentait déjà bien isolé, livra un dernier combat à son orgueil et courut après ses camarades en criant :
— Arrêtez ! j’ai quelque chose à vous dire.
Lorsqu’il les eut rejoints, il leur confia son secret. Les rebelles l’écoutèrent d’abord d’un air maussade ; mais à peine Tom eut-il achevé sa confidence, qu’ils battirent des mains.
— Si tu nous avais raconté cela plus tôt, s’écria Joe, je n’aurais pas songé à partir.
Tom trouva une excuse plausible. En réalité son mystérieux projet (que le lecteur ne tardera pas à connaître) ne lui semblait pas de nature à retenir bien longtemps ses camarades, et il aurait voulu ne le révéler qu’au dernier moment.
Les pirates revinrent gaiement sur leurs pas et se livrèrent avec un nouvel entrain à leurs jeux, tout en causant du projet de leur capitaine. Après un dîner composé de poisson et d’œufs de tortue, Tom déclara qu’il voulait apprendre à fumer. Joe, qui tenait sans doute à prouver qu’il n’était pas un bébé, exprima le même désir. Huck fabriqua donc des pipes et les bourra.
Les deux novices n’avaient jusqu’alors fumé que des cigares fabriqués avec des feuilles de vigne qui piquaient la langue, mais ne convenaient qu’à des enfants. Ils s’étendirent sur l’herbe, s’accoudèrent dans une attitude nonchalante et lancèrent quelques bouffées avec une circonspection qui n’annonçait pas une très grande confiance. Bien que le goût du tabac leur parût désagréable, ils ne se pressèrent pas d’exprimer leur opinion. Enfin Tom dit : — Mais c’est facile comme bonjour ! Si j’avais su, il y a longtemps que j’aurais appris.
— Ce n’est pas la mer à boire, répliqua Joe. Je ne me sens pas malade du tout.
— Ni moi non plus ; je crois que je pourrais fumer cette pipe jusqu’à demain matin. Jeff Thatcher n’en ferait pas autant.

La première pipe
— Jeff ! je voudrais l’y voir. Il aurait eu mal au cœur dès la première bouffée. Si les autres nous voyaient, hein ?
— Il vaut mieux qu’ils ne nous voient pas. Ne soufflons pas mot, et un jour, quand ils seront à flâner dans tes parages, je m’approcherai et je te demanderai : « As-tu une pipe, Joe ? J’ai une fière envie de fumer. » Alors tu répondras tranquillement : « Oui, j’ai ma vieille pipe, et j’en ai une autre pour les amis ; mais mon tabac n’est pas très bon. » Alors je dirai : « Bah, s’il est assez fort ! » Et nous allumerons nos pipes sans nous donner des airs. Quels yeux ils ouvriront !
— Oui, je t’en réponds ! Ce sera drôle, Tom.
— Et lorsqu’ils sauront que nous sommes des pirates, il y en a plus d’un qui se mordra les pouces de n’avoir pas été avec nous.
La conversation devint bientôt un peu décousue, et les apprentis fumeurs se montrèrent plus avares de paroles. Leur expectoration augmentait d’une façon alarmante. De chacune de leurs glandes salivaires jaillissait une fontaine et ils avaient de la peine à vider le réservoir qui se formait sous leur langue assez vite pour empêcher une inondation. En dépit de leurs efforts, une partie du trop-plein leur coulait dans la gorge, qui, chaque fois, manifestait une soudaine tendance à la révolte. De minute en minute les débutants devenaient plus pâles. Enfin Joe laissa tomber sa pipe et dit d’une voix mal assurée :
— J’ai perdu mon couteau ; je crois que je ferai bien d’aller le chercher.
— Je t’aiderai, répliqua Tom en passant la main sur son front moite… Non, tu n’as pas besoin de te déranger, Huck ; nous le trouverons bien sans toi.
Huck se rappelait peut-être l’effet de sa première pipe ; il se rassit donc. Au bout d’une heure d’attente, comme ses camarades ne reparaissaient pas, la solitude commença à lui peser et il se mit à leur recherche. Il les retrouva dans le bois, assez éloignés l’un de l’autre, dormant d’un profond sommeil. Ils étaient encore très pâles ; mais quelque chose lui apprit que, s’ils avaient éprouvé un malaise, ils s’en étaient débarrassés. Ce soir-là, leur entrain habituel leur fit défaut et lorsque Huck, le repas terminé, s’apprêta à bourrer leurs pipes, ils lui évitèrent cette peine. Non, merci ; ils avaient mangé trop d’œufs de tortue à déjeuner et ne se sentaient pas très bien.
Chapitre XVII
L’ORAGE
Vers minuit Joe se réveilla et appela ses compagnons. Un orage planait dans l’air. Nos pirates, pressés l’un contre l’autre, se tinrent immobiles et silencieux, attendant ils ne savaient quoi. En dehors de la lumière du foyer tout demeurait plongé dans une obscurité profonde. Bientôt une lueur, ou plutôt un frémissement de lueur, révéla vaguement le sommet du feuillage et s’évanouit pour se reproduire bientôt avec plus d’intensité. Un faible gémissement courut comme un soupir à travers le branchage ; une fraîche haleine caressa les joues de Tom, qui frissonna à l’idée que l’esprit de la nuit venait de le frôler. Au même instant un éclair transforma la nuit en jour, lui permit de distinguer chaque brin d’herbe et lui montra aussi deux visages effrayés. Un sourd roulement de tonnerre gronda et se perdit au loin. Une brise froide s’éleva, agitant les feuilles, secouant les cendres blanches autour du foyer. Un second éclair illumina la forêt, suivi d’un éclat de tonnerre beaucoup plus rapproché que le premier. Les enfants se cramponnèrent l’un à l’autre. Quelques grosses gouttes de pluie fouettèrent les feuilles avec un bruit de grêle.
— Vite, à la tente ! cria Tom.
Les voilà partis dans les ténèbres, trébuchant sur les racines, se butant contre les troncs d’arbres, s’enchevêtrant dans les vignes sauvages. Une rafale furieuse se mit à secouer les branches avec un sifflement sinistre. Les éclairs et les éclats de tonnerre se suivaient sans interruption. La pluie tombait maintenant à verse et l’ouragan déchaîné l’abattait en nappes obliques contre le sol. Les trois amis réussirent néanmoins à se rejoindre sous l’abri qu’ils nommaient leur tente. Leurs vêtements ruisselaient ; ils grelottaient, en proie à une terreur panique. Ils n’éprouvaient aucun besoin de causer ; du reste, les mille bruits de la tourmente ne leur auraient pas permis de s’entendre, alors même que la vieille voile étendue au-dessus de leurs têtes n’aurait pas clapoté avec tant de fureur. Bientôt la violence de la tempête s’accrut ; la voile fut emportée sur les ailes du vent. Les enfants, de plus en plus effrayés, se saisirent par la main et cherchèrent un abri sous un chêne qui se dressait non loin du fleuve.

L’orage
Sous la conflagration qui embrasait à chaque instant le ciel tout se dessinait nettement sans produire une ombre — les arbres ployés, le fleuve houleux sous sa couche de mousse blanche, les flocons d’écume, les collines de la rive opposée que l’on entrevoyait à travers le voile de la pluie oblique. De temps à autre quelque géant de la forêt s’effondrait avec fracas, brisant les branches des arbres voisins. Les détonations de la foudre, qui éclatait sans discontinuer, devenaient assourdissantes. L’orage semblait s’efforcer à la fois de mettre l’île en morceaux, de l’incendier, de la noyer jusqu’au sommet des peupliers, de l’emporter dans une bourrasque et de fêler les oreilles de tous les êtres vivants qui s’y trouvaient. Nos aventuriers croyaient leur dernière heure venue, et il y avait certes de quoi les épouvanter.
Enfin l’orage s’apaisa peu à peu. Lorsque les enfants regagnèrent leur bivouac, ils étaient encore sous le coup des émotions de cette terrible nuit et ils découvrirent qu’ils n’avaient pas eu tort de s’effrayer. Le platane sous lequel ils s’étaient d’abord réfugiés gisait foudroyé, fendu jusqu’à la racine.
Leur camp avait été inondé comme le reste de l’île. Ils grelottaient sous leurs vêtements trempés. Par bonheur Huck reconnut que le tronçon d’arbre contre lequel ils avaient bâti leur foyer et qui formait une courbe au-dessus du sol brûlait encore en dessous. À force de s’époumoner, à l’aide de bouts d’écorces, ils réussirent à raviver la flamme ; puis ils entassèrent les branches mortes et eurent bientôt devant eux une véritable fournaise qui leur réjouit le cœur. Ils firent sécher leur jambon bouilli, qui contribua aussi à les réconforter, et, accroupis près du feu, ils s’entretinrent des dangers qu’ils avaient courus. Ils auraient bien voulu dormir, mais le sol autour d’eux était encore trop mouillé.
Lorsque le jour parut, ils tombaient de sommeil et ils allèrent s’allonger sur le banc de sable, où ils se reposèrent jusqu’à ce que la chaleur fût devenue trop forte. Joe prépara le déjeuner, que l’on mangea sans appétit. On commençait à trouver que le menu manquait de variété. Le repas terminé, deux des pirates émirent l’opinion que le repaire devait être malsain, car ils se sentaient moulus. Tom, redoutant une nouvelle révolte, fit son possible pour les égayer ; mais le cirque et les billes n’avaient plus d’attrait pour eux. Quant à se baigner, ils déclarèrent que la trempée de la veille leur suffisait. Tom, à bout de ressources, leur rappela l’important secret qui avait déjà eu un si bon résultat et réussit ainsi à les tirer de leur torpeur. Il profita de l’impression produite pour leur proposer un jeu nouveau. Sans renoncer à redevenir pirates un jour ou l’autre, on pouvait se transformer provisoirement en Peaux-Rouges. Cette proposition fut bien accueillie. Nos corsaires furent déshabillés en un clin d’œil et zébrés des pieds à la tête de raies de boue noire, comme il convient à des chefs indiens — ils étaient tous chefs, cela va sans dire. Ils se mirent à courir à travers bois afin de surprendre un cantonnement anglais. Ce but atteint, ils se divisèrent en trois tribus hostiles, se tinrent en embuscade pour s’élancer les uns contre les autres en poussant des cris de guerre effroyables, se tuant et se scalpant par milliers.

Les Peaux-Rouges
On rentra au camp à l’heure du souper, heureux et affamé. Mais il surgit alors une difficulté. Des tribus hostiles ne sauraient rompre le pain de l’hospitalité sans avoir conclu un traité d’alliance. Ce traité, il était impossible de le conclure sans avoir fumé le calumet de la paix. Deux des sauvages regrettèrent de ne pas être restés pirates. Cependant, ils firent contre fortune bon cœur, demandèrent le calumet et lancèrent leur bouffée officielle avec toute la gravité voulue chaque fois que la pipe passait de main en main. Bien avant la fin de la cérémonie ils se réjouirent d’avoir embrassé la vie sauvage, car ils s’aperçurent qu’ils pouvaient fumer sans se voir obligés d’aller à la recherche d’un couteau perdu. Ce progrès était trop encourageant pour ne pas inviter d’autres efforts. Après souper ils s’exercèrent donc avec un succès qui les remplit de joie. Ils se montrèrent aussi fiers de leur nouveau talent que s’ils eussent scalpé pour de bon des centaines de Peaux-Rouges.
Chapitre XVIII
COUP DE THÉÂTRE
À Saint-Pétersbourg, on ne se livra à aucune espèce de réjouissance ce samedi-là. Mme Harper et la tante Polly se lamentaient en préparant des vêtements de deuil. La petite ville, si calme d’ordinaire, était encore moins animée que de coutume. Chacun vaquait à ses affaires ; mais personne n’avait le cœur à la besogne. Vers une heure de l’après-midi, Becky Thatcher se mit à errer comme une âme en peine dans la cour déserte de l’école. Elle se sentait très malheureuse et ne trouva rien là qui fût de nature à la consoler.
— Si j’avais seulement la boule de cuivre, pensait-elle. Mais non, je n’ai rien gardé en souvenir de lui !
Et elle s’éloigna avec de grosses larmes dans les yeux. Un groupe d’écoliers, au lieu de profiter du congé du samedi pour se livrer à leurs jeux habituels, vint regarder par-dessus la clôture. On s’entretint de ce que Tom faisait la dernière fois qu’on l’avait vu, de ce que Joe Harper avait dit. On se rappela une foule de détails auxquels on n’avait attaché aucune importance au moment et dont on aurait dû être frappé. Puis on se disputa pour savoir qui avait échangé les dernières paroles avec les défunts. Plus d’un revendiqua ce triste honneur en s’appuyant sur des témoignages dont un juge impartial ne se serait pas contenté. Un candidat à la notoriété, qui n’avait aucun titre plus valable à invoquer, voulut aussi se mettre en relief et dit avec une nuance d’orgueil très visible :
— Moi, j’ai été rossé par Tom il y a huit jours. Mais c’était là une distinction dont la plupart de ses camarades pouvaient se targuer, de sorte que la vanterie ne produisit pas le moindre effet.
Le lendemain, la cloche de l’église sonna le glas, au lieu de tinter comme elle le faisait tous les dimanches. Les fidèles commencèrent à se réunir, s’arrêtant à l’entrée du temple pour parler du triste événement ; mais à l’intérieur on s’abstint de causer, même à voix basse. Lorsque tante Polly et la mère de Joe entrèrent avec les membres de leur famille, tous en grand deuil, l’assistance se leva et se tint debout jusqu’à ce que les affligés eussent atteint le banc le plus rapproché de la chaire. Après un moment de profond silence, le service divin commença. Dans son sermon, le pasteur parla en termes si touchants de ceux dont on déplorait la fin prématurée, qu’une partie de l’auditoire se reprocha de n’avoir jamais reconnu que les défauts des jeunes trépassés. Le prédicateur rappela plus d’un incident qui annonçait chez les défunts un caractère plein de noblesse et de générosité. La douleur de tante Polly et de Mme Harper le touchait trop pour qu’il n’oubliât pas certains épisodes à la suite desquels ceux qu’il louait avaient été de sa part l’objet de prédictions peu flatteuses. Bref, il se montra d’autant plus éloquent que ses paroles attendries venaient du cœur.
Il achevait son sermon, lorsqu’un léger bruit, auquel personne ne fit attention, résonna dans la galerie. Quelques minutes après, la porte qui menait à la galerie s’ouvrit, et le pasteur resta bouche béante. Peu à peu, tous les yeux prirent la direction que suivait son regard, puis l’assistance entière se leva presque à la fois et demeura confondue à son tour en voyant les trois noyés s’avancer à la file. Tom cheminait en tête avec l’allure d’un triomphateur, et Joe, qui venait derrière lui, cherchait en vain à imiter le maintien de son chef. Huck fermait la marche d’un air embarrassé, bien que ses vêtements ne fussent guère en plus mauvais état que ceux de ses compagnons. Les pirates — ou les chefs indiens, si vous aimez mieux — s’étaient blottis dans la galerie inoccupée, afin d’écouter leur oraison funèbre !
La tante Polly, Marie, les Harper, se jetèrent au cou de deux des morts supposés. Huck, qui ne se sentait pas à son aise, ne savait où se cacher pour échapper aux regards fixés sur lui. Une triste expérience lui avait appris à ne pas trop compter sur la sympathie de ses semblables. Il hésita un moment et fit un ou deux pas en arrière. Tom lui coupa la retraite.

Coup de théâtre
— Tante Polly, dit-il, ça n’est pas juste. Il faut que quelqu’un soit content de revoir Huck.
— Mais tout le monde est content de le revoir, le pauvre orphelin ; moi, la première, répliqua tante Polly.
Elle se mit aussitôt à combler d’attentions aimantes le malheureux Huck, qui, faute d’habitude, ne sut quelle contenance garder. Soudain le pasteur, d’une voix qui fit vibrer les vitres, entonna le premier vers d’un vieux cantique :
Gloire au Seigneur, dont la grâce infinie…
— Chantons et mettons-y toute notre âme !
Chacun y mit toute la ferveur dont il était capable, et le cantique monta vers le ciel comme un chant de triomphe, ébranlant les poutres de la toiture. Tom Sawyer, le pirate noir, sans paraître remarquer les regards d’admiration d’une partie de son entourage, se crut un plus grand homme que le juge Thatcher lui-même. Quant aux fidèles dont il s’était moqué, ils déclarèrent, en regagnant leurs domiciles respectifs, qu’ils consentiraient volontiers à être mystifiés de nouveau, afin d’entendre chanter le vieux cantique comme on venait de le chanter.
Ce jour-là — selon l’humeur variable de tante Polly — Tom reçut plus de caresses et plus de coups de dé qu’il n’en obtenait d’ordinaire d’un bout de l’année à l’autre.
Chapitre XIX
LE RÊVE DE TOM
C’était là le grand secret de Tom. L’idée d’assister à leurs propres funérailles avait seule pu décider les pirates révoltés à ne pas déserter. Le samedi soir, à la tombée de la nuit, ils avaient traversé le fleuve sur un tronc d’arbre pour aborder à trois ou quatre milles de Saint-Pétersbourg ; ils avaient dormi jusqu’au point du jour dans un bois ; puis, se glissant à travers les rues désertes, ils étaient allés achever leur somme dans l’église, au milieu d’un chaos de bancs boiteux.
Le lendemain matin, à déjeuner, tante Polly et Marie semblèrent rivaliser pour gâter Tom, qui dut penser que le meilleur moyen de se faire aimer consistait à se noyer. On causa beaucoup et, vers la fin du repas, tante Polly lui dit :
— Je me demande comment tu oses rire, Tom. Ç’a peut-être été une bonne plaisanterie de mettre toute la ville sens dessus dessous ; mais je ne te croyais pas assez mauvais cœur pour me laisser souffrir ainsi. Puisque tu as pu revenir pour écouter le sermon, tu aurais bien pu trouver le moyen de me prévenir que tu n’étais pas mort.
— Oui, Tom, ajouta Marie, tu aurais au moins pu nous rassurer, et je crois que tu l’aurais fait si tu y avais pensé.
— Je ne sais pas trop ; cela aurait tout gâté, répliqua Tom, qui regretta aussitôt sa franchise en voyant combien elle affligeait tante Polly.
— Il ne faut pas lui en vouloir, maman, dit Marie, Tom n’a pas mauvais cœur, mais il est plus étourdi qu’une linotte ; quand il a une idée en tête, il ne songe jamais à autre chose. — Tant pis. Sid y aurait songé.
— Voyons, ma tante, tu sais bien que je t’aime.
— Je le saurais mieux si tu agissais en conséquence.
— Eh bien, je suis fâché de n’y avoir pas pensé, reprit Tom. En tout cas, j’ai rêvé de toi. C’est quelque chose, hein ?
— Pas grand’chose ; les chiens et les chats rêvent ; enfin, ça vaut mieux que rien. Qu’est-ce que tu as rêvé ?
— Attends un peu que je me rappelle… Mercredi soir, j’ai rêvé que tu étais assise là, près du lit ; Sid bâillait sur le coffre à bois, et Marie pleurait à côté de lui.
— Comme tous les soirs depuis ton départ. Ton rêve n’a rien d’extraordinaire. C’est égal, je suis contente que tu aies pensé à nous, même dans ton sommeil.
— Et j’ai rêvé que la mère de Joe Harper était ici.
— Justement, elle y était ! s’écria tante Polly. As-tu rêvé autre chose ?
— Des tas de choses ; mais je ne m’en souviens pas très bien.
— Tâche de te rappeler.
— Il m’a semblé qu’un courant d’air soufflait du côté du… du côté de…
— Cherche encore, Tom. Le vent a, en effet, soufflé.
Tom pressa la main contre son front pendant une minute, comme s’il s’efforçait de rassembler ses souvenirs, puis il dit :
— J’y suis maintenant. Le vent a presque éteint la chandelle.
— Miséricorde ! Continue, Tom, continue !
— Et il m’a semblé alors que tu disais : « Bon, la porte est ouverte ! »
— Aussi sûr que je suis assise là, ce sont mes propres paroles, N’est-ce pas, Marie ? Continue donc, Tom.
— Et puis… et puis tu as envoyé Sid…
— Où ai-je envoyé Sid ? — Laisse-moi me rappeler… Tu lui as dis d’aller fermer la porte.
— Bonté du ciel, je n’ai jamais rien entendu de pareil ! Qu’on vienne encore me rabâcher qu’il ne faut pas croire aux rêves ! Je raconterai cela à Mme Harper avant que je sois plus vieille d’une heure. Nous verrons si elle soutiendra encore que ce sont des histoires à dormir debout. Continue, Tom !
— Oui, ma tante. Cela me revient maintenant comme en plein jour. Ensuite tu as dit que je n’avais pas mauvais cœur au fond, seulement un peu écervelé et pas plus responsable qu’un… qu’un poulain, je crois.
— C’est bien cela ! s’écria tante Polly, de plus en plus émerveillée. Après ?
— Après, tu as commencé à pleurer.
— Oui, et pas pour la première fois non plus. Après ?
— Après, Mme Harper s’est mise à pleurer aussi et elle a dit que Joe n’était pas plus méchant que moi, et qu’elle se mordait les pouces de l’avoir battu à cause d’une jatte de lait qu’elle avait jetée elle-même…
— Tom, ton rêve était une prophétie, ni plus ni moins. Continue.
— Alors Sid a dit…
— Moi ? Je n’ai pas ouvert la bouche, interrompit Sid, ou du moins je ne m’en souviens pas.
— Si, tu as dit quelque chose, répliqua sa cousine.
— Tais-toi et laisse parler Tom ! s’écria tante Polly. Qu’est-ce que Sid a dit, Tom ?
— Il a dit que si je m’étais mieux conduit…
— Mot pour mot ! Je n’en reviens pas !
— Et tu l’as rembarré, raide ! Ensuite, Mme Harper t’a rappelé comment Joe l’avait effrayée en lui lâchant un pétard sous le nez, et toi, tu as parlé de l’histoire de Roméo et de l’élixir. À la fin on a causé de l’affaire de dimanche, ce qui m’a décidé à revenir.
— Eh bien, Tom, tout ce que tu viens de nous raconter est arrivé mercredi soir, dans cette chambre même. Si tu avais été ici en chair et en os, tu ne serais pas plus avancé. Est-ce que ton rêve s’arrête là ?
— Non ; j’ai pensé que tu priais pour moi. Je te voyais et je t’entendais très bien. Tu t’es couchée, et ton chagrin m’a fait tant de peine que j’ai écrit sur un bout d’écorce d’arbre : « Nous ne sommes pas morts ; nous sommes seulement partis pour devenir pirates, » et je voulais laisser l’écorce au chevet de ton lit. Je t’ai regardée, et tu avais l’air si désolée, que je t’ai embrassée pour te consoler. Ça ne servait à rien, puisque tu dormais ; mais je n’ai pas pu m’en empêcher.

Alors Sid a dit…
— Vrai, Tom, bien vrai ? Je te pardonne tout à cause de cela, dit tante Polly qui serra son neveu dans ses bras.
— Très gentil de sa part, quoique ce ne soit qu’un rêve, murmura Sid comme en se parlant à lui-même, mais assez haut pour qu’on pût l’entendre.
— On ne te demande pas ton avis, Sid — tais-toi ! s’écria de nouveau tante Polly. Dans un rêve, les gens agissent de même qu’ils le feraient étant éveillés. Maintenant allez vite chercher vos chapeaux, et en route pour l’école.
Les enfants obéirent, et la vieille dame ne tarda pas à sortir à son tour. Elle brûlait de vaincre l’incrédulité positiviste de Mme Harper en lui racontant le rêve de Tom.
Sid, plus discret que la généralité des garçons de son âge, s’était bien; mais si on l’avait interrogé, il aurait répondu :
— Je n’y comprends rien. Tom a répété tout ce que nous avons dit sans se tromper d’un mot. Voilà un drôle de rêve. Moi, je ne vois en songe que des choses qui n’ont jamais pu arriver. Je ne donne pas là dedans.
Tom était devenu un véritable héros aux yeux de la jeune génération de Saint-Pétersbourg. Il ne s’en montra pas plus fier. Tout au plus aurait-on pu lui reprocher de se dandiner avec la gravité dont ne doit pas se départir un corsaire qui a mérité de fixer l’attention publique. Bien qu’il affectât de ne pas remarquer les regards dirigés sur lui, de ne pas entendre les observations plus ou moins flatteuses dont il était l’objet, il buvait du lait. Une foule de gamins marchaient sans cesse sur ses talons, aussi heureux de figurer dans son escorte que s’ils eussent suivi l’éléphant qui fait son entrée triomphale dans une ville à la tête d’une ménagerie.
En attendant l’heure de la classe, Tom et Joe se virent entourés de tant d’admirateurs qu’ils ne tardèrent pas à monter sur leurs grands chevaux ou « à faire leur tête », pour employer l’expression de Sid. Ils commencèrent à raconter leurs aventures à un auditoire avide. Je dis qu’ils commencèrent, car le récit promettait de rivaliser de longueur avec les romans les plus volumineux. Leur imagination était trop féconde pour qu’une disette de matériaux fût à craindre. Enfin, lorsqu’ils tirèrent avec nonchalance leurs pipes de leurs poches et se mirent à lancer des bouffées de tabac au nez de leurs voisins, le sommet de la gloire fut atteint.
Tom se dit que les dédains de Becky Thatcher le trouveraient désormais indifférent. La gloire suffisait. Maintenant qu’il était célébre, elle voudrait sans doute se raccommoder avec lui. Eh bien, elle s’apercevrait que d’autres pouvaient répondre tout aussi sèchement qu’elle à une avance. Quand Becky arriva quelques minutes après, Tom eut l’air de ne pas la voir. Il s’éloigna pour rejoindre un groupe nombreux de garçons et de filles qui se pressa autour de lui. Becky se mit bientôt à poursuivre quelques-unes de ses camarades, éclatant de rire chaque fois qu’elle en atteignait une. Tom remarqua qu’elle faisait toujours ses prisonnières dans le voisinage du groupe en question et qu’elle s’arrêtait alors pour regarder du côté de l’ex-pirate. Ce manège, loin de le ramener à de meilleurs sentiments, ne servit qu’à stimuler sa vanité ; il fit tous ses efforts pour paraître ne pas se douter qu’elle était là. À la longue, Becky cessa de jouer ; elle erra seule dans la cour d’un pas irrésolu, soupirant et lançant des regards furtifs vers l’endroit où se tenait Tom. Il lui sembla que l’ingrat causait de préférence avec Amy Lawrence. Cette découverte l’indigna et elle voulut s’en aller, ce qui ne l’empêcha pas de se rapprocher du groupe ; puis elle dit, avec une vivacité affectée, à une écolière qui touchait presque Tom du coude :
— Ah ! te voilà, Jenny. Pourquoi n’es-tu pas venue à l’école du dimanche ?
— Mais j’y étais.
— Vraiment ? Où donc te trouvais-tu ?
— À la place où je me mets toujours. Tu sais bien que je suis dans la classe de miss Peters. Je t’ai même fait signe.
— C’est drôle, je ne t’ai pas vue. Je voulais te parler du pique-nique et je t’ai cherchée à la sortie.
— Un pique-nique, bravo ! Ta mère s’est enfin décidée ? J’espère que j’en serai.
— Certainement ; j’ai déjà dit à maman que je voulais t’avoir.
— Merci. Est-ce pour bientôt ?
— Après la distribution des prix.
— Alors tu pourras inviter toute l’école ? — Oui… du moins tous ceux qui veulent être amis avec moi.
Cette réponse s’adressait indirectement à Tom ; mais Tom causait avec Amy Lawrence du terrible orage qui avait failli engloutir l’île des pirates, et de l’arbre que la foudre avait mis en miettes à quelques pas de lui.

Tu m’inviteras ?
— Tu m’inviteras, Becky ? demanda Jeanne Mullins, qui avait prêté l’oreille à l’annonce du pique-nique.
— Oui.
— Et moi ? Et moi ? répétèrent plusieurs voix.
— Oui, oui.
Les demandes et les réponses se succédèrent, avec un accompagnement de battements de mains, jusqu’à ce que tout le monde, sauf Tom et Amy, eût sollicité une invitation. Alors Tom s’éloigna sans se retourner, emmenant Amy Lawrence. Les lèvres de Becky tremblèrent et une larme lui monta aux yeux. Elle comprima ses larmes et répondit avec une gaieté feinte aux questions qu’on lui adressait à propos de la partie projetée. Elle s’éloigna dès qu’elle le put et se retira dans un coin afin de pleurer à son aise. Lorsque la cloche résonna pour appeler les élèves en classe, ses yeux étaient déjà secs ; elle n’éprouvait plus qu’un sentiment de colère. Elle quitta le banc où elle s’était isolée pour cacher son dépit, hocha la tête avec un brusque mouvement qui secoua ses nattes jaunes et murmura :
— Je sais ce que je ferai maintenant.
Après la classe, Tom n’eut rien de plus pressé que de rejoindre Amy Lawrence, qu’il entraîna dans diverses directions dans l’espoir d’être aperçu par Becky et de lui lacérer le cœur. Il finit par la trouver ; mais alors les rôles furent changés. Becky et Alfred Temple, installés côte à côte sur un banc derrière l’école, regardaient un livre d’images. Les gravures ou le texte devaient les intéresser au dernier point, car ils étaient tellement absorbés et leurs têtes rapprochées se penchaient si bas au-dessus de la page, qu’ils semblaient n’avoir pas conscience de ce qui se passait autour d’eux. Tom s’en voulut d’avoir laissé échapper la chance de réconciliation que Becky lui avait offerte. Il était prêt à pleurer de rage. Amy bavardait comme une pie borgne ; mais Tom n’écoutait pas ce que disait sa compagne, et lorsque celle-ci l’interrogeait, il répliquait par un oui ou par un non distrait qui tombait souvent fort mal à propos. Il revenait sans cesse du côté de la petite cour pour repaître ses yeux de l’odieux spectacle qui l’y attendait. Il ne pouvait pas s’en empêcher, bien qu’il s’indignât de ce que Becky ne semblât pas se douter que l’illustre pirate fût au nombre des vivants. Il se trompait. Becky le voyait très bien ; elle savait qu’elle tenait la corde et se réjouissait, heureuse du succès de sa tactique. Le bavardage d’Amy parut bientôt intolérable à Tom, qui insinua qu’il avait une masse d’affaires sur les bras, des affaires urgentes, et que le temps s’écoulait avec une rapidité effrayante. Vains efforts ! La caillette ne se lassait pas de caqueter.
— Ah çà, se dit Tom, est-ce que je ne me débarrasserai jamais d’elle ?
Enfin, il donna à entendre plus clairement que les affaires dont il venait de parler l’appelaient ailleurs. Amy le prévint qu’elle l’attendrait à la sortie de la seconde classe et Tom s’éloigna, irrité non seulement contre elle, mais contre le monde entier.
— Si ç’avait été un autre, pensa-t-il en grinçant des dents, je m’en serais moqué. Tout autre que ce mirliflore de Saint-Louis, qui se donne des airs parce qu’il est toujours tiré à quatre épingles ! Sois tranquille ; je t’ai rossé le jour même de ton arrivée et je te repincerai !
Sur ce, il se mit à rosser un ennemi imaginaire, lançant au hasard des coups de poing et des coups de pied, arrachant des cheveux par poignées.
— Ah ! tu reconnais ton maître, hein ? Tu demandes grâce, hein ? Tu avoues encore une fois que tu en as assez, hein ? Allons, file, et ne recommence pas !
Cette correction ayant été ainsi administrée à son entière satisfaction, le vainqueur reprit le chemin de son domicile. Il craignait de trahir son dépit aux yeux de Becky, qui, on l’a vu, savait à quoi s’en tenir. Celle-ci continua son inspection des images ; mais comme Tom ne reparaissait pas, les gravures cessèrent de l’intéresser et sa mauvaise humeur éclata. Le pauvre Alfred, voyant qu’il perdait du terrain, quoiqu’il n’eût rien à se reprocher, tournait les pages avec une complaisance infatigable. À la fin, Becky, à bout de patience, s’écria :
— J’en ai assez de vos images, vous m’ennuyez !
Elle fondit en larmes, se leva et s’éloigna. Son compagnon, revenu de sa surprise, s’empressa de la rejoindre et essaya en vain de la consoler.
— Laissez-moi tranquille, je vous déteste, lui dit Becky. Alfred la laissa tranquille, ou plutôt il la laissa partir seule, se demandant pourquoi elle se fâchait, car elle lui avait déclaré qu’elle passerait des journées entières à admirer des images. Il entra dans la salle d’étude déserte et se mit à réfléchir. Il devina que Becky venait tout simplement de se servir de lui afin de taquiner Tom. Cette pensée l’humilia et ne contribua pas à diminuer la rancune qu’il gardait à notre héros. Sa première rencontre avec ce dernier réveillait des souvenirs trop pénibles pour qu’il songeât à s’attaquer ouvertement à lui ; mais il était plus désireux que jamais de se venger dès qu’il le pourrait sans courir aucun risque.

La vengeance d’Alfred
À ce moment, la grammaire de Tom lui tomba sous les yeux. La belle occasion ! Maître Alfred ouvrit le livre au bon endroit et versa la moitié du contenu d’un encrier sur la page où se trouvait la leçon du soir. Becky, qui avait fait le tour de la maison pour gagner la cour d’entrée, jeta en passant un coup d’œil par la croisée à laquelle le traître tournait le dos. Elle fut témoin de ce crime de lèse-camaraderie, et se retira sans avoir été vue. Elle partit au pas de course, avec l’intention bien arrêtée de tout raconter à Tom. Heureux d’être tiré d’un mauvais pas, il se montrerait reconnaissant et la paix serait conclue. Avant d’arriver à la maison, elle avait changé d’avis. La façon indigne dont Tom l’avait traitée pendant qu’elle parlait du pique-nique lui revint à l’esprit et raviva sa colère. Elle résolut de l’abandonner à son sort.
Chapitre XX
TOM SE RÉHABILITE
Lorsque Tom rentra chez lui, les premières paroles que lui adressa sa tante lui apprirent qu’elle n’était nullement disposée à compatir à ses chagrins.
— Tom, j’ai envie de t’écorcher vif !
— Qu’est-ce qu’il y a, ma tante ?
— Ce qu’il y a ? Tu oses le demander ? Je suis allée comme une bécasse chez Mme Harper, espérant la voir tomber de son haut. Pas du tout ! Elle avait appris de Joe que tu t’es faufilé ici mercredi et que tu as entendu chaque parole que nous avons échangée… Ah ! c’est comme cela que tu as rêvé… Tom, je ne sais pas ce que deviendra un enfant qui joue de pareils tours à sa vieille tante. Tu n’ignorais pas que je comptais étonner Mme Harper, et tu n’as rien fait pour m’empêcher de me couvrir de ridicule.
Tom vit alors la chose sous un nouveau jour. Sa plaisanterie, qui lui avait paru très ingénieuse quelques heures auparavant, lui sembla indigne.
— Ma tante, dit-il en baissant la tête, je suis très fâché de ce que j’ai fait ; je n’ai pas réfléchi.
— Non, tu ne réfléchis jamais. Tu ne songes qu’à toi et à tes amusements. Tu as bien pensé à venir de l’île Jackson au milieu de la nuit pour rire de nos peines ; tu as bien pensé à te moquer de moi en débitant un long mensonge, et tu n’as jamais pensé à nous épargner seulement une heure de chagrin. — Ma tante, je reconnais maintenant que j’ai mal agi, mais je ne croyais pas agir si mal. Vrai ! D’ailleurs je ne suis pas revenu ce soir-là pour rire de ton chagrin.
— Pourquoi es-tu revenu alors ?
— Je voulais te dire de ne pas t’inquiéter, parce que nous n’étions pas noyés du tout.
— Ne mens pas, Tom. Je remercierais le ciel si je pouvais croire que tu as eu cette bonne idée.
— Ce n’est pas un mensonge, ma tante, c’est la vérité vraie. Je t’assure que je voulais t’empêcher de te chagriner. Je ne suis pas venu pour autre chose.
— Je donnerais beaucoup pour en être certaine. Cela couvrirait une foule de péchés, Tom, et je ne t’en voudrais presque plus. Mais ce n’est pas croyable, puisque tu n’as rien fait pour dissiper nos craintes.
— Vois-tu, ma tante, quand tu as parlé des funérailles, j’ai pensé que ce serait drôle de surprendre tout le monde en nous cachant dans l’église, et la surprise aurait été gâtée si j’avais parlé. Alors j’ai remis l’écorce dans ma poche et je n’ai pas desserré les dents.
— Quelle écorce ?
— L’écorce sur laquelle j’avais écrit pour te dire que nous étions devenus pirates. Je suis fâché maintenant que tu ne te sois pas réveillée lorsque je t’ai embrassée, vrai !
Le visage de la vieille dame se rasséréna ; elle regarda Tom d’un œil attendri.
— Alors tu m’as embrassée, Tom ? Ce n’est pas encore là une de tes histoires ?
— Non, ma tante ; et j’ai eu joliment peur de te réveiller.
— Pourquoi m’as-tu embrassée ?
— Parce que cela me faisait de la peine de t’entendre marmonner. Tante Polly regarda son neveu dans le blanc des yeux et demeura convaincue.
— Allons, embrasse-moi encore, dit-elle ; dépêche-toi de retourner à l’école ou tu seras en retard, et tâche de ne plus me tourmenter.

Allons, embrasse-moi
Dès qu’il eut le dos tourné, elle éprouva de nouveaux doutes. Elle courut à une armoire, d’où elle tira la jaquette que Tom portait à son départ pour le repaire des pirates et qui maintenant n’était plus qu’une loque. Au moment de se livrer à une enquête, elle s’arrêta d’un air indécis.
— Non, je n’ose pas, se dit-elle. Pauvre enfant, il a peut-être menti. En tout cas le bon Dieu lui pardonnera ce mensonge-là, j’en suis sûre, car il l’a fait pour me consoler. Mais je ne veux pas regarder, je ne veux pas savoir qu’il a menti.
Elle remit la jaquette dans l’armoire et demeura un instant rêveuse. Deux fois elle allongea le bras pour reprendre le vêtement, et deux fois elle s’abstint. Enfin elle s’arma de courage en se disant : « C’est un mensonge innocent et je ne m’en affligerai pas trop. » Une minute après elle avait fouillé dans la poche et lisait à travers ses larmes le message griffonné sur le bout d’écorce.
— Moi aussi je pourrais lui pardonner maintenant, s’écria-t-elle, quand même il aurait commis un million de péchés !
Chapitre XXI
UNE BROUILLE
La façon dont tante Polly venait d’embrasser Tom avait appris au coupable qu’elle ne lui en voulait plus, et il était parti le cœur léger. Il eut la chance de rencontrer Becky à l’entrée de l’allée des platanes, allée où depuis de longues années il n’existait plus un seul arbre. Comme il obéissait toujours à l’inspiration du moment, il courut vers sa petite camarade et lui dit :
— Je me suis mal conduit ce matin, Becky ; mais j’avoue mes torts. Soyons amis, voulez-vous ?
Becky s’arrêta et le toisa d’un air dédaigneux.
— Je vous prie de me laisser en paix, monsieur Thomas Sawyer, répliqua-t-elle. Je ne vous parlerai plus de ma vie.
Elle hocha la tête, passa son chemin et gagna l’école. Tom demeura si interdit qu’il ne sut même pas répondre : « Oh ! là là, je vais commander mon cercueil ! » Cette spirituelle riposte lui vint trop tard à l’esprit, de sorte qu’il garda le silence. Néanmoins, la colère l’étouffait, et lorsqu’il pénétra dans la cour de récréation, il regrettait que Becky ne fût pas un garçon, ce qui lui aurait permis de la rosser. Bientôt il se croisa avec elle et lança en passant une remarque beaucoup plus mordante que ne l’eût été la menace de l’achat prématuré d’un cercueil. Becky lui rendit avec usure la monnaie de sa pièce, et il n’en fallut pas davantage pour creuser un profond abîme entre M. Thomas Sawyer et Mlle Rebecca Thatcher. Il sembla même à cette dernière que l’heure de la classe ne sonnerait jamais, tant elle avait hâte de voir infliger à l’ex-pirate la correction que ne manquerait pas de lui attirer la maculature de la grammaire. Elle ne songeait plus à dénoncer Alfred Temple et à prévenir Tom du danger qui le menaçait.
Pauvre Becky ! Elle ne se doutait pas qu’elle allait se trouver exposée à un danger du même genre.
Le maître d’école, M. Dobbins, arrivait à l’âge mur, aigri par une ambition non satisfaite. Son vœu le plus cher était de devenir médecin. Il ne désespérait pas de conquérir tôt ou tard un diplôme de docteur, et il étudiait dans ce but. Chaque jour il tirait de son pupitre un gros in-octavo, dans la lecture duquel il s’absorbait dès que sa classe lui laissait un quart d’heure de loisir. Comment le maître, qui savait tout sur le bout des doigts, étudiait-il sans cesse le même livre ? On se perdait en conjectures et l’on mourait d’envie de jeter un coup d’œil sur le mystérieux volume ; mais l’occasion ne se présentait pas, le livre était toujours sous clef.
Or Becky, jetant par hasard un coup d’œil dans la salle d’étude, s’aperçut que M. Dobbins avait oublié de retirer la clef de son pupitre. La salle était déserte, personne ne faisait attention à elle ; en un clin d’œil le livre fut entre les mains de la petite curieuse. Le titre — Traité d’anatomie, par le docteur Jenesaiki — ne lui apprit pas grand’chose, et elle n’admira pas beaucoup le frontispice qui représentait un squelette aux os numérotés. Tandis qu’elle contemplait cette image peu attrayante, une ombre se projeta sur la page. L’ombre était celle de Tom. Becky mit une telle hâte à refermer le livre, qu’elle déchira le frontispice jusqu’au milieu. Elle replaça le malencontreux volume dans le pupitre et s’écria en frappant du pied :
— Tom Sawyer, je vous reconnais bien là ; c’est honteux d’espionner les gens pour voir ce qu’ils regardent !
— Vous vous trompez joliment, si vous croyez que je cours après vous, répliqua Tom. Je ne me doutais seulement pas que vous étiez là. — Vous devriez rougir, Tom Sawyer ! Vous avez tout vu et vous allez me dénoncer… Moi qui n’ai jamais été punie à l’école !… Tenez, je vous exècre !
Elle frappa de nouveau du pied et s’éloigna en pleurant. Tom, abasourdi par cette attaque inattendue, se tint un moment immobile.

C’est honteux d’espionner
— Que les filles sont bêtes ! se dit-il. Elle a peur de quelques coups de rotin sur les épaules. La belle affaire ! Ne voilà-t-il pas de quoi s’effrayer ! Non, mademoiselle pimbêche, je ne vous dénoncerai pas ; mais ça ne vous servira guère. Le vieux Dobbins fera ce qu’il fait toujours. Il dira : « Qui a déchiré ce livre ? » Personne ne répondra. Alors il nous demandera à tour de rôle : « Est-ce vous ? est-ce vous ? » Et lorsqu’il arrivera à Becky, il saura à quoi s’en tenir sans qu’elle ouvre la bouche. Les filles n’ont pas de toupet ; elles deviennent rouges ou blanches tout de suite, au lieu de prendre un air étonné. Décidément, miss Becky Thatcher est dans de vilains draps. J’en suis fâché pour elle, mais ce n’est pas ma faute.
Sur ce, Tom rejoignit ses camarades qui jouaient dans la cour. Le maître ne tarda pas à se montrer et la cloche sonna. Tom ne parut pas s’intéresser beaucoup à ses études. Chaque fois qu’il lançait un regard furtif de l’autre côté de la salle, l’expression du visage de Becky le peinait. Tout bien considéré, il ne voulait pas la plaindre, et cependant il s’apitoyait malgré lui. Bientôt la mésaventure arrivée à la grammaire fut découverte, et il eut à s’occuper de ses propres affaires. Le maître s’obstinait à ne pas considérer des sinistres de ce genre comme des accidents. Tom se vit accusé d’avoir vidé son encrier sur son livre afin d’avoir un prétexte pour ne pas apprendre sa leçon. Ses démentis passèrent pour des circonstances aggravantes aux yeux du juge implacable. Becky, qui avait cherché à se persuader qu’elle serait ravie de ce résultat, s’aperçut qu’elle s’était trompée. Au moment décisif, elle fut tentée de dénoncer le vrai coupable ; mais elle s’abstint.
— Il ne manquera pas de raconter que c’est moi qui ai déchiré l’image, se dit-elle. Je n’ouvrirai pas la bouche, quand il s’agirait de lui sauver la vie !
Tom reçut sa correction et retourna à sa place sans trop se plaindre de son sort, car il pensait qu’à son insu il avait peut-être renversé l’encrier sur son livre dans une escarmouche avec ses voisins. Il avait nié pour la forme et maintenu son dire par principe.
Une heure entière s’écoula. Le bourdonnement de la classe portait au sommeil et le maître dodelinait de la tête sur son trône. Il finit par se redresser, bâilla, ouvrit son pupitre, parut sur le point de prendre son fameux livre et demeura indécis. La plupart des élèves levèrent les yeux d’un air indifférent ; mais deux d’entre eux suivaient avec inquiétude les mouvements de M. Dobbins. Ce dernier feuilleta d’abord d’un doigt distrait le livre qu’il avait posé devant lui, puis il s’accouda sur son pupitre et se disposa à lire. Tom lança un regard du côté de Becky et oublia aussitôt sa querelle. Il fallait agir et agir vile. Mais l’urgence même du cas paralysa ses facultés inventives. Enfin une excellente idée lui traversa l’esprit. Il s’élancerait à l’improviste, empoignerait le livre et disparaîtrait sans laisser au lecteur le temps de revenir de sa surprise. Par malheur, lorsqu’il se fut décidé à exécuter cet audacieux projet, il était déjà trop tard.

Qui a déchiré ce livre ?
M. Dobbins releva brusquement la tête, frappa un coup sec sur son pupitre et contempla la classe d’un air qui fit trembler jusqu’à Sid, l’élève modèle. Il y eut un intervalle de profond silence qui dura au moins deux minutes ; le maître emmagasinait sa colère, pour employer l’expression de Tom.
— Qui a déchiré ce livre ? demanda M. Dobbins d’une voix retentissante.
Personne ne souffla mot. On aurait entendu voler une mouche. M. Dobbins passa une inspection rapide de tous les visages dans le vain espoir d’y trouver un indice révélateur.
— Benjamin Rogers, est-ce vous ?
— Non, monsieur.
— Joseph Harper, est-ce vous ?
Nouvelle dénégation. Ces procédés inquisitoriaux infligeaient à Tom une lente torture. Combien de temps cela allait-il durer ? Il ne tarda guère à désirer que le supplice eût duré plus longtemps ; car l’inquisiteur, après avoir scruté les physionomies des garçons, réfléchit un instant et dirigea son regard du côté des filles.
— Amy Laurence, est-ce vous ?
Amy secoua la tête.
— Suzanne Harper, est-ce vous ?
— Non, non et non !
Becky était la voisine de celle qui venait de protester avec énergie contre une question dont elle paraissait s’indigner ; Tom se mit à trembler ; en effet, la situation était critique.
— Rebecca Thatcher, est-ce vous qui avez déchiré ce livre ? Regardez-moi en face, s’il vous plaît.
Becky pâlissait à vue d’œil. Cette fois Tom agit avec la promptitude qui convient à un héros. Il se leva en criant :
— C’est moi qui l’ai déchiré.
Les élèves contemplèrent le coupable supposé d’un air ébahi, tant son aveu prématuré les surprenait, car la tradition voulait qu’en pareille circonstance on n’avouât jamais un méfait, à moins d’avoir été interrogé directement.
Tom s’avança à l’ordre pour subir sa peine. Il savait qu’il n’en serait pas quitte à bon marché ; mais il sentit qu’il aurait affronté une punition cent fois plus dure afin de mériter le regard de reconnaissance que lui adressa Becky. Fier de s’être dévoué, il reçut, sans laisser échapper la moindre plainte, la plus impitoyable volée que M. Dobbins eût jamais administrée, et il accepta avec une noble indifférence un surcroît de punition qui le condamnait à deux heures de retenue après la classe, car il se doutait que quelqu’un l’attendrait à sa sortie de prison pour le remercier.
Tom se coucha ce soir-là en formant des projets de vengeance contre Alfred Temple, Dans un accès de gratitude et de repentir, Becky lui avait raconté l’acte de traîtrise dont elle avait été témoin et s’était reproché son silence. Mais les idées de Tom devinrent bientôt plus riantes, et lorsqu’il s’endormit il croyait entendre la voix de Becky murmurer de nouveau à son oreille :
— Ô Tom, comment as-tu pu te montrer si généreux !
Chapitre XXII
LE PROCÈS
L’heure des vacances sonna. Tom, comme toutes les années du reste, reconnut qu’elles ne contribuaient pas à lui faire paraître les jours moins longs. La rougeole avait sévi à Saint-Pétersbourg ; le pique-nique avait été ajourné, et Becky était retournée à Constantinople, où elle devait passer une partie des vacances chez un de ses oncles. Les cirques, les ménageries nomades oubliaient le chemin de la ville. Aussi l’existence semblait-elle bien terne a notre héros. Enfin Saint-Pétersbourg sortit de sa somnolence, grâce au procès de Jack Potter, qui redevint bientôt le sujet de toutes les conversations. Tom, qui avait presque réussi à étouffer ses terreurs, aurait préféré que l’on parlât de tout autre chose. Sa conscience troublée lui donnait à croire que les remarques que l’on faisait en sa présence étaient des ballons d’essai lancés à son adresse. Quoiqu’il n’eût pas le moindre motif pour supposer qu’on le soupçonnât de pouvoir fournir des renseignements sur l’assassinat, ces commérages le mettaient mal à l’aise et amenaient une sueur froide sur son front. Il finit un jour par entraîner Huck dans un endroit désert. Il sentait que ce serait un soulagement pour lui de desceller sa langue, et il tenait en outre à savoir si son ami avait gardé le secret.
— Huck, tu n’as parlé à personne de cette histoire ? demanda-t-il.
— Naturellement, je n’en ai pas parlé.
— Pas un mot ?
— Pas l’ombre d’un mot. — Et personne ne te décidera jamais à parler, hein ?
— Jamais de la vie ! Je n’ai pas envie de me faire noyer par ce gredin de métis.
— À la bonne heure ! Nous ne courons aucun risque tant que nous nous tairons. Si nous jurions encore ? Ce serait plus sûr.
— Je ne demande pas mieux.
Le serment fut renouvelé avec toutes les formalités indispensables.
— Maintenant, tiens-toi sur tes gardes, Huck, dit Tom. On est tenté de jacasser lorsqu’on écoute ces bavards.
— Je crois bien. Jack Potter, Jack Potter, toujours Jack Potter ! Ils n’ont que ce nom-là à la bouche. Ils ne savent rien ; mais ça ne les empêche pas de dire qu’il mérite d’être pendu.
— Est-ce que tu ne le plains pas ?
— Tu peux parier que je le plains autant que toi, répliqua Huck, Il ne compte pas plus que moi, c’est vrai ; mais il n’a fait de mal à personne. Il pêchait juste assez pour gagner de quoi se griser et dormait le reste du temps. Il y a des masses d’individus qui ne travaillent guère et on ne leur met pas la corde au cou. Non, Jack Potter n’est pas méchant. Un jour il m’a donné la moitié d’un poisson quand il n’y en avait pas trop pour deux, et des fois j’aurais été dans une mauvaise passe sans lui.
— Il m’a rendu service aussi. Il raccommodait mes cerfs-volants et attachait les hameçons à mes lignes. Je voudrais le tirer de là.
— Nous ne pouvons pas le tirer de là, Tom. D’ailleurs, il n’en serait pas plus avancé ; on le reprendrait bien vite.
— C’est vrai ; mais ça m’agace d’entendre tout le monde tomber sur lui.
— Moi aussi, ça m’agace, Tom. Ils jurent qu’il a la mine d’un assassin et s’étonnent qu’il n’ait pas été pendu il y a longtemps. — Il y en a même qui disent que, si par hasard il était acquitté, ils se chargeraient de le pendre.
— Et tu peux être sûr qu’ils tiendraient parole.
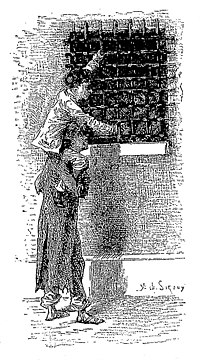
Tom et Huck visitent Jack Potter
Les deux jeunes garçons eurent un long entretien qui ne contribua nullement à les consoler. L’heure du crépuscule les trouva rôdant aux environs de la petite geôle avec un vague espoir qu’il arriverait quelque chose qui rendrait leur cas de conscience moins difficile à résoudre. Mais il n’arriva rien. Les anges et les fées ne semblaient pas s’intéresser à l’infortuné captif.
Ils s’approchèrent, ainsi qu’ils l’avaient souvent fait, de la fenêtre grillée afin de passer du tabac et des allumettes à Jack Potter. La cellule se trouvait au rez-de-chaussée et aucun gardien ne se montrait. La reconnaissance avec laquelle le prisonnier accueillait leurs dons leur inspirait toujours des sentiments de remords qui cette fois furent plus profonds que jamais. Ils s’accusèrent de trahison et de lâcheté lorsque Potter leur dit :
— Vous vous êtes joliment bien conduits avec moi, garçons. Je me dis souvent ; J’étais toujours à raccommoder les jouets des enfants ; je leur montrais les bons endroits pour pêcher, je les obligeais le plus que je pouvais, et pas un d’eux ne songe au pauvre Jack, maintenant qu’il est dans la peine. Mais Tom et Huck ont songé à lui. Ah ! garçons, j’ai commis un crime horrible. J’avais trop bu pour savoir ce que je faisais. On me pendra et je l’ai mérité. Allons, ne parlons plus de ça. Je serais fâché de vous causer de la peine. Mais je veux vous donner un conseil. Ne vous enivrez jamais et vous ne serez jamais enfermés ici… Tenez-vous un peu plus à gauche ; là, je vous vois mieux. Bons petits visages amis ! Grimpez sur le dos l’un de l’autre et laissez-moi les toucher. Bien. Laissez-moi vous serrer les mains ; ici les vôtres passeront entre les barreaux, les miennes sont trop grosses. Mains petites et faibles, mais elles ont aidé Jack et elles l’aideraient davantage, si elles pouvaient.
Tom revint à la maison très abattu, et son sommeil fut troublé par un cauchemar. Le lendemain et le surlendemain, il rôda autour du tribunal, dont une fascination presque irrésistible le poussait à franchir le seuil et où il s’abstint d’entrer. Huck semblait non moins indécis. Les deux amis s’évitaient. Chacun d’eux s’éloignait de temps à autre ; mais la même fascination lugubre les ramenait bientôt. Tom ouvrait les oreilles dès qu’un groupe d’oisifs quittait la salle d’audience. Il regrettait invariablement d’avoir écouté, car il n’apprenait que des nouvelles attristantes ; les mailles du filet impitoyable de la justice se serraient de plus en plus autour de l’infortuné Potter. À la fin du second jour on déclarait que le témoignage de Joe l’Indien se trouverait pleinement confirmé et que le verdict du jury ne laissait plus aucun doute.
Ce soir-là, Tom s’absenta après dîner et rentra à une heure indue en passant par la croisée. Il était si agité qu’il eut beaucoup de peine à s’endormir. Le lendemain matin, on se dirigea en foule vers le tribunal, car ce devait être le grand jour. Au bout d’une longue attente les jurés entrèrent à la file et s’assirent. Peu de temps après, Potter fut introduit. Il était pâle et hagard. On lui avait mis des menottes, bien que son air ahuri et résigné ne permît pas de supposer qu’il songeât à offrir la moindre résistance. Tous les regards demeuraient fixés sur lui ; mais il n’osait lever les yeux. Quant à Joe l’Indien, aussi impassible que jamais, il ne semblait nullement désireux de se soustraire à l’attention publique. Deux ou trois minutes plus tard, le juge fit son entrée, et le shérif annonça que la séance était ouverte. Les avocats échangèrent quelques paroles et étalèrent devant eux leurs paperasses. Ces délais et d’autres détails préliminaires eurent pour effet de surexciter l’impatience des spectateurs.
Enfin on appela le premier témoin à charge, qui déclara que, le matin même du crime, passant de très bonne heure au bord de la rivière, il avait aperçu l’accusé en train de se laver. Le fait lui avait paru d’autant plus surprenant que le prévenu, qui en général se montrait hydrophobe, s’était éloigné en toute hâte, comme s’il craignait d’être vu. L’avocat de Potter n’adressa aucune question à l’auteur de cette déposition ; il dit d’un ton distrait, en employant la formule de la justice américaine :
— Renvoyez le témoin.
Le prévenu leva un moment les yeux, mais il les baissa de nouveau lorsque son défenseur, au lieu de répondre à cette interrogation muette, ajouta :
— Il peut se retirer ; je n’ai rien à lui demander.
Un second témoin prouva que le couteau ramassé près du cadavre appartenait à Jack Potter. Le défenseur se contenta de répéter :
— Renvoyez le témoin.
Cette fois encore il s’abstint de poser la moindre question.
Pourquoi renonçait-il à sa tactique habituelle, qui consistait à accabler les témoins de questions et les amener à se contredire ? Les visages de l’auditoire commencèrent à trahir un certain mécontentement. Cet avocat avait-il donc l’intention de sacrifier la vie de son client sans tenter le moindre effort pour le sauver ?
D’autres témoins vinrent parler à tour de rôle de la conduite suspecte de Potter lorsqu’il était apparu sur la scène du meurtre. Ils quittèrent la sellette sans avoir été interrogés contradictoirement. Chaque détail des circonstances compromettantes survenues au cimetière durant la mémorable matinée que Tom se rappelait trop bien fut mis en relief par des citoyens dignes de foi, mais pas un seul d’entre eux ne fut interpellé par l’avocat de Potter.

Tom devant le Tribunal
La mauvaise humeur de l’auditoire se manifesta par des murmures qui provoquèrent une remontrance de la part de la cour. L’avocat de la partie civile, jugeant la cause gagnée, crut inutile de prononcer une longue plaidoirie.
— Messieurs les jurés, dit-il, les témoignages de tant d’honorables citoyens qui ont déposé sous la foi du serment et dont la simple parole suffirait, ne laissent aucun doute sur la culpabilité du malheureux prévenu. Les faits ne se discutent pas — nous nous en rapportons à votre esprit de justice.
Potter laissa échapper un gémissement, se cacha le visage dans les mains et parut sur le point de se trouver mal. Un silence pénible régna dans la salle. La parole était au défenseur de l’accusé, qui s’exprima en ces termes :
— Votre Honneur, au début de ce procès nous avons donné à entendre que notre intention était de prouver que notre client, s’il a commis l’horrible crime dont on l’accuse, a agi sous l’influence d’un délire aveugle et irresponsable produit par l’ivresse. Nous avons changé d’avis. Nous n’invoquerons pas ce moyen de défense… Huissier, appelez le témoin Thomas Sawyer.
Une expression de surprise intriguée vint alors animer tous les visages, sans excepter celui de Potter. Ses regards se fixèrent sur Tom Sawyer, dès que celui-ci se fut levé et eut gagné l’espace vide réservé aux témoins. Bien qu’il fût en réalité très effrayé, notre héros prêta serment d’un air assez résolu.
— Thomas Sawyer, où étiez-vous le 17 juin, vers l’heure de minuit ? demanda le défenseur.
Tom lança un coup d’œil dans la direction de Joe l’Indien, et la parole lui fit défaut. L’auditoire prêtait l’oreille en retenant son haleine ; mais le témoin semblait frappé de mutisme. Au bout d’une minute ou deux il reprit courage et répondit, de façon à se faire entendre d’une partie de l’assistance :
— Dans le cimetière. — Un peu plus haut, s’il vous plaît. Vous étiez… ?
— Dans le cimetière.
— Vous trouviez-vous près de la tombe de Williams le Borgne ?
— Oui, monsieur.
— Tâchez de parler un peu plus haut. À quelle distance étiez-vous de cette tombe ?
— Aussi près que je le suis de vous.
— Étiez-vous caché ?
— J’étais caché.
— Où cela ?
— Derrière les arbres qui se trouvent à côté de la tombe.
Un tressaillement presque imperceptible agita le corps de Joe l’Indien, qui jusqu’alors avait écouté sans sourciller.
— Il y avait quelqu’un avec vous, je crois, de sorte que, si cela était nécessaire, un autre témoin pourrait confirmer votre dire ?
— Oui, monsieur. Je suis allé au cimetière avec…
— Il est inutile de nommer votre compagnon. Nous le citerons, si nous avons besoin de lui. Maintenant, Thomas Sawyer, parlez sans crainte. Racontez-nous ce qui est arrivé, et n’ayez pas peur.
Tom commença son récit en s’embrouillant un peu ; mais il se mit bientôt en veine, et les paroles coulèrent de source. On n’entendait d’autre bruit que celui de sa voix. On ne voyait que lui ; on retenait son haleine pour mieux l’écouter. Sans se douter qu’il imitait les grands romanciers, il surexcitait la curiosité de son public haletant. Il arriva enfin au bout de sa déposition.
— Alors le docteur, d’un coup de la lourde planche, renversa Jack Potter, Joe l’Indien sauta sur le couteau et…
Le récit fut soudain interrompu par des cris de détresse. Le métis, renversant ceux qui se trouvaient sur son passage, venait de gagner une croisée ouverte et de disparaître.
Chapitre XXIII
INQUIÉTUDES DE TOM
Tom redevint tout à coup un héros. Les gens âgés le comblaient d’éloges, les jeunes l’enviaient. La presse s’efforça de rendre son nom immortel, car le journal de Saint-Pétersbourg le porta aux nues. Certains jaloux, qui feignaient d’admirer son courage, allèrent même jusqu’à prédire qu’il serait président de la république un jour ou l’autre, s’il ne lui arrivait pas d’être tué par Joe l’Indien avant d’avoir atteint l’âge légal.
Ainsi que cela se voit souvent, le public se mit sans transition à penser du prétendu meurtrier autant de bien qu’il en avait dit de mal. Du reste, ce revirement d’opinion fut justifié. La leçon avait été trop terrible pour que Jack Potter n’en profitât pas ; s’il ne cessa pas de boire, il cessa de s’enivrer.
Tom eut donc des jours tissés d’or et de soie ; mais il passait des nuits affreuses. Joe l’Indien, l’œil menaçant, un couteau à la main, le poursuivait dans ses rêves. Pour rien au monde il ne se serait décidé à sortir après le coucher du soleil. Le pauvre Huck éprouvait les mêmes tribulations, car son ami avait tout raconté à l’avocat la veille du grand coup de théâtre, et il craignait que son rôle dans l’affaire ne vînt à être connu, bien que la fuite du coupable l’eût dispensé de figurer comme témoin au procès. Le défenseur de Potter, il est vrai, avait promis de garder le secret. La belle garantie ! Puisque la conscience bourrelée de Tom l’avait traîné à contre-cœur chez l’homme de loi au milieu de la nuit et avait arraché un aveu téméraire à des lèvres qu’un formidable serment aurait dû tenir cadenassées, sur qui pouvait-on compter désormais ?

L’agent de police
Chaque jour la reconnaissance de Jack Potter rendait Tom heureux d’avoir parlé ; mais chaque nuit il regrettait de s’être montré aussi courageux. Parfois il souhaitait que Joe l’Indien ne fût jamais pris ; parfois il espérait apprendre qu’on venait de l’arrêter. Il sentait qu’il ne respirerait jamais en paix tant que cet homme ne serait pas mort et qu’il n’aurait pas vu son cadavre.
L’offre d’une bonne récompense stimula le zèle des agents officiels et d’une foule d’amateurs officieux. Leurs recherches demeurèrent sans résultat. Un de ces merveilleux policiers qui savent tout, qui voient tout, arriva de Saint-Louis. Le détective flaira à droite et à gauche, sonda, fureta et secoua la tête d’un air sagace. Il finit par mettre le nez sur ce que les gens de son métier ne manquent jamais de découvrir — c’est-à-dire sur une piste. Mais on ne saurait pendre une piste pour crime d’assassinat. Aussi, lorsque cet homme habile eut rempli sa mission et fut retourné chez lui, Tom ne se jugea pas plus à l’abri qu’auparavant. Néanmoins, comme Joe l’Indien continuait à ne pas donner signe de vie, chaque jour qui s’écoulait rendait de moins en moins vives les appréhensions des deux témoins du crime.
Chapitre XXIV
LA MAISON HANTÉE
Il y a, dans l’existence de tout jeune Américain bien constitué, un moment où il éprouve une envie irrésistible de déterrer un trésor. Cette heure psychologique sonna un beau jour pour Tom. Il parcourut la ville à la recherche de Joe Harper sans parvenir à le rencontrer. Il se rendit alors chez Ben Rogers ; mais Ben ne voulut pas renoncer à une partie de pêche projetée la veille. Huck Finn lui tomba sous la main et il résolut, faute de mieux, de prendre pour collaborateur son ex-lieutenant. Huck ne se fit pas prier. Il ne refusait jamais de s’embarquer dans une entreprise qui n’exigeait aucun capital ; ses loisirs lui pesaient, et pour lui le temps n’était pas de l’argent.
— Je ne demande pas mieux que de déterrer un trésor, dit-il. Où creuserons-nous ? demanda-t-il.
— N’importe où, répliqua Tom.
— Est-ce qu’il y a des trésors partout ?
— Non, ma foi ! On les cache souvent dans de drôles d’endroits, Huck — quelquefois dans une île déserte ; quelquefois dans une caisse que l’on enterre sous un arbre, juste à la place où l’ombre d’une branche morte tombe à minuit ; quelquefois sous le plancher d’une maison hantée — c’est plus sûr, parce que beaucoup de gens ont peur d’entrer dans ces maisons-là.
— Qui est-ce qui cache le trésor ?
— Les voleurs, parbleu !
— Ils ne viennent donc pas le reprendre ? — Si. Seulement ils ne se rappellent plus les marques qu’ils ont faites. Un beau matin, quelqu’un ramasse un bout de papier qui donne le moyen de retrouver les marques, et alors il n’y a plus qu’à creuser.
— As-tu un de ces papiers, Tom ?
— Non ; je voudrais bien en avoir un.
— Sans les marques, nous ne trouverons jamais la cachette.
— Je n’ai pas besoin des marques. Ils cachent toujours leur trésor sous le parquet d’une maison hantée, ou dans une île, ou sous une branche morte. Nous avons déjà fouillé un peu dans l’île Jackson et nous recommencerons un de ces jours. En attendant, il y a une vieille maison hantée près de l’ancienne brasserie et je connais des tas d’arbres avec une branche morte qui a l’air d’un bras noir.
— Est-ce qu’il y a un trésor sous tous ces arbres-là ?
— Mais non ! mais non ! Voilà une bête de question !
— Alors comment saurons-nous quel arbre choisir ?
— Nous chercherons sous tous.
— Ça prendra du temps.
— Eh bien, après ? Si tu tombes sur un coffre plein de perles et de diamants ou sur un pot de grès rempli de dollars, tu ne te plaindras pas de ta peine, je crois.
Le visage de Huck s’anima d’une façon inusitée.
— Je me contenterai des dollars, dit-il ; je me moque des perles. Mais où creuserons-nous d’abord ?
— Si nous commencions par le grand arbre qui se trouve sur la colline, presque au bord du bois ? Il n’a qu’une seule branche morte, de sorte que nous ne risquons pas de nous tromper.
— Ça va !
Après s’être procuré aux dépens de tante Polly une pioche et une pelle, ils se mirent en route pour leur promenade de trois milles. Ils arrivèrent au but tout essoufflés et s’assirent à l’ombre d’un orme. — Quand nous aurons trouvé le trésor, que feras-tu de ta part ? demanda Tom.
— Je mangerai chaque jour un bon morceau de gigot et je boirai un verre de limonade gazeuse, répliqua Huck. J’en ai bu une fois, et c’est joliment bon. J’irai tous les soirs au cirque. Je m’amuserai, je t’en réponds.

Que feras-tu de ta part ?
— Et tu ne mettras rien de côté ?
— Pour quoi faire ?
— Pour avoir de quoi t’amuser plus tard.
— Ça ne me servirait à rien. Si je ne me dépêchais pas, mon père saurait bien vite que j’ai de l’argent et il reviendrait me le prendre. Que feras-tu de ta part, toi ?
— J’achèterai un tambour et un vrai sabre et un grand chien, et je me marierai.
— Te marier ! Par exemple ! Ne donne donc pas dans cette bêtise-là.
— C’est une affaire arrangée.
— Tant pis. Je te croyais plus de bon sens. Vois mon père et ma mère — ils se battaient du matin au soir.
— On ne se bat pas toujours quand on se marie. Ma femme ne se battra avec personne.
— Tom, elles se ressemblent toutes. Ta tante Polly n’est pas méchante et elle te bat.
— Parce qu’elle est plus vieille que moi ; ce n’est pas la même chose.
— C’est égal ; à ta place, j’y regarderais à deux fois. Comment s’appelle-t-elle ?
— Je te le dirai plus tard. Qu’est-ce que cela te fait ?
— Vois-tu, si tu te maries, je serai plus seul que jamais.

Où chercherons-nous un autre trésor ?
— Pas du tout. Tu viendras demeurer avec nous. À présent, à l’ouvrage.
Ils se mirent à l’œuvre. Après avoir creusé et transpiré pendant une demi-heure sous la branche qui avait l’air d’un bras noir, ils n’avaient rien découvert. Une seconde demi-heure de travail ne donna pas un meilleur résultat.
— Est-ce qu’ils enterrent toujours leur trésor aussi bas ? demanda Huck, qui, sauf sur la question du mariage, se fiait à l’expérience de son ami.
— Pas toujours. Je commence à croire que nous n’avons pas essayé au bon endroit.
Ils tracèrent une nouvelle ligne et recommencèrent leurs fouilles. La fatigue les empêcha de travailler avec la même ardeur qu’au début ; ils creusèrent néanmoins un trou d’une dimension respectable. Enfin Huck se reposa sur sa pelle, essuya avec sa manche la sueur qui perlait sur son front, et dit :
— Où chercherons-nous un autre trésor après avoir déterré celui-ci ? — Je crois que nous ferons bien d’essayer le vieux chêne de la colline de Cardiff, derrière la maison de la veuve.
— Oui, l’endroit me paraît bon ; mais la veuve réclamera sa part de la trouvaille. Le terrain est à elle.
— Allons donc ! Un trésor caché appartient à celui qui le trouve, j’ai lu ça dans un livre. Personne n’a rien à y voir.
Encouragé par cette réponse, Huck reprit son outil ; bientôt, comme la jarre et le coffre attendus n’apparaissaient pas, il s’écria :
— Nous nous trompons encore d’endroit ; qu’en penses-tu ?
— Je n’y comprends rien. Ce sont peut-être les fées qui nous contrarient.
— Pas probable, Tom. Les fées ne peuvent pas tracasser le monde en plein jour.
— Tu as raison, je n’y songeais pas. Bon ! je sais à quoi cela tient. Nigauds que nous sommes ! Pour savoir où l’on doit creuser, la première chose à faire, c’est de marquer l’endroit où l’ombre de la branche morte tombe à minuit.
— À minuit ! s’écria Huck.
— Oui, à minuit, répéta Tom. Il va falloir revenir ce soir. Si quelqu’un voyait ces trous, on devinerait tout de suite qu’il y a un trésor sous l’arbre et nous serions volés.
Le même soir ils se trouvèrent de nouveau sur le lieu de leurs fouilles. Ils s’assirent sous un chêne pour attendre le lever de la lune. L’endroit était solitaire et d’anciennes traditions rendaient l’heure solennelle — l’heure où les esprits mêlent le murmure de leur voix indistincte au bruissement des feuilles, où des fantômes se tiennent blottis dans tous les coins sombres. Un chien de garde poussa dans le lointain un aboiement lugubre auquel un hibou répondit par son cri sépulcral. Nos chercheurs de trésor, impressionnés par le souvenir de leur visite au cimetière, ne semblaient guère disposés à causer. À l’heure voulue, ils marquèrent avec soin la ligne que l’ombre de la branche traçait sur le sol et commencèrent à creuser. Cette fois la réussite leur paraissait certaine. Plus ils travaillaient, plus l’intérêt qu’ils prenaient à leur tâche augmentait. Le trou avait déjà atteint une assez grande profondeur. Chaque fois qu’un obstacle faisait résonner la pioche, leur cœur battait plus fort ; mais chaque fois ils éprouvaient une nouvelle déception : l’obstacle n’était qu’une pierre. À la longue Tom se découragea.
— Ce n’est pas la peine de nous éreinter, Huck, dit-il ; nous nous sommes encore trompés d’endroit.
— Impossible, Tom ; nous avons marqué l’ombre avec une corde.
— Oui, je le sais bien ; mais il y a autre chose.
— Quoi donc ?
— Nous n’avons fait que deviner l’heure ; cinq minutes trop tôt, cinq minutes trop tard suffisent pour tout gâter.
Huck laissa tomber sa pelle.
— C’est clair, dit-il. Nous pouvons renoncer à ce trésor-là ; nous ne saurons jamais l’heure au juste. D’ailleurs je me méfie. Les fées et les fantômes se promènent la nuit. Je me figure toujours qu’il y en a une derrière mon dos et je n’ose pas me retourner, parce qu’il y en a peut-être d’autres devant moi qui guettent une occasion.
— Je suis à peu près dans le même cas, Huck. Mais nous n’avons essayé qu’un arbre, et il ne fallait pas s’attendre à trouver le trésor sous la première branche venue. Enfin, il nous reste la maison hantée qui est au bas de la colline.
— Je n’aime pas trop les maisons hantées, répliqua Huck, surtout celle-là, près de laquelle personne n’ose passer, même en plein jour. Pourquoi évite-t-on de flâner par là ?
— Tout bonnement parce que personne ne tient à s’approcher d’un endroit où quelqu’un a été assassiné. On n’a jamais vu un revenant autour de cette maison — rien qu’un feu follet qui s’envolait par une des fenêtres.
— Justement ! Lorsqu’on voit une de ces lumières bleues gambader quelque part, on peut parier que le fantôme n’est pas loin. Ça va de soi, car il n’y a que les fantômes qui s’en servent.

La maison hantée
— Je ne dis pas le contraire ; en tout cas, comme ils ne se montrent qu’à minuit, nous serions bien bêtes de nous effrayer en plein jour.
— Allons, je me risquerai ; mais rappelle-toi que je n’y vais pas de bon cœur.
Tout en courant, ils redescendaient la colline. Là, au milieu de la vallée, se dressait la maison hantée. Elle était complètement isolée ; les clôtures qui l’entouraient jadis avaient depuis longtemps disparu ; les mauvaises herbes couvraient jusqu’aux marches d’entrée ; la cheminée s’était écroulée ; les baies des croisées étaient vides et une partie de la toiture s’était effondrée. Les futurs explorateurs contemplèrent un instant l’édifice délabré, s’attendant presque à voir une lueur bleuâtre apparaître à chaque croisée ; puis, se parlant à voix basse, ils obliquèrent à droite et poursuivirent leur route à travers le bois qui couvrait, du côté de Saint-Pétersbourg, la colline de Cardiff.
Chapitre XXV
LE TRÉSOR CACHÉ
Le lendemain, vers midi, Tom et Huck arrivèrent au pied de l’arbre à la branche morte. Ils venaient chercher leurs outils. Le premier, dans sa hâte de visiter la maison hantée afin de commencer les fouilles, bouillait d’impatience. Le second, séduit par l’appât du trésor dont son ami lui avait certifié l’existence, montrait plus d’ardeur que la veille ; mais tout à coup il s’écria ;
— Dis donc, Tom, quel jour sommes-nous ?
Tom réfléchit un instant, puis regarda son compagnon d’un air effrayé.
— Vendredi ! s’écria-t-il. Comment n’ai-je pas songé à cela ? Si nous avions commencé aujourd’hui, nous aurions pu revenir vingt fois sans rien trouver. Plantons là le trésor, et jouons à Robin Hood.
Ils jouèrent donc à Robin Hood durant tout l’après-midi, lançant de temps à autre un regard soucieux du côté de la maison hantée et échangeant des remarques sur le succès probable de l’expédition ajournée. Le soleil commençait à décliner lorsqu’ils disparurent dans le bois de Cardiff et reprirent le chemin de la ville.
Le lendemain, ils furent exacts au rendez-vous qu’ils s’étaient donné au même endroit. Après s’être reposés à l’ombre en fumant, ils se remirent à creuser dans leur dernier trou. Huck n’avait pas grand espoir et il ne travailla que par acquit de conscience, parce que Tom affirmait que l’on avait vu des gens abandonner leurs fouilles à six pouces du trésor, de sorte qu’un jour ou deux plus tard le premier venu avait pu s’en emparer en donnant un seul coup de bêche. Cette fois cependant, ils durent reconnaître qu’ils étaient loin d’être arrivés à six pouces de la cachette, et ils s’éloignèrent, leurs outils sur l’épaule, convaincus qu’ils avaient rempli tous les devoirs qui incombent à des explorateurs scrupuleux.
Lorsqu’ils s’arrêtèrent en face de la maison hantée, ils ne se sentirent pas rassurés. Son aspect désolé, le silence et la solitude qui régnaient autour de cette habitation déserte leur parurent lugubres. Ils hésitèrent d’abord à s’aventurer à l’intérieur, mais ils s’enhardirent peu à peu jusqu’à s’approcher du seuil et à jeter un regard craintif par l’ouverture où se trouvait autrefois la porte. Ce regard leur montra une couche de mauvaises herbes qui remplaçait le plancher, une vieille cheminée démantelée et un escalier en ruine. Çà et là se balançaient des filandres de toiles d’araignée que les tisseuses avaient abandonnées. Enfin ils entrèrent d’un pas circonspect, se gardant bien de parler, l’oreille tendue, prêts à battre en retraite à la moindre alerte.
N’apercevant rien de suspect, ils s’aguerrirent bientôt et examinèrent le local, admirant leur propre courage et s’en étonnant un peu aussi. Ils songèrent ensuite à gravir l’escalier. C’était en quelque sorte se couper la retraite ; mais ils se mirent à se défier l’un et l’autre, tactique qui ne pouvait avoir qu’un seul résultat. Ils déposèrent leurs outils contre un mur et montèrent. Le premier étage était aussi dégradé que le rez-de-chaussée. Dans un coin s’ouvrait un cabinet obscur qui promettait de cacher un mystère ; mais la promesse était un leurre, le cabinet ne contenait rien. Rendus courageux par l’impunité, ils se disposaient à redescendre afin de commencer leurs fouilles, lorsque Tom retint son compagnon par le bras.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demanda Huck. Tu m’as fait peur.
— Sh… Écoute. Entends-tu maintenant ?
— Oui, on cause devant la porte. Sauvons-nous !
— Ne bouge pas ; ils sont déjà entrés. Voyons qui c’est. N’ouvre plus la bouche, Huck.
Nos chercheurs de trésor s’allongèrent à plat ventre, l’œil collé à un des trous que les nœuds avaient laissés dans le plancher.
Deux hommes venaient de pénétrer dans la maison hantée. Chacun des enfants se dit :
— C’est le vieux sourd-muet espagnol qui rôde depuis trois ou quatre jours dans la ville ; je n’ai jamais vu l’autre.

Non ; c’est trop dangereux
L’autre avait la mine et la mise d’un de ces chenapans que l’on n’aime pas à rencontrer au coin d’un bois. L’Espagnol, enveloppé dans un sarapé, coiffé d’un sombrero, portait de larges favoris blancs et de longs cheveux d’une blancheur non moins vénérable. L’autre parlait à voix basse en entrant. Les nouveaux venus s’assirent par terre, adossés au mur, le visage tourné vers la porte. L’entretien fut repris ; le compagnon du vieil Espagnol cessa alors de chuchoter et ses paroles devinrent plus distinctes.
— Non, mille fois non, dit-il ; j’y ai bien réfléchi. Cela me paraît beaucoup trop dangereux.
— Trop dangereux ! répéta le sourd-muet, à la grande surprise des enfants. Poule mouillée !
Au son de cette voix, Tom et son ami se mirent à trembler.
C’était la voix de Joe l’Indien ! Après un moment de silence, ce dernier continua :
— Quoi de plus dangereux que notre dernier coup ? Nous voilà pourtant sains et saufs. — Ça, c’est différent. Si loin de la ville ! Et il n’y avait pas une autre habitation à plusieurs lieues à la ronde.
— Poltron ! Personne ne te connaît dans la ville. Malgré mon déguisement, je cours plus de risques que toi. Bah ! qui diable songera à venir nous chercher ici ?
— Hum… tu n’étais pas si rassuré hier, lorsque ces satanés gamins, qui jouaient sur la colline juste en face de nous, avaient l’air de nous surveiller.
Les satanés gamins tremblèrent de nouveau en entendant ces paroles. Huck se félicita néanmoins de s’être souvenu que la veille était un vendredi et d’avoir ainsi ajourné sa visite ; il regretta seulement de ne l’avoir pas remise à l’année prochaine.
— Rassuré ou non, je suis décidé à tenter l’affaire, si elle paraît possible, et tu m’aideras, ou tu apprendras à tes dépens que je ne plaisante pas quand on me manque de parole. Je ne veux pas te retenir ici, car il vaut mieux ne pas être vus ensemble. Tu passeras de l’autre côté du Mississippi jusqu’à ce que j’aie besoin de toi. En attendant, je tâterai le terrain avant de risquer le coup dangereux. Sois tranquille ; je tiens à ma peau autant que tu peux tenir à la tienne et je n’agirai pas à la légère. Ensuite, en route pour le Texas ! Surtout ne t’avise pas de me brûler la politesse, à moins que tu n’aies envie de faire connaissance avec la lame de mon bowie-knife.
— Tonnerre ! répliqua l’autre, il me semble que j’ai le droit de donner mon avis. Je ne songe pas à te planter là.
— En tous cas, te voilà prévenu. Assez causé, je tombe de sommeil et c’est à ton tour de veiller.
Sur ce, Joe l’Indien s’allongea par terre et ne tarda pas à ronfler. Son camarade le regarda dormir d’un air de mauvaise humeur, bâilla à plusieurs reprises et au bout de quelques minutes un second ronflement se joignit au premier. Les enfants poussèrent un soupir de soulagement et Tom dit à voix basse :
— C’est le moment de déguerpir, viens !
— Je n’ose pas, répliqua Huck ; s’ils se réveillaient, je ne pourrais plus faire un pas.
Tom chercha en vain à le décider ; enfin il se leva avec une prudente lenteur et feignit de vouloir partir seul, persuadé que Huck le suivrait ; mais le plancher craqua d’une façon si formidable, qu’il se coucha de nouveau, à moitié mort de peur. Heureusement le bruit n’avait pas troublé le sommeil des dormeurs. Il se tint coi, comptant les minutes.
À la longue un des ronflements cessa. Joe l’Indien se redressa, regarda autour de lui et contempla en ricanant son compagnon accroupi dans un coin, la tête sur les genoux.
— On peut s’en rapporter à toi pour veiller, s’écria-t-il en le secouant avec rudesse.
— Hein ? Quoi ? Est-ce que j’ai dormi ?
— Oh ! un peu, rien qu’un peu ! Il est presque temps de partir, compère. Que ferons-nous du petit magot qui nous reste ?
— Pourquoi ne pas le laisser ici ? Nous le reprendrons avant de filer pour le Texas. Six cents dollars, ça pèse.
— Oui, mais il peut se passer une semaine d’ici là et un accident est vite arrivé. La cachette n’est pas trop sûre, bien que tous ces imbéciles pâlissent à l’idée d’entrer ici. Creusons un trou et enterrons le sac à une plus grande profondeur.
— Bonne idée, Joe ! dit l’autre qui se dirigea vers la cheminée, s’agenouilla, souleva une dalle au fond du foyer et prit un sac. Il en tira une vingtaine de dollars qu’il serra dans sa poche et en remit autant à Joe l’Indien, puis passa le sac à ce dernier, qui, s’étant agenouillé à son tour, creusait le sol avec son bowie-knife.
Tom et Huck oublièrent en un instant leurs tribulations. Ils suivaient d’un œil de convoitise chacun des mouvements de Joe. Quelle chance ! Cela dépassait tout ce que leur imagination avait rêvé. Six cents dollars ! Il y avait là de quoi enrichir une demi-douzaine d’individus. Jamais une chasse au trésor ne s’était présentée sous de meilleurs auspices. Plus d’ennuyeuse incertitude au sujet de l’endroit où il fallait creuser. Ils se donnaient des coups de coude — des coups de coude éloquents et faciles à comprendre, car ils signifiaient simplement : comme nous avons bien fait de venir ici !
Le couteau de Joe rencontra un obstacle.
— Ohé ! s’écria-t-il.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda l’autre.
— Une planche à moitié pourrie. Non, une boîte ; aide-moi un peu… Ce n’est pas la peine, j’ai troué le bois.
Il allongea le bras et se releva brusquement.
— Compère, c’est de l’or !
L’Indien et son ami examinèrent la poignée de pièces de monnaie que le premier venait de retirer de la caisse. C’était bien de l’or. Les témoins-invisibles de leur trouvaille étaient aussi excités et aussi ravis qu’eux.
— Une vraie mine d’or, si le coffre est plein ! s’écria Joe.
— Nous saurons vite à quoi nous en tenir, dit son camarade. Il y a une vieille pioche rouillée là-bas au milieu des mauvaises herbes — je l’ai vue en entrant.
Il courut vers le coin qu’il venait de désigner et apporta les outils des enfants. Joe prit la pioche, l’examina d’un œil scrutateur, murmura quelques mots et commença à s’en servir.
La boîte fut bientôt déterrée. Elle n’était pas très grande ; garnie de bandes de fer, elle avait dû être fort solide avant que l’humidité eût atteint le bois.
— Il y a là des milliers de dollars, s’écria Joe. J’ai entendu dire que la fameuse bande de Muriel a gîté par ici et nous sommes payés pour le croire.
— Que ce soit l’argent de Muriel ou d’un autre, peu nous importe. Maintenant nous pouvons filer sans nous occuper de l’autre affaire.
Joe fronça les sourcils.
— Tu ne me connais pas, dit-il. On m’appelle Joe l’Indien, et ce n’est pas pour rien que j’ai du sang indien dans les veines, ajouta-t-il, tandis qu’une lueur sinistre faisait briller ses yeux. Il ne s’agit pas simplement d’un vol, mais d’une vengeance, et pour me venger j’ai besoin de toi.
— Soit ; j’ai promis, je tiendrai ; mais une fois l’affaire faite ou abandonnée, ne compte plus sur moi.
— L’affaire faite, tu iras au diable, si bon te semble.
— C’est entendu. En attendant, remettrons-nous cette caisse à sa place ?
— Oui. (Joie indicible chez les jeunes auditeurs d’en haut.) Non, par le grand Sachem, non ! (Consternation profonde des mêmes auditeurs.) J’avais presque oublié. Tu n’as donc pas remarqué qu’il y a de la terre fraîche sur la pioche ? Vois, il y en a aussi sur la pelle. Qui diable a pu poser là ces outils ? Ils ne s’en sont pas servis ici ; mais cela me paraît louche. Ils reviendront sans doute, et ils trouveraient bien vite la piste. Leur laisser les écus ? Pas si bêtes ; nous allons les emporter.
— Au numéro un ?
— Non ; au numéro deux, sous la croix, où les curieux ne sont pas à craindre.
— Dans ce cas, il n’y a pas de temps à perdre ; il ne fait plus très clair et nous pouvons partir.
Joe l’Indien alla d’une fenêtre à l’autre et examina l’horizon.
— Le champ est libre, dit-il, après avoir terminé son inspection. Mais, encore une fois, d’où diable viennent ces outils ? Ils n’étaient pas là hier. Ceux qui les ont apportés se cachent peut-être en haut.

Le champ est libre, dit Joe
Il s’arrêta un moment indécis, puis se dirigea vers l’escalier. Les enfants, auxquels la frayeur coupait presque la respiration, songèrent au cabinet — ils n’eurent pas la force de s’y traîner. Ils entendirent craquer l’escalier ; l’imminence du danger réveilla leur courage et ils allaient se réfugier dans le cabinet, quand un bruit beaucoup plus accentué résonna. Cinq ou six marches venaient de s’effondrer sous le poids de Joe l’Indien, qui retomba sur le sol au milieu de débris de bois pourri. Il se releva en jurant et en se frottant les côtes. Pour toute consolation son camarade lui dit :
— Tu vois bien que personne n’a pu monter par cet escalier car tu ne pèses pas lourd.
Joe se remit à jurer, puis il convint qu’il fallait profiter de ce qui restait de jour pour s’apprêter à partir. Quelques minutes plus tard, son compagnon et lui se glissaient dehors avec leur précieux fardeau.
Tom et Huck se redressèrent, encore effrayés, mais fort soulagés. À travers une lucarne ils virent les deux bandits disparaître dans le crépuscule.
— La boîte est lourde, dit Huck, et nous courrons plus vite qu’eux. Allons-nous les suivre ?

L’escalier s’effondra…
— Pas si bêtes, comme dit Joe l’Indien, répliqua Tom. Tâchons seulement de sauter l’un après l’autre et de redescendre sans nous casser le cou.
Arrivés en bas sains et saufs, ils reprirent le sentier qui conduisait à la ville. Leur conversation au début ne fut guère animée ; ils étaient trop occupés à s’adresser intérieurement des reproches, à maugréer contre l’oubli qu’ils avaient commis en laissant leurs outils en vue. Sans cela, Joe l’Indien aurait enterré son or avec son argent jusqu’à ce qu’il eût accompli son œuvre de vengeance, et il se serait arraché les cheveux en retrouvant le nid vide.
Cependant tout espoir n’était pas perdu. Ils résolurent de surveiller le faux Espagnol lorsqu’il se montrerait dans la ville « pour tâter le terrain ». Si l’on parvenait seulement à découvrir « le numéro deux » ! Soudain une horrible pensée traversa l’esprit de Tom.
— C’est de nous qu’il veut se venger, Huck ! s’écria-t-il. — Voyons, ne dis donc pas ces choses-là ! répliqua Huck qui pâlit d’épouvante.
Ils discutèrent à fond la question et finirent par reconnaître qu’il était possible que la menace s’adressât à d’autres qu’eux — ou du moins qu’elle ne s’adressât qu’à Tom, puisque Huck n’avait pas figuré comme témoin dans le procès. Cette dernière hypothèse ne rassura nullement notre héros, qui ne l’accepta même que sous toute réserve. Il jugeait que l’on court moins de risques lorsqu’on n’est pas seul à les courir.
Chapitre XXVI
LE NUMÉRO DEUX
Les événements de la journée valurent encore de mauvais rêves à Tom. Quatre fois il mit la main sur un riche trésor, et quatre fois le trésor s’évapora entre ses doigts au moment où le sommeil l’abandonnait. Alors, la dure réalité lui apparaissait. Le lendemain matin, bien avant l’heure du lever, tandis qu’il passait en revue les incidents de la veille, il remarqua qu’ils semblaient étrangement effacés et lointains, comme s’ils fussent arrivés dans un autre monde ou à une époque très reculée. Alors, il s’imagina que la grande aventure elle-même pourrait bien n’être qu’un rêve. Un argument plausible militait en faveur de cette idée : la quantité d’or renfermée dans la caisse était trop énorme pour être réelle. La plus forte somme d’argent monnayé qu’il eût jamais vue ne dépassait pas cinquante dollars. Comme beaucoup d’enfants de son âge et de sa position sociale, il se figurait que les allusions qu’il entendait faire à des centaines, à des milliers de dollars, n’étaient que des façons de parler et qu’il n’existait pas un seul individu qui possédât plusieurs centaines de dollars en espèces sonnantes. Si l’on avait pu analyser ses notions au sujet des trésors cachés, on aurait reconnu que son ambition était des plus modestes.
À force d’y songer, il finit par se présenter les incidents de son aventure sous un aspect moins nuageux. Après tout, ce n’était peut-être pas un rêve. Afin de dissiper cette pénible incertitude, il résolut de déjeuner à la hâte et d’aller à la recherche de Huck.
Il aperçut ce dernier assis au bord d’un bateau plat, se balançant les pieds dans l’eau et ayant l’air de fort mauvaise humeur. Tom se décida à ne pas aborder le premier la question. Si Huck ne faisait aucune allusion à la maison hantée, cela prouverait qu’il ne s’agissait que d’un rêve.
— Holà, Huck !
— Holà, toi-même !
Un intervalle de silence suivit cet échange de politesses.
— Tom, dit enfin Huck, si nous avions seulement laissé cette fichue pioche dans le bois, nous tiendrions le trésor.
— Alors, ce n’est pas un rêve ?
— Qu’est-ce qui n’est pas un rêve ?
— Notre histoire d’hier.
— Un rêve ! Si cet escalier avait été plus solide, tu aurais bien vite su à quoi t’en tenir. Ne me parle pas de rêves ; j’en ai eu assez toute la nuit. Ce gredin d’Espagnol m’a noyé à deux ou trois reprises ; que le diable l’emporte !
— Non, non. Si le diable l’emportait, comment retrouverions-nous la boîte ?
— Nous ne la trouverons jamais, Tom. Un individu n’a pas une chance pareille deux fois dans sa vie.
— C’est égal ; il faudra guetter Joe l’Indien et tâcher de le suivre jusqu’à son numéro deux.
— Ah ! j’ai pensé au numéro deux ; mais je ne suis pas plus avancé. Qu’est-ce que ça peut vouloir dire ?
— Ce n’est pas une maison, car il n’y a pas de numéros à nos maisons, comme dans les grandes villes.
— J’y suis ! s’écria Huck. Dans les auberges on met un numéro sur la porte des chambres.
— Tu as deviné, Huck ! Il n’y a que deux auberges à Saint-Pétersbourg. Nous en aurons bientôt le cœur net. Attends-moi. Tom partit aussitôt au pas de course, car il ne tenait pas trop à se montrer en compagnie de Huck dans les endroits publics. Son absence ne dura guère qu’une demi-heure. Il découvrit qu’à l’Hôtel Washington le numéro deux était occupé depuis plusieurs mois par un avocat. Dans la seconde auberge, connue sous le nom de Taverne de la Tempérance, la chambre portant le numéro deux semblait plus mystérieuse. Le jeune fils du tavernier raconta à Tom qu’elle restait presque toujours fermée et que personne n’y logeait ; il y était entré une fois par curiosité et n’avait vu que des tonneaux — des tonneaux vides naturellement, puisque son père ne vendait pas de liqueurs fortes ; on prétendait que le numéro deux était hanté, mais il ne croyait pas aux fantômes ; pourtant il y avait vu une lumière la veille au soir.
— Voilà ce que j’ai découvert, Huck, dit Tom à son ami. Je me figure que nous tenons l’endroit que nous cherchons.
— Ça m’en a l’air, et après ?
— Après ? Tu vas voir. La porte de derrière de ce numéro deux-là donne dans la petite allée qui se trouve entre la taverne et l’atelier du charron. Eh bien, j’ai prévenu le fils du tavernier que nous viendrons ce soir faire une partie de cache-cache. En jouant nous pourrons peut-être nous rapprocher de la chambre et la visiter.
— Je n’oserai jamais, dit Huck.
— Je m’en charge, répliqua l’intrépide Tom. En attendant, tu feras bien de rôder dans les environs jusqu’à la nuit, car Joe l’Indien ne doit pas avoir quitté la ville. Si tu le vois entrer dans la taverne, nous serons sûrs que c’est là sa cachette. Surveille donc ; il n’y a pas d’autre moyen de reprendre notre trésor.
— Tu as raison, Tom ; je vais guetter et ouvrir l’œil jusqu’à demain, s’il le faut.
— Ne caponne pas et nous serons riches.
Tom et Huck se retrouvèrent le soir, et ce dernier fit son rapport. Personne n’était entré ni sorti par l’allée, personne du moins qui ressemblât au faux Espagnol. Mais le fils du tavernier avait des pratiques à servir et la partie de cache-cache fut remise au lendemain.
Le soir du jeudi, les trois enfants étaient réunis et le jeu commença. Tom, toujours audacieux, se rapprocha peu à peu de la mystérieuse chambre. Ses compagnons le cherchaient en vain depuis dix minutes, lorsqu’il reparut dans l’allée ; il semblait troublé.
— Filons, dit-il rapidement à Huck, filons !
Il aurait pu se dispenser de répéter l’avis, car, dès le premier mot, Huck avait pris ses jambes à son cou. Les fuyards ne s’arrêtèrent que lorsqu’ils eurent atteint le hangar d’un abattoir qui se trouvait au bas de la ville. Au moment où ils pénétraient sous cet abri, un orage éclata et la pluie se mit à tomber à verse.
— Pourquoi nous sommes-nous sauvés ? demanda Huck lorsqu’il eut repris haleine.
— On se sauverait à moins, répliqua Tom. Tu vas voir. Lorsque je me suis approché du numéro deux, il m’a semblé entendre tousser et j’ai eu peur. Malgré ça, voyant la porte tout contre, je l’ai poussée. J’entre doucement. Personne ! Il ne faisait pas très clair ; je m’avance, puis je m’arrête. Il était temps ; un pas de plus, je marchais sur la main de Joe l’Indien.
— Brrr ! Et il t’a vu ?
— Non. Il dormait par terre, tout habillé. Par bonheur, il n’a pas bougé. Il avait trop bu, je crois.
— As-tu vu la boîte, Tom ?
— J’étais trop pressé pour regarder autour de moi. Je n’ai pas vu la boîte, je n’ai pas vu la croix ; je n’ai vu qu’une bouteille et un pot d’étain à côté de Joe l’Indien… Je me trompe, j’ai aussi vu deux barriques et un tas d’autres bouteilles. Devines-tu maintenant pourquoi on n’ouvre pas cette chambre à tout le monde ?
— Ma foi non !
— Elle est hantée… hantée par du rhum que l’on vend en cachette, afin de ne pas payer patente. Peut-être toutes les tavernes où l’on est censé ne pas débiter de liqueurs fortes ont-elles une chambre hantée.

Joe dormait, tout habillé
— Possible. Mais dis donc, Tom, ce serait un bon moment pour prendre la boîte, puisque l’Indien est ivre.
— Eh bien, essaye un peu.
Huck frissonna.
— Je ne te le conseille pas, reprit Tom. Une seule bouteille à côté de Joe l’Indien, ce n’est pas assez. S’il y en avait eu deux ou trois, j’aurais dit : « Allons-y ! » Tiens, Huck, il ne faudra tenter la chose que quand nous serons sûrs que Joe n’est pas là. Nous n’avons qu’à le guetter ; nous le verrons sortir un soir ou l’autre et alors nous mettrons le grappin sur la boîte.
— Eh bien, je dormirai le jour et je veillerai la nuit, pourvu que tu te charges du reste.
— Ça va, dit Tom. Si tu découvres quelque chose, tu n’auras qu’à courir à la maison et à miauler sous ma croisée. À présent, l’orage est passé et je vais me dépêcher de rentrer. Où dormiras-tu ?
— Dans la grange de Ben Rogers. Il me l’a permis et le nègre du vieux Rogers veut bien. Je puise souvent de l’eau pour l’oncle Sam, et quand j’ai faim, il me donne à manger. C’est un très bon nègre, Tom ; il m’aime parce que je ne suis pas fier avec lui. Quelquefois même nous dînons ensemble. Mais n’en parle pas. Lorsqu’on a le ventre vide, on fait des choses qu’on ne voudrait pas faire devant tout le monde.
— N’aie pas peur, je n’en dirai rien. Si je n’ai pas besoin de toi dans la journée, je te laisserai dormir, et s’il y a du nouveau la nuit, tu viendras m’avertir en miaulant.

Chapitre XXVII
LE PIQUE-NIQUE

Bien que le vendredi soit un jour de malheur, la première chose que Tom apprit le lendemain fut une bonne nouvelle. La veille au soir le juge Thatcher était revenu à Saint-Pétersbourg avec sa famille. Pour le moment Joe l’Indien et le trésor n’eurent qu’une importance secondaire aux yeux de notre héros, qui ne songea plus qu’à Becky. Il la rencontra entourée d’une foule de camarades, et l’on organisa divers jeux qui durent épuiser de fatigue tous ceux qui y prirent part. Personne ne se plaignit, car pour les écoliers un amusement qui ne fait pas tomber de lassitude le joueur n’est pas un jeu. La journée fut couronnée par une annonce qui causa une satisfaction générale. Becky avait tourmenté sa mère pour qu’elle fixât au lendemain le pique-nique si longtemps ajourné et Mme Thatcher y avait consenti. Les invitations furent expédiées avant le coucher du soleil. La joie des demoiselles surtout et les préparatifs de la fête leur donnèrent une de ces fièvres peu dangereuses que les médecins auraient grand tort de guérir. L’agitation de Tom lui permit de rester éveillé assez tard. Il espérait entendre le miaulement de Huck, car il n’eût pas été fâché de posséder son trésor afin d’étonner les invités de Becky. Mais son espoir fut déçu. Aucun signal ne lui annonça que son ami n’avait pas veillé en vain.
Le lendemain matin, entre dix et onze heures, une bande joyeuse se trouvait rassemblée chez le juge Thatcher, prête à se mettre en route. Les gens âgés n’avaient pas coutume de gâter les pique-niques par leur présence. On jugeait que sous l’égide de quelques demoiselles et de quelques jeunes gens de dix-huit à vingt ans les enfants ne couraient aucun danger. Le petit vapeur qui remplissait l’office de bac avait été loué pour l’occasion. Bientôt une procession de gais voyageurs défila le long de la grande rue, suivie de domestiques qui portaient des paniers de provisions.
Sid était malade ; il ne put donc profiter de l’invitation qu’il avait reçue, et Marie resta à la maison pour lui tenir compagnie. Les dernières paroles que Mme Thatcher adressa à Becky furent celles-ci :
— On reviendra tard et tu seras fatiguée. Aussi, comme Mme Harper demeure près du débarcadère, je l’ai priée de te donner l’hospitalité. Tâche d’être sage et de ne lui causer aucun embarras.
À trois milles au-dessous de la ville le vapeur accosta près de la lisière d’un bois. Les passagers débarquèrent, et une demi-heure plus tard des cris, des éclats de rire réveillaient les échos du petit bois et des hauteurs voisines. On eut recours à tous les moyens possibles de s’échauffer et de se lasser ; puis la bande éparpillée regagna le camp avec un appétit féroce, et le contenu des paniers eut bien vite disparu. Le repas terminé, on se reposa à l’ombre des chênes. Au bout d’une demi-heure quelqu’un cria :
— Qui veut visiter la caverne de Mac-Dougal ?
— Moi ! moi ! moi !
Tout le monde voulait visiter la caverne. En prévision de cette réponse unanime, M. Thatcher avait ajouté aux vivres des paquets de chandelles qui furent distribuées, et aussitôt on monta à l’escalade. La grotte s’ouvrait à une certaine hauteur sur une colline dénudée, à peu de distance du bois où l’on venait de dîner. On y pénétrait par une ouverture qui avait la forme de la lettre A. La lourde porte en chêne massif était grande ouverte. Derrière s’étendait une vaste cave formée par des murs calcaires. Il y avait quelque chose de romanesque, de mystérieux à se tenir là dans une obscurité profonde, contemplant la vallée verdoyante qui brillait au soleil. Mais ce contraste cessa bientôt d’impressionner les jeunes spectateurs et les jeux recommencèrent. Dès que l’un d’eux allumait une chandelle, il devenait l’objet d’une attaque générale. Il avait beau opposer une défense intrépide, la chandelle était vite éteinte ou renversée. Alors les éclats de rire retentissaient et une nouvelle chasse commençait. Mais tout a une fin. Au bout d’un quart d’heure les visiteurs descendirent la pente assez raide de ce que l’on nommait « le vestibule ». La clarté des nombreuses lumières révélait vaguement les murs élevés qui se dressaient à une hauteur de soixante pieds. Ce vestibule n’avait guère plus de huit à dix pieds de large. De loin en loin des couloirs non moins élevés, mais plus étroits, formaient des embranchements de chaque côté. La caverne de Mac-Dougal n’était en réalité qu’un vaste labyrinthe d’allées tortueuses qui se ramifiaient les unes dans les autres et ne conduisaient nulle part. On disait que l’on pouvait y errer pendant des journées et des nuits entières à travers un réseau embrouillé d’avenues sans arriver au fond de la cave. Personne ne se vantait de la connaître. C’était impossible ; mais les jeunes gens avaient souvent exploré la portion au-delà de laquelle on ne devait pas s’aventurer. Tom Sawyer y avait pénétré aussi loin que qui que ce fût.
La procession suivit ce long vestibule jusqu’à une distance de trois quarts de mille environ de l’entrée ; puis des groupes commencèrent à se glisser dans les galeries transversales, à courir le long des sombres corridors et à se surprendre aux endroits où les corridors se rejoignaient, Certains groupes parvinrent à s’éviter pendant plus d’une demi-heure sans dépasser les limites du terrain connu.
Enfin on regagna l’entrée de la grotte par bandes et par couples. La plupart des invités de Becky avaient les vêtements couverts de gouttes de suif ou mouillés par l’eau qui tombait des voûtes ; mais ils étaient ravis du succès du pique-nique. Ils furent étonnés de voir avec quelle rapidité le temps s’était écoulé et que la nuit approchait. Depuis une demi-heure la cloche du vapeur les rappelait à bord. Cette façon de terminer la journée ne leur causa aucune peine, tant s’en faut. Lorsque le petit navire se mit en marche avec ses jeunes passagers, le capitaine seul se plaignit du temps perdu.
Huck était déjà en faction quand les fanaux du vapeur passèrent devant le débarcadère. Il n’entendit aucun bruit à bord, car voyageurs et voyageuses tombaient de sommeil. Il se demanda quel bateau c’était et pourquoi il ne s’arrêtait pas devant le quai ; puis il n’y songea plus et s’occupa de ses affaires. Le ciel se couvrait de nuages et la nuit devenait sombre. Dix heures sonnèrent. Tout bruit de voiture cessa, les lumières s’éteignaient peu à peu, le dernier passant attardé disparut, la ville s’endormit, laissant le jeune veilleur seul avec le silence et les fantômes. À onze heures, on ferma la taverne et alors l’obscurité régna partout. Huck demeura en observation ; mais rien ne bougea. Le temps lui sembla long. Il se décourageait. Était-ce bien la peine d’attendre davantage ? Soudain un léger bruit frappa son oreille et le mit tout de suite sur le qui-vive. Il courut se poster au coin de la maison du charron. L’instant d’après deux hommes passèrent près de lui. L’un d’eux paraissait avoir un paquet sous le bras. Il emportait la boîte ! Ils allaient donc cacher le trésor ailleurs ? À quoi bon appeler Tom maintenant ? Ce serait absurde. Les deux hommes auraient filé bien loin avec la boîte et on ne les retrouverait plus. Non ; il les suivrait. Enhardi par les ténèbres, il se glissa derrière eux comme un chat, leur laissant prendre juste assez d’avance pour ne pas perdre la piste.
Après s’être avancés dans la direction du fleuve, ils enfilèrent à gauche une rue transversale, et marchèrent droit devant eux jusqu’au sentier qui menait à la colline de Cardiff. Ils firent un léger détour, comme pour éviter de passer près de la maison d’habitation d’un fermier surnommé le Gallois, maison située à mi-chemin de la pente, et continuèrent sans hésiter leur ascension. « Bon, pensa Huck, ils vont cacher le trésor dans la vieille carrière. » Mais, au lieu de s’arrêter à la carrière, ils poursuivirent leur route, gagnèrent le sommet de la colline et se perdirent dans l’obscurité d’une allée bordée d’épais buissons.
Huck abrégea la distance qui le séparait d’eux, certain qu’on ne pouvait pas le voir. Il finit par ralentir le pas, craignant de s’être trop rapproché, et s’arrêta pour écouter. Tout bruit de pas avait cessé. Le cri néfaste d’un hibou résonna. La partie était-elle perdue ? Il allait s’élancer, quand on toussa à quelques pieds de lui. Il trembla, cela va sans dire ; mais il ne tarda pas à se remettre de son effroi et même à se féliciter.
— J’aurais dû deviner plus tôt, se dit-il. Ils sont à cinq pas de la porte à claire-voie qui donne dans le jardin de la veuve. C’est là qu’ils vont enterrer le trésor et nous n’aurons pas de peine à le dénicher. Tom sera content de moi. Au bout d’une minute ou deux une voix, qui parlait très bas, dit :
— Que la peste l’étouffe ! La veuve a encore eu du monde à dîner, les fenêtres du salon sont éclairées.
Huck reconnut la voix de Joe l’Indien.
— Je ne vois pas de lumière, répondit une seconde voix, qui était celle de l’étranger de la maison hantée.
Le cœur de Huck se serra. Il s’agissait donc d’un autre meurtre et non du trésor ? Son premier mouvement fut de fuir ; mais il se rappela que Mme Douglas avait toujours été très bonne pour lui. Il aurait voulu la prévenir et il savait qu’il n’oserait pas. Il faudrait faire un long détour. Joe l’Indien pourrait le surprendre et l’assassiner par-dessus le marché. Ces pensées lui traversèrent l’esprit durant le court intervalle qui s’écoula entre la remarque de l’étranger et la réponse du métis.
— Tu ne vois rien, riposta ce dernier, parce que le buisson t’en empêche. Tiens, regarde par ici. Vois-tu maintenant ?
— Oui, parbleu, je ne suis pas aveugle. Eh bien, puisqu’elle a du monde, le coup est manqué. Il vaut mieux y renoncer.
— Y renoncer, quand je vais quitter le pays, quand c’est peut-être ma dernière chance ! Je te répète que tu pourras tout rafler ; mais je veux me venger. Son mari m’a rendu la vie dure ! Il était juge de paix, et entre autres choses il m’a condamné à être fouetté : fouetté en face de la geôle, devant toute la ville ; fouetté comme un nègre ! Comprends-tu ? Il m’a joué le mauvais tour çle crever pendant que j’étais en prison ; sa femme reste, elle payera pour lui.
— Tu seras bien avancé lorsque tu l’auras tuée !
— Qui te parle de la tuer ? Lui, je le tuerais, s’il vivait encore ; mais quand on veut se venger d’une femme, on gâte sa beauté, on lui fend le nez en deux, on lui coupe les oreilles comme à une truie…
— Par l’enfer, Joe, c’est une…
— Garde ton opinion pour toi, ce sera plus prudent. Je veux me venger, te dis-je ! Si elle saigne à mort, ce ne sera pas ma faute et je ne pleurerai pas trop. Tu m’aideras dans cette affaire, parce que tu ne peux pas faire autrement. C’est pour cela que tu es ici. Tout seul, je ne m’en tirerais peut-être pas. Du reste, rien ne presse ; nous attendrons que les lumières soient éteintes.
Huck sentit qu’il allait s’ensuivre un silence plus effrayant que ne le serait la suite de cet entretien. D’ailleurs il en savait assez et sa résolution était prise. Il retint donc son haleine et battit en retraite à reculons. Se balançant sur une jambe, au risque de perdre l’équilibre, il fit plusieurs pas en arrière. Une branche morte se brisa sous son pied avec un bruit sec. Cette fois encore il en fut quitte pour la peur. Il se retourna alors et s’avança avec prudence. Arrivé au bout du sentier, il se mit à courir, comme s’il eût eu des ailes aux pieds, jusqu’à la maison du Gallois. Les coups qu’il frappa à la porte éveillèrent en sursaut le vieux fermier, qui se montra avec ses deux fils à une des fenêtres du rez-de-chaussée.
— Que signifie ce tapage à une pareille heure ? demanda-t-il. Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?
— Ouvrez vite !
— Encore une fois, qui êtes-vous ?
— Huckleberry Finn. Laissez-moi entrer, vite !
— Huck Finn ! Si tu t’imagines que c’est là un nom devant lequel les portes s’ouvrent volontiers, tu te trompes. N’importe, garçons, voyons ce qui l’amène.
— Je vous en supplie, s’écria Huck, dès qu’il eut été introduit dans le parloir, ne dites à personne que c’est moi qui les ai dénoncés. Ils me noyeraient, pour sûr ! Mais la veuve a été bonne pour moi, et ils veulent la tuer. Je vous raconterai tout si vous me promettez de ne pas dire que c’est moi.
— Par saint Georges, il y a quelque anguille sous roche ! s’écria le Gallois. Il est blanc comme un linge. Parle, Huck ; ne crains rien, nous serons discrets.

Parle, Huck ; ne crains rien
Cinq minutes plus tard, le vieillard et ses fils, un revolver à la main, arrivaient au sommet de la colline et pénétraient dans l’allée obscure en cherchant à assourdir le bruit de leurs pas. Huck ne les accompagna pas plus loin. Il se cacha derrière un rocher et se tint l’oreille au guet. Il y eut un intervalle de silence plein d’anxiété ; puis tout à coup une explosion d’armes à feu et un cri retentirent. Il n’attendit pas pour s’informer des détails. Il s’élança en avant et descendit la colline aussi vite que ses pieds purent le porter.
Chapitre XXVIII
LES RÉVÉLATIONS DE HUCK
Le lendemain, dimanche, l’aube blanchissait à peine l’horizon lorsque Huck remonta sans se presser la colline qu’il avait descendue si lestement la veille, et vint frapper à la porte du vieux Gallois. Tout le monde dormait dans la maison, mais d’un sommeil que l’épisode de la nuit rendait léger. Une croisée s’ouvrit.
— Qui va là ?
— Ne criez pas si fort ! répliqua le visiteur à voix basse. Ce n’est que Huckleberry Finn.
— Ah ! c’est toi, Huck ? Voilà un nom qui ouvrira ma porte la nuit comme le jour, mon ami. Tu seras toujours le bienvenu.
Ces paroles, les plus cordiales qu’il eût jamais entendues, résonnèrent étrangement à l’oreille du jeune vagabond ; il ne se rappelait pas que l’on eût jamais prononcé le dernier mot à son adresse.
La porte en effet fut vite ouverte.
— Maintenant, mon bonhomme, dit le vieillard, j’espère que tu as faim, car le déjeuner sera prêt dès que le soleil se montrera. Ah çà, pourquoi as-tu disparu hier ? Nous espérions que tu coucherais ici.
— J’ai eu peur, répliqua Huck, et j’ai filé au premier coup de pistolet. Je n’ai amarré qu’au bout de trois milles. Je suis revenu parce que je tenais à savoir, et je suis revenu avant le jour parce que je ne voulais pas rencontrer ces gredins, même s’ils étaient morts.
— Et tu m’as l’air d’avoir passé une mauvaise nuit, mon pauvre Huck ; mais il y a un lit pour toi quand tu auras déjeuné… Non, ils ne sont pas morts, ces gredins. Vois-tu, nous savions juste où les trouver, grâce à toi. Nous nous sommes glissés jusqu’au bout du sentier qui, par bonheur, était très sombre. Je marchais en tête ; mais à quinze pas de l’endroit que tu nous as indiqué, il me vient une envie d’éternuer. J’ai essayé de retenir mon envie. Pas moyen ; il fallait que ça parte et c’est parti. Alors nous avons entendu un bruit de branches brisées. Je crie : feu ! Nous tirons tous, et comme nous étions prévenus, nos balles ont dû tomber au bon endroit. Malgré l’obscurité, les gueux avaient déguerpi et nous voilà courant après eux. Ils ont riposté par plusieurs coups de feu qui ont d’abord servi à nous guider. Enfin, il a fallu abandonner la chasse ; alors Owen est allé prévenir les constables qui ont fait bonne garde aux abords du fleuve. Le shérif s’est entendu avec mes fils pour organiser une battue dans le bois dès qu’il fera jour. Ce soir, la veuve pourra dormir tranquille. Le signalement de ces bandits nous aiderait beaucoup ; mais tu n’as sans doute pas pu voir à quoi ils ressemblent ?
— Oh si ! Je les ai rencontrés dans la ville et je les ai suivis.
— Bravo ! Décris-les.
— L’un est le vieil Espagnol sourd-muet qui est arrivé il n’y a pas longtemps, et l’autre est un grand escogriffe presque aussi mal habillé que moi…
— Ça suffit, Huck, nous les connaissons pour les avoir rencontrés près de la maison de la veuve. En route, garçons, et prévenez le shérif. Vous déjeunerez en revenant.
Les fils du Gallois se levèrent aussitôt ; au moment où ils se disposaient à quitter la salle, Huck s’élança vers eux en s’écriant :
— Je vous en supplie, ne dites pas que j’y suis pour quelque chose.
— Allons, on se taira, puisque tu le veux, Huck, répliqua le fermier. Tu devrais pourtant être fier de ta bonne action, au lieu de chercher à la cacher.
— Oh ! non, non, s’il vous plaît ! N’en dites pas un mot.
Lorsque les jeunes gens se furent éloignés, le vieux Gallois reprit :
— Ah çà, pourquoi donc tiens-tu à ce que l’on ne te remercie pas comme tu le mérites ?
Huck se contenta de répondre :
— J’en sais trop sur le compte de ces hommes et ils me tueraient, pour sûr, s’ils s’en doutaient.
Le Gallois, un peu intrigué, promit de garder le secret, puis il demanda :
— Comment l’idée t’est-elle venue de les suivre ? Tu avais donc des motifs pour les soupçonner ?
Huck garda un moment le silence, il préparait une réponse prudente.
— Voyez-vous, répliqua-t-il, je ne suis pas né coiffé — du moins tout le monde le dit et je crois que c’est vrai. Souvent, lorsque l’idée de ma mauvaise chance me trotte dans la tête, pas moyen de fermer l’œil. C’était comme ça hier au soir. Je ne pouvais pas m’endormir et je me promenais en me demandant pourquoi il y a des gens qui ont de la corde de pendu plein les poches et d’autres qui n’en ont pas un brin. Voilà que j’arrive près de l’atelier du charron qui est derrière la taverne de la Tempérance, et ces deux individus ont passé près de moi. Un d’eux portait quelque chose sous le bras et j’ai pensé que c’étaient des voleurs. Il y en avait un qui fumait et l’autre lui demande du feu ; alors il s’arrête droit devant moi et pendant qu’il allume son cigare, je reconnais l’Espagnol à ses favoris blancs. Celui qui fumait avait des habits tout râpés…
— Quoi, tu as pu voir ses habits à la lueur du cigare ?
— Oui, parce que je l’avais déjà rencontré avec l’Espagnol.
— Alors ils ont continué leur route et tu…
— Je les ai suivis. Ils n’allaient pas très vite et je voulais savoir de quoi il retournait. J’ai marché sur leurs talons jusqu’à l’endroit que je vous ai indiqué. Là, ils se sont assis par terre pour causer. C’est alors que j’ai entendu l’Espagnol dire ce que je vous ai raconté.
— Comment, c’est le sourd-muet qui a dit tout cela ?
Huck venait de commettre une nouvelle bévue. Il s’efforçait de ne pas prononcer une parole qui pût révéler l’identité du faux Espagnol ; mais sa langue le trahissait. Il eut beau tenter de réparer sa maladresse, il ne fit que s’embourber davantage.

C’est Joe l’Indien !
Mon garçon, dit le Gallois, tu n’as pas l’habitude de mentir et je t’en félicite. Tu en sais plus long que tu ne veux l’avouer sur le compte de cet Espagnol, et tu n’ignorais pas hier qu’il n’est ni sourd ni muet. Tu ne peux pas cacher cela. Voyons, aie confiance en moi. Loin de t’exposer au moindre danger, je te protégerai.
Huck contempla un instant le visage franc et loyal du vieillard ; il se pencha en avant et lui dit à l’oreille :
— Ce n’est pas un Espagnol, c’est Joe l’Indien !
Le Gallois se leva d’un bond.
— Tout s’éclaircit maintenant ! Lorsque tu as parlé de nez fendus et d’oreilles coupées, j’ai cru que tu y mettais du tien, car les blancs n’ont guère l’habitude de se venger ainsi. Mais un Indien, c’est une autre histoire !
Pendant le déjeuner, l’entretien continua et le vieillard raconta à Huck que la veille, avant de se coucher, il avait allumé une lanterne et était allé avec ses fils examiner le terrain dans le voisinage de la porte à claire-voie. Ils comptaient découvrir des traces de sang ; mais ils n’avaient trouvé qu’un grand sac…
— Un sac ! Qu’y avait-il dedans ?
Si ces mots eussent été autant d’éclairs, ils n’auraient pu s’échapper avec une rapidité plus soudaine des lèvres blêmies de Huck. La bouche béante, les yeux écarquillés, l’haleine suspendue, il attendit la réponse. Le Gallois, étonné, ouvrit à son tour de grands yeux, regarda Huck pendant cinq secondes, pendant dix secondes, puis répliqua :
— Des outils à l’usage des voleurs. Eh bien, qu’est-ce qui te prend ? Huck s’était rejeté en arrière, poussant un soupir de satisfaction. Son hôte fixa sur lui un regard scrutateur.
— Oui, des outils de voleur, répéta-t-il. Cela paraît te soulager beaucoup. Que croyais-tu donc que nous trouverions ? Huck semblait de plus en plus embarrassé. L’attention avec laquelle on le dévisageait le gênait. Il aurait tout donné pour imaginer une réponse plausible ; elle ne vint pas. La seule qui s’offrit à lui était insensée, mais il ne se donna pas le temps de la peser.
— Des livres pour l’école du dimanche, peut-être. Le vieillard partit d’un éclat de rire qui le secoua de la tête aux pieds.
— Mon pauvre Huck, tu bats la campagne, dit-il, lorsque son accès de gaieté se fut un peu calmé. Ça ne m’étonne pas. Tu es pâle et fatigué. Va te reposer ; le sommeil te remontera, je l’espère. Huck se reprocha d’avoir montré une agitation aussi absurde ; car, depuis qu’il avait entendu la conversation des deux bandits, il croyait que le paquet emporté de la taverne ne devait pas contenir le trésor. Il le croyait ; mais il n’en était pas sûr, de sorte que la nouvelle de la découverte du sac lui avait fait perdre son sang-froid. Il se consola en songeant qu’en somme les choses prenaient une bonne tournure. Le trésor ne pouvait être qu’au numéro deux ; Joe et son complice seraient en prison avant la fin du jour ; rien ne l’empêcherait donc d’aller cette nuit même avec Tom pour s’emparer de la caisse.
Le déjeuner était à peine terminé, que l’on frappa à la porte. Huck courut se cacher dans le lit que l’on venait de lui offrir. Il ne tenait pas à être mêlé d’une façon quelconque aux incidents de la veille. Le Gallois ouvrit aux personnes qui lui rendaient visite et parmi lesquelles se trouvait la veuve Douglas. Il remarqua qu’un grand nombre de curieux grimpaient déjà le long de la colline pour contempler les murs de la maison qui avait failli être le théâtre d’un assassinat. Le vieillard dut raconter toute l’affaire à ses visiteurs. La veuve le combla de remerciements très sincères.
— Nous ne méritons pas tant d’éloges, madame, répliqua le Gallois. Il y a une autre personne à qui vous êtes plus redevable qu’à moi ou à mes fils ; mais elle ne veut pas que je la nomme. Nous ne serions jamais montés là-haut sans elle.
Ce mystère excita naturellement une curiosité si vive, qu’elle amoindrit un peu l’intérêt soulevé par la question principale. Le Gallois n’était pas homme à manquer à sa parole, et il garda son secret. Lorsqu’il eut fourni des détails sur le reste de l’aventure, Mme Douglas lui demanda :
— Pourquoi ne m’avez-vous pas prévenue ? J’ai dormi tranquillement tandis que vous vous donniez tant de mal.
— Nous avons jugé qu’il valait mieux ne pas vous alarmer. Il était plus que probable que ces bandits ne songeraient pas à revenir — ils avaient perdu leurs outils. À quoi bon vous effrayer ? Mes trois nègres ont monté la garde autour de votre maison jusqu’au jour. Ils viennent seulement de rentrer.
D’autres visiteurs arrivèrent, et le Gallois, ainsi que ses deux fils, fut enchanté lorsqu’il fallut se rendre à l’église, car tous les trois étaient las de répéter la même histoire. endant les vacances il n’y avait pas d’école du dimanche, et le service religieux se célébrait une heure plus tôt. Au sortir de l’église, tout le monde causait du grand événement. On n’avait pas encore trouvé la moindre trace des deux bandits. Au moment où Mme Harper s’éloignait, la femme du juge la rejoignit et lui demanda :
— Est-ce que ma Becky va dormir toute la journée, madame Harper ? Elle n’est pas raisonnable et se fatigue toujours trop ; mais je croyais qu’elle serait du moins venue avec vous au prêche.
— Avec moi ?
— Certainement, répliqua Mme Thatcher. Est-ce qu’elle n’a pas passé la nuit chez vous ?
— Mais non. Je l’ai attendue pendant une demi-heure après l’arrivée du steamer, puis j’ai pensé que vous étiez allée au-devant d’elle. Mme Thatcher pâlit et s’affaissa sur un banc. Au même instant, la tante Polly, qui s’entretenait gaiement avec une amie, vint à passer.
— Bonjour, madame Thatcher. Bonjour, madame Harper. Mon Tom est sans doute resté hier au soir chez l’une de vous, et il n’ose pas se montrer ; il sait ce qui l’attend. J’ai un compte à régler avec lui.
Mme Thatcher secoua faiblement la tête et sa pâleur augmenta. Mme Harper déclara d’un ton inquiet que Tom n’avait pas non plus passé la nuit chez elle, et tante Polly pâlit à son tour.
— Joe Harper, as-tu vu mon Tom ce matin ? demanda-t-elle.
— Non, madame.
— Quand l’as-tu vu pour la dernière fois ?
Joe essaya de se rappeler. Il était sûr de lui avoir parlé dans la grotte ; mais il ne se souvenait pas de l’avoir aperçu à bord du vapeur. Beaucoup de fidèles qui s’apprêtaient à regagner leur logis s’étaient arrêtés. Ils causaient à voix basse et tous les visages manifestaient une vive inquiétude. On interrogea anxieusement les enfants et les jeunes catéchistes qui les avaient accompagnés. Personne n’avait remarqué si Tom et Becky étaient sur le pont au moment du départ. La nuit tombait et l’on n’avait pas songé à faire l’appel. Enfin un jeune homme exprima la crainte que les deux absents se fussent égarés dans la cave. Mme Thatcher se trouva mal ; tante Polly se mit à pleurer et à se tordre les mains.
L’alarme se répandit de groupe en groupe, de rue en rue. En moins de cinq minutes, les cloches commencèrent à sonner à toute volée et la ville entière fut sur pied. L’épisode de la colline de Cardiff perdit toute importance, les bandits furent oubliés ; on sella les chevaux, on démarra les canots, le petit vapeur chauffa et avant que la nouvelle de la calamité fût âgée d’une demi-heure, deux cents hommes galopaient vers la grotte le long de la grand’route ou s’y dirigeaient par voie d’eau à bord des embarcations.
Durant tout l’après-midi, la ville parut vide et morte. Une foule de dames se rendirent auprès de Mme Thatcher et de tante Polly, cherchant à les consoler. Elles pleurèrent avec les deux affligées, et en pareille occasion les larmes valent encore mieux que les paroles. Durant tout la nuit, la ville éveillée attendit des nouvelles. Lorsque le jour commença enfin à paraître, on reçut ce message : « Envoyez-nous des chandelles et des vivres, nos provisions sont épuisées. » Mme Thatcher et tante Polly étaient presque folles de désespoir. Le juge avait bien adressé de la grotte quelques paroles rassurantes ; mais elles n’annonçaient rien de bon.
Le vieux Gallois revint vers l’aube, les vêtements couverts de taches de suif et complètement harassé. Il retrouva Huck étendu sur le lit où il l’avait laissé, en proie au délire de la fièvre. Comme tous les médecins de la ville étaient dans la grotte, la veuve Douglas avait pris le malade en main.
Entre deux et trois heures, des bandes de chercheurs fatigués regagnèrent une à une la ville ; mais les citoyens les plus robustes continuaient à explorer la grotte, On visitait la cave à des profondeurs où personne n’avait encore pénétré. Dès que l’on arrivait dans un couloir on voyait briller au loin des lumières qui passaient à l’autre extrémité. Partout des coups de pistolet et des cris d’appel réveillaient les échos des sombres voûtes.

Est-ce Tom qui a trouvé le rhum ?
À un endroit, loin de la partie de la grotte où s’aventuraient d’ordinaire les touristes, on avait vu les noms de Tom et de Becky tracés sur une voûte peu élevée avec la fumée d’une chandelle, et près de là on avait ramassé un bout de ruban taché de graisse. Mme Thatcher reconnut ce bout de ruban et elle le mouilla de ses larmes. Quelqu’un raconta que de temps à autre on voyait un point lumineux apparaître au loin ; alors un formidable cri d’appel retentissait, et on s’élançait le long de la galerie. Mais c’était toujours une fausse joie, on ne rencontrait que d’autres chercheurs. On se rappelait alors que la provision de chandelles des deux enfants devait être épuisée.
Trois jours et trois nuits d’une lugubre attente s’écoulèrent. La ville tomba dans un profond abattement. On eut beau apprendre que le propriétaire de la Taverne de la Tempérance était un faux apôtre qui vendait en cachette des liqueurs fortes, cette nouvelle laissa le public indifférent.
Huck, dans un intervalle lucide, amena la conversation sur les auberges en général et finit par demander si l’on n’avait rien découvert à la Taverne de la Tempérance.
— Oui, on a découvert quelque chose, répliqua la veuve. Qui donc vous a parlé de cela ?
Huck se redressa dans son lit, l’œil hagard.
— Quoi ? Qu’a-t-on trouvé ? s’écria-t-il.
— Des tonneaux de rhum, et la maison a été fermée. Recouchez-vous, mon enfant.
— Laissez-moi seulement vous faire encore une question. Est-ce Tom qui a trouvé le rhum ?
La veuve fondit en larmes.
— Chut, chut ! Je vous ai déjà dit qu’il ne faut pas trop parler. Vous êtes très, très malade.
On n’avait donc découvert que les tonneaux et les bouteilles ? Il y aurait eu un fameux vacarme si l’on avait mis la main sur la boîte. Le trésor était perdu, perdu à jamais. Mais pourquoi la veuve pleurait-elle, puisqu’elle ignorait l’existence du trésor ? Ces pensées traversèrent vaguement l’esprit de Huck, dont la tête retomba sur l’oreiller.
Là, il dort, se dit Mme Douglas. Le délire l’a repris tout à l’heure. Tom Sawyer trouver le rhum, quelle idée ! Ah ! si quelqu’un pouvait trouver ces pauvres enfants ! Mais il ne reste plus beaucoup de gens qui aient assez d’espoir pour continuer à les chercher.
Chapitre XXIX
TOM ET BECKY DANS LA GROTTE
Revenons à Tom et à Becky, que nous avons laissés dans la grotte.
Ils parcoururent les sombres galeries avec leurs compagnons, visitant les merveilles familières baptisées de noms hyperboliques, tels que le Palais d’Aladin, la Cathédrale, le Salon des fées, etc. Ils se mêlèrent avec ardeur aux parties de cache-cache jusqu’à ce que le jeu les eût lassés. Ils se mirent ensuite à descendre la pente d’une galerie sinueuse, levant leurs chandelles à hauteur de bras afin de déchiffrer un fouillis de noms, de dates, de devises tracés à la fumée sur la voûte. Continuant leur route sans cesser de babiller, ils ne remarquèrent pas qu’ils gagnaient une partie de la cave dont les parois ne portaient aucune inscription. Ils ne s’arrêtèrent que pour enfumer leurs propres noms sur une saillie de mur. Un peu plus loin, Becky s’extasia à la vue d’une source qui, coulant en nappe, avait formé, avec l’aide des siècles, un Niagara en miniature. Tom glissa son corps fluet derrière la nappe qu’il illumina à la grande joie de sa compagne. Il vit que la cascade voilait une espèce d’escalier naturel resserré entre les murs d’un passage plus étroit que ceux qu’ils avaient traversés. Aussitôt l’ambition de devenir un Christophe Colomb s’empara de lui. Becky répondit à son appel et, après avoir tracé une croix qui devait les guider au retour, ils commencèrent leur exploration. Ils tournèrent à droite, à gauche, s’enfonçant dans les profondeurs de la grotte, firent une seconde marque et s’éloignèrent en quête de nouveautés qu’ils comptaient décrire à leurs camarades.

Tom et Becky dans la cave
Ils débouchèrent en effet dans une salle dont la voûte était constellée de stalactites ; ils la parcoururent, s’étonnant et admirant, puis ils la quittèrent par une des nombreuses galeries qui s’y ouvraient pour arriver bientôt en face d’un petit lac d’un aspect féerique dont le bassin semblait entouré d’un filigrane de cristal, dans une autre salle soutenue par des centaines de colonnes aux contours étranges formés par la réunion des stalactites et des stalagmites. On eût bien surpris les deux enfants si on leur eût dit que ces piliers avaient été produits par la chute de gouttes d’eau qui, depuis des siècles, déposaient sur le même point la dose infinitésimale de chaux dont elles étaient imprégnées. Sous la voûte se tenaient des milliers de chauves-souris. Troublées par les lumières, elles descendirent par centaines, poussant de petits cris et s’élançant contre les chandelles. Tom, qui connaissait les façons d’agir de ces mammifères, comprit le danger. Il saisit la main de Becky et l’entraîna dans la première galerie qui s’offrit à lui. Les intrus n’opérèrent pas leur retraite une minute trop tôt, car un coup d’aile éteignit la chandelle de Becky. Les chauves-souris poursuivirent les enfants jusqu’à une certaine distance ; mais les fugitifs se jetèrent dans le couloir le plus rapproché et furent bientôt débarrassés de leurs ennemis. Tom découvrit à peu de distance du repaire des chauves-souris un autre lac, un vrai lac, cette fois, qui s’étendait si loin que ses bords se perdaient dans l’ombre, et il jugea qu’il valait mieux se reposer avant d’en faire le tour. Alors seulement le silence absolu qui régnait autour d’eux frappa Becky.
— Tom, dit-elle, il y a longtemps que nous n’avons entendu les autres.
— Songe donc, Becky ; nous sommes au-dessous d’eux à je ne sais combien de distance au nord, au sud ou à l’ouest, à moins que ce ne soit à l’est. Nous ne pouvons pas les entendre d’ici.
Becky commença à s’inquiéter.
— Il y a au moins une heure que nous avons passé sous le Niagara. Nous ferons mieux de nous en retourner.
— Oui, tu as raison.
— Sauras-tu retrouver le chemin, Tom ? Moi, je ne m’y reconnaîtrai pas.
— Il y a les chauves-souris qui m’embarrassent. Si elles éteignaient nos lumières, nous serions dans une jolie passe. Essayons un autre chemin afin de ne pas les réveiller.
— Oui, mais j’espère que nous ne nous perdrons pas, répliqua Becky que cette idée fit frissonner.
Ils s’engagèrent dans une galerie qu’ils traversèrent en silence, examinant chaque issue dans le vain espoir qu’elle leur fournirait un point de repère. Chaque fois que Tom se livrait à un examen de ce genre, Becky cherchait sur son visage quelque signe d’encouragement et Tom s’écriait avec un calme affecté :
— Nous n’y sommes pas encore ; mais sois tranquille, il n’y a pas de danger.
Cependant chaque mécompte le laissait de plus en plus découragé, et il se mit à suivre au hasard les galeries dans l’espoir qu’il finirait par entendre au moins le bruit de la cascade. Bien que ses paroles fussent toujours rassurantes, le ton de sa voix trahissait une épouvante secrète. Lorsqu’il disait : All right, Becky comprenait que ces mots signifiaient « tout est perdu ». Malgré son effroi, elle marchait bravement à côté de son compagnon et s’efforçait de retenir ses larmes.
— Ô Tom, dit-elle enfin, ne t’inquiète pas des chauves-souris ; retournons par ce chemin-là. Nous avons l’air de descendre encore au lieu de remonter.
Tom s’arrêta.
— Attends un peu et écoute, dit-il.
Le silence était si profond qu’il leur permettait presque de distinguer le bruit de leur respiration. Tom lança un ohé ! ohé ! à tirer les morts de leur sommeil. L’appel descendit la galerie vide en réveillant un écho qui ressemblait à un éclat de rire moqueur.
— C’est horrible, Tom ; ne recommence pas ! s’écria Becky.
— Oui, c’est horrible ; mais ils pourraient nous entendre.
Ce ils pourraient n’avait rien de rassurant. Tom lança un second appel qui n’eut pas de meilleur résultat que le premier.
— Tu avais raison, il me semble que nous descendons toujours, dit-il. Retournons par là et tâchons de remonter.
Il eut beau marcher vite, il montrait une indécision qui redoubla l’effroi de Becky.
— Ô Tom, dit-elle, nous n’avons pas fait de marques ! Je vois bien que tu ne sais de quel côté aller.
Elle se jeta par terre et s’abandonna à un tel paroxysme de désespoir, que Tom craignit qu’elle ne mourût ou ne perdît la raison. Il s’assit près d’elle et l’entoura de ses bras. Elle se serra contre lui et lui confia ses terreurs. Tom la supplia en vain de reprendre courage. Alors il s’accabla d’injures, s’accusant d’être la cause de tout le mal. Les reproches qu’il s’adressait produisirent un effet auquel il ne s’attendait pas. Becky se leva et déclara qu’elle essayerait d’espérer encore, qu’elle le suivrait, pourvu qu’il ne parlât plus ainsi, car le blâme retombait sur elle autant que sur lui.
— C’est moi qui t’ai entraîné, dit-elle.
Ils se remirent donc en route, errant sans but, au hasard. Un moment l’espérance parut renaître, non qu’il y eût la moindre raison pour être plus optimiste, mais la jeunesse est lente à se décourager.
Au bout de quelque temps Tom prit la chandelle de Becky et l’éteignit. Cette précaution donnait beaucoup à entendre. Les paroles étaient inutiles. Becky comprit et elle se désespéra de nouveau. Elle savait que Tom avait dans sa poche une chandelle entière et plusieurs bouts de chandelle — néanmoins il fallait économiser !
Bientôt la fatigue commença à se faire sentir. Les deux enfants essayèrent de lutter contre elle, car on ne pouvait songer sans terreur à s’asseoir alors que le temps devenait si précieux. Se mouvoir dans une direction quelconque, c’était avancer, et qui sait ? S’asseoir, c’était inviter la mort et abréger sa poursuite.
Enfin les jambes de Becky refusèrent de la porter plus loin. Elle s’assit en pleurant. Tom s’installa à côté d’elle et essaya de trouver un moyen de la consoler ; mais tous ses encouragements étaient usés jusqu’à la corde à force d’avoir été répétés — ils avaient presque l’air de railleries. Becky était si lasse, qu’elle s’endormit. Tom contempla ces traits tirés qui reprenaient leur sérénité sous l’influence de songes heureux, et ses pensées l’emportèrent loin de la cave. Il commençait à s’assoupir lui-même lorsque Becky se réveilla, un sourire sur les lèvres ; mais le sourire disparut dès qu’elle eut ouvert les yeux et elle poussa un gémissement.
— Comment ai-je pu dormir ! s’écria-t-elle. J’oubliais où nous étions et je voudrais ne m’être jamais réveillée… Non, Tom, ne pleure pas, je ne le dirai plus.
— Pleurer ! répéta Tom. Nous avons mieux à faire. Maintenant que tu t’es reposée, nous retrouverons notre chemin.
— Tom, j’ai vu un si beau pays dans mon rêve ! Je crois que c’est là que nous allons.
— Peut-être que non, Becky, peut-être que non. Essayons.
Ils se levèrent et se remirent en marche, sans grand espoir. Ils cherchèrent à calculer depuis combien de temps ils se trouvaient dans la grotte. Il leur sembla qu’il y erraient depuis plusieurs jours déjà ; mais ils reconnurent que leur impression les trompait, puisque leur provision de chandelles durait encore.
Deux ou trois heures plus tard — autant qu’ils purent en juger — Tom dit qu’il fallait prêter l’oreille afin de découvrir une source. Il finit par en trouver une et insista pour que l’on se reposât de nouveau. Tous deux étaient cruellement fatigués ; néanmoins Becky déclara qu’elle croyait pouvoir marcher encore un peu, et elle fut surprise d’entendre son compagnon refuser d’aller plus loin. Ce refus l’intrigua. Ils s’assirent en face de la chandelle que Tom avait fixée au mur. Plusieurs minutes s’écoulèrent sans que l’on échangeât une parole, puis Becky rompit le silence.
— Tom, j’ai si faim !
Tom tira quelque chose de sa poche.
— Tu te rappelles pourquoi tu m’as fait emporter ça ?
Becky eut presque un sourire.
— Le gâteau de noce ! dit-elle.
— Oui, et je voudrais en avoir une plus grosse tranche, car nous n’avons pas autre chose.
— Le grand plum-cake ressemblait à un gâteau de noce et j’avais gardé ce morceau pour le mettre sous notre oreiller afin de rêver dessus, comme on fait avec un morceau de vrai gâteau de noce ; mais ce sera notre…
Elle n’acheva pas la phrase, craignant d’affliger son compagnon. La tranche de plum-cake fut divisée, et Becky mangea sa moitié de bon appétit tandis que Tom grignotait une partie de la sienne. Il y avait de l’eau fraîche en abondance pour arroser le maigre repas. Après s’être penchée au bord de la source et après avoir bu, Becky proposa de nouveau de pousser en avant. Tom hésita un instant avant de répondre.
— Becky, tu ne t’effrayeras pas trop si je te dis la vérité ?

Becky donna libre cours à ses larmes
Le visage de Becky devint très pâle ; elle répliqua toutefois qu’elle tâcherait.
— Eh bien, il faut que nous restions ici, où il y a de l’eau à boire. C’est là notre dernier bout de chandelle…
Becky donna libre cours à ses larmes et à ses sanglots. Tom fit ce qu’il put pour la calmer ; mais il n’y parvint pas et jugea qu’il valait mieux attendre que l’accès se fut dissipé. Il attendit longtemps.
— Tom ? dit enfin Becky.
— Quoi, Becky ?
— Ils verront que nous ne sommes pas revenus avec eux et ils nous chercheront.
— Certainement !
— Ils nous cherchent peut-être déjà, Tom ?
— Peut-être bien. Je l’espère.
— Quand saura-t-on que nous sommes restés en arrière ?
— Quand on remontera à bord, je suppose.
— Tom, il fera peut-être nuit alors — verra-t-on que nous ne sommes pas là ?
— Je ne sais pas. En tout cas, ta mère le verra bien dès que les autres seront de retour.
Le visage effrayé de Becky avertit Tom qu’il venait de commettre une bévue. Becky devait passer la nuit chez Mme Harper ! Les deux enfants devinrent silencieux et songeurs. Bientôt une soudaine exclamation de Becky apprit à Tom que la même pensée les avait frappés tous deux. La matinée du dimanche pourrait être à moitié écoulée avant que Mme Thatcher apprît que sa fille n’était pas chez les Harper. Les enfants demeurèrent les yeux fixés sur leur dernier bout de chandelle qui fondait impitoyablement. Ils virent un demi-pouce de la mèche rester collé au mur ; ils virent la flamme s’élever et s’abaisser, se couronner d’une mince colonne de fumée, onduler un instant — puis l’horreur de l’obscurité absolue régna autour d’eux.
Combien de temps s’écoula-t-il avant que Becky revînt lentement à elle et reconnût qu’elle pleurait dans les bras de Tom ? Ni l’un ni l’autre n’aurait pu le dire. Tout ce qu’ils savaient, c’est qu’après une longue torpeur ils reprenaient conscience de leur situation. Tom dit qu’il devait au moins être lundi et que l’on ne tarderait pas à les rejoindre. Il s’efforça de faire parler Becky ; mais elle était trop abattue et lui répondait à peine. Il répéta que les chercheurs ne pouvaient être loin. Il fallait les mettre sur la voie. Il se mit à crier de toute la force de ses poumons ; mais les échos lointains résonnèrent d’une façon si lugubre dans les ténèbres qu’il ne recommença pas.
Les heures s’écoulaient, et la faim vint de nouveau tourmenter les captifs. Tom divisa un morceau du plum-cake qu’il avait conservé ; mais la part de chacun fut si petite qu’elle ne servit qu’à aiguiser l’appétit.
Au bout de quelque temps Tom s’écria :
— Sh… As-tu entendu ?
Ils retinrent leur haleine et distinguèrent un bruit assez faible qui ressemblait à un appel. Tom répondit aussitôt et, prenant Becky par la main, suivit à tâtons un des murs de la galerie à l’extrémité de laquelle ils se tenaient. Le bruit se fit entendre de nouveau, un peu plus rapproché.
— Ce sont eux, s’écria Tom. En avant, Becky !
La joie des enfants fut immense ; mais ils n’avançaient pas vite, car le sol était inégal et il fallait éviter de tomber dans un trou. Bientôt ils en rencontrèrent un et durent s’arrêter — il pouvait n’avoir que trois pieds de profondeur ou il pouvait en avoir cent. En tout cas, il était impossible de passer. Tom se mit à plat ventre et sonda le terrain avec son bras sans toucher le fond. Il n’y avait d’autre alternative que de s’asseoir et d’attendre les chercheurs. Ils prêtèrent l’oreille. Évidemment les sons lointains s’éloignaient encore davantage. Bientôt ils cessèrent. Tom lança des houp ! houp ! ohé ! jusqu’à ce qu’il se fût égosillé, essaya de ranimer l’espoir de Becky ; mais un siècle d’anxieuse attentes s’écoula sans que le bruit se renouvelât.
Les enfants regagnèrent la source à tâtons et finirent par s’endormir côte à côte. Ils se réveillèrent affamés, plus désespérés que jamais. Tom se rappela que des galeries s’ouvraient un peu plus bas dans le mur contre lequel il s’appuyait. Mieux valait se traîner le long de ces couloirs que de mourir les bras croisés. Il tira de sa poche la ficelle de son cerf-volant, l’attacha à une saillie du mur et l’on se mit en route. Tom marchait en tête, déroulant sa corde à mesure qu’il s’avançait. À une certaine distance le corridor faisait un brusque détour et la main avec laquelle Tom se guidait rencontra le vide. Recommandant à Becky de ne pas bouger, il se baissa, tâta le terrain et tourna le coin. Au moment où il se relevait, à moins de vingt pieds de lui, il vit apparaître de derrière un rocher un bras qui tenait une chandelle. Il poussa un cri d’appel. Aussitôt le corps auquel appartenait le bras se montra. Tom demeura comme paralysé, incapable de faire un pas. C’était Joe l’Indien ! Il se rassura toutefois en voyant son terrible ennemi rebrousser chemin et se perdre dans l’obscurité. Il s’étonna que Joe n’eût pas profité de l’occasion pour tuer son dénonciateur ; mais il pensa que les échos avaient sans doute déguisé sa voix, et il attribua son salut à ce fait. Énervé par la frayeur, il se promit de ne plus risquer de se trouver face à face avec le métis, s’il avait la force de regagner la source. Il eut soin de cacher à Becky le danger qu’il venait de courir et lui dit qu’il avait crié au hasard.
Mais à la longue la faim l’emporta sur la crainte. Une nouvelle halte près de la source et un nouveau sommeil gâté par de mauvais rêves vainquirent sa résolution. Il se réveilla en proie aux tortures de la faim, convaincu qu’il se trouvait dans la grotte depuis au moins huit jours et que l’on avait abandonné les recherches. Il proposa d’explorer la galerie par laquelle avait disparu Joe l’Indien, prêt à braver n’importe quel péril. Mais Becky se sentait très faible. Elle était tombée dans une sorte de torpeur dont Tom ne put la tirer. Elle déclara qu’elle attendrait et qu’elle mourrait là où elle était — ce ne serait pas long. Elle dit à Tom qu’elle tiendrait la ficelle et qu’il pouvait explorer tant qu’il voudrait ; elle le supplia seulement de revenir de temps en temps lui parler. En outre, elle lui fit promettre de rester près d’elle quand le moment fatal arriverait et de lui tenir la main jusqu’à ce que tout fût fini. Tom l’embrassa, lui attacha la ficelle autour du poignet et s’éloigna le cœur serré, après lui avoir dit qu’il était certain cette fois de trouver les chercheurs ou une issue qui les conduirait hors de la grotte. Puis il prit la ficelle, se glissa en rampant le long d’une des galeries. En dépit de son assertion, il avait le sentiment de la faiblesse qui le gagnait et craignait que le moment dont Becky venait de parler ne se fit pas attendre.
Chapitre XXX
PERDUS ET RETROUVÉS
Le mardi matin, la population de Saint-Pétersbourg continuait à se lamenter. Tom et Becky n’avaient pas été retrouvés. Des prières publiques étaient montées au ciel à leur intention ; mais aucune bonne nouvelle n’arrivait de la grotte. La plupart des chercheurs, découragés ou fatigués, étaient retournés à leurs affaires ; ils déclaraient qu’on ne retrouverait jamais les enfants. Mme Thatcher était très malade ; elle délirait par moments. Ses amis disaient que cela fendait le cœur de l’entendre appeler sa fille. Elle se redressait dans son lit, l’oreille tendue, puis laissait retomber sa tête sur son oreiller en gémissant. Quant à tante Polly, ses cheveux gris étaient devenus presque blancs.
Le mardi soir, la petite ville se coucha dans un état de désolation facile à comprendre. Tout le monde aimait ce mauvais garnement de Tom, et Becky était la fille d’un juge. Au milieu de la nuit, les cloches des églises se mirent à sonner un joyeux carillon. En un clin d’œil les rues furent remplies de gens à demi vêtus qui criaient : « Debout ! Levez-vous ! Alleluia ! ils sont retrouvés ! » Des casseroles d’étain et des cornets à bouquin augmentèrent bientôt le vacarme. La foule se massa, se dirigea vers le fleuve, rencontra une voiture découverte traînée par des citoyens qui poussaient des hourras et se mit à la suite du cortège, joignant ses cris de triomphe à ceux de l’attelage.
La ville fut illuminée ; personne ne songeait à se recoucher. Ce fut la nuit la plus joyeuse que Saint-Pétersbourg eût jamais connue. Pendant au moins une heure une procession de visiteurs défila à travers le salon du juge. Chacun embrassa les enfants ; serra la main de Mme Thatcher et de tante Polly, essaya de les féliciter et, à défaut de paroles éloquentes, se contenta de verser une larme sur le parquet.
Si le bonheur de tante Polly était complet, il manquait quelque chose pour combler la joie de Mme Thatcher, car le messager expédié à la grotte n’avait pas encore eu le temps de prévenir le juge.
Tom, étendu sur un canapé, entouré d’un nombreux auditoire, rendit compte de sa merveilleuse aventure en l’embellissant de divers détails que lui fournit son imagination. Voici le résumé de son récit à partir du moment où il avait quitté Becky pour tenter seul sa dernière exploration.
Il suivit deux couloirs aussi loin que le lui permit la longueur de sa corde ; puis il s’engagea dans une troisième galerie. Arrivé au bout de son rouleau, il se disposait à revenir en arrière lorsqu’il vit briller au loin une légère lueur. Il lâcha son fil d’Ariane, se traîna vers le point lumineux, passa la tête et les épaules à travers une petite crevasse et vit étinceler au-dessous de lui les larges flots du Mississippi ! Quelques heures plus tôt, il n’aurait pas aperçu le rayon de jour béni et n’aurait plus exploré ce couloir. Il rejoignit Becky et lui annonça qu’il avait découvert une issue. Elle le supplia de ne pas la tourmenter — elle était trop fatiguée pour marcher ; elle voulait mourir là. Il parvint à la tirer de sa torpeur, à la convaincre et à l’entraîner. Elle faillit en effet mourir — mourir de joie — quand elle eut atteint l’endroit d’où l’on apercevait la lueur. Tom se faufila à travers l’étroite ouverture et aida Becky à le suivre. À peine délivrés, ils s’assirent et pleurèrent. Une embarcation vint à passer ; Tom héla ceux qui la guidaient et raconta sa triste odyssée. Les bateliers refusèrent d’abord de le croire, affirmant qu’ils étaient à cinq milles de la vallée où se trouvait l’entrée de la grotte ; puis ils prirent les enfants à bord et ramèrent jusqu’à la maison la plus proche, où l’on donna à manger aux petits affamés qui ne tardèrent pas à s’endormir. Leur sommeil dura longtemps ; mais ils semblaient si exténués qu’on ne voulut pas les réveiller, de sorte qu’on ne les ramena à Saint-Pétersbourg qu’au milieu de la nuit.

Tom héla les bateliers
Avant l’aube, le juge Thatcher et le petit nombre des chercheurs qui étaient restés avec lui reparurent. On les avait rejoints dans les profondeurs de la grotte à l’aide des cordes qu’ils avaient eu soin de dérouler derrière eux.
Trois jours et trois nuits de fatigue et de faim produisent des effets dont on ne se débarrasse pas tout d’un coup. Nos deux explorateurs ardèrent le lit le mercredi et le jeudi suivants. Le vendredi, Tom se promena un peu, et le lendemain il paraissait aussi bien portant que jamais. Becky ne put quitter la chambre que le dimanche et, lorsqu’elle se montra, on eût dit qu’elle sortait d’une longue maladie.
Tom apprit que Huck avait la fièvre et il alla le voir ; mais il ne fut admis qu’à partir du lundi, avec défense de parler de son aventure ou d’aborder un sujet de conversation de nature à exciter le malade. Du reste, Mme Douglas, qui prenait son rôle au sérieux, veillait à ce que les ordres du médecin ne fussent pas enfreints. Tom, naturellement, connaissait déjà l’incident de Cardiff-House et il savait en outre que le cadavre du complice de Joe l’Indien avait été repêché près de l’embarcadère du bac ; le malheureux s’était sans doute noyé en essayant de s’échapper à la nage.
Quinze jours après, notre héros se mit en route pour rendre une nouvelle visite à Huck, qui, maintenant, était assez fort pour que l’on pût causer avec lui sans craindre de l’agiter, et Tom avait une communication intéressante à faire à son ami. La demeure des Thatcher se trouvait sur son chemin, et il entra dans l’espoir de rencontrer Becky. À son grand ennui, il fut arrêté par le juge, qui se promenait dans le jardin avec deux de ses voisins. Ces derniers se mirent à interroger le visiteur sur sa récente aventure, et l’un d’eux lui demanda d’un ton narquois s’il ne voudrait pas revoir la grotte. Tom répondit très sérieusement qu’il désirait beaucoup la revoir.
— Il y en a d’autres qui ont la même envie, Tom, je n’en doute pas, dit M. Thatcher ; mais j’ai pris mes précautions. Personne ne se perdra désormais dans cette malencontreuse caverne.
— Comment cela ?
— J’ai fait doubler de fer la porte, la serrure est solide et je garde la clef.
Tom devint pâle comme un linge.
— Qu’est-ce qui te prend, Tom ?… Un verre d’eau, vite !
On apporta l’eau, dont on arrosa le visage de Tom, car il était sur le point de se trouver mal.
— Bon, te voilà remis. Un simple étourdissement, n’est-ce pas ?
— Oh ! monsieur Thatcher, Joe l’Indien est dans la grotte !
Chapitre XXXI
LA MORT DE JOE L’INDIEN
La nouvelle se répandit bien vite. Quelques minutes plus tard, une douzaine de canots se dirigeaient vers la grotte. Le petit vapeur, chargé d’un bon nombre de passagers, les suivit bientôt. Tom Sawyer était à bord de l’embarcation qui portait le juge. Lorsqu’on ouvrit la porte de la grotte, un triste spectacle se présenta. Joe l’Indien était étendu sur le sol, mort, le visage tout près de l’endroit où les battants se rejoignaient, comme s’il eût voulu voir jusqu’au dernier moment un faible rayon de jour. Tom se sentit ému, car il savait par expérience combien ce malheureux avait dû souffrir. Il le plaignait ; néanmoins le sentiment de soulagement et de sécurité qu’il éprouva lui révéla quelle épouvante avait pesé sur lui depuis le jour où il avait porté témoignage contre le métis.
Le couteau du mort gisait à côté de lui, la lame brisée. Le bas de la porte avait été déchiqueté. Grâce à un labeur immense, l’infortuné avait même réussi à percer une épaisse barre de bois qui n’était pas revêtue de fer. Labeur inutile ! Le rocher formait en dehors un rebord naturel que le couteau ne pouvait entamer. D’ailleurs, il ne serait jamais parvenu à glisser son corps sous la porte, lors même qu’il eût réussi à enlever la barre du bas. Sans doute il avait seulement haché le bois afin d’occuper sa pensée. En général on voyait dans la cave d’entrée une assez grande quantité de bouts de chandelle laissés par les touristes. Il n’y en avait plus maintenant. Le prisonnier les avait cherchés et les avait mangés. Il avait aussi mis la main sur quelques chauves-souris qu’il avait également dévorées, ne laissant que leurs pattes. L’infortuné était mort de faim. Non loin de la porte, une stalagmite grandissait depuis des siècles, bâtie par la goutte d’eau qui tombait à intervalles égaux d’une stalactite formée au dessus. Le captif avait brisé la pointe de la stalagmite et sur l’écornure il avait creusé une petite cavité destinée à recevoir la précieuse goutte, qui tombait toutes les vingt minutes avec une régularité presque mathématique : une cuillerée en vingt-quatre heures ! Cette goutte tombait à l’époque où les pyramides étaient neuves ; elle tombait quand les Grecs prirent Troie ; quand on posa les fondations de Rome ; quand on crucifia le Christ ; quand Guillaume le Conquérant créa l’empire britannique ; quand Christophe Colomb s’embarqua ; quand le massacre de Lexington était une nouvelle à sensation. Elle tombe toujours. Elle tombera encore quand ces souvenirs historiques se perdront dans la nuit des temps. Tout a-t-il un but et une mission ? Cette goutte est-elle tombée pendant cinq mille ans pour être recueillie par ce misérable captif dont elle a peut-être calmé un instant les souffrances ? Ou bien a-t-elle une autre mission importante à accomplir dans dix siècles d’ici ? Peu importe. Il y a bien des années que le malheureux métis a creusé cette pierre pour recueillir la précieuse goutte ; mais aujourd’hui encore c’est devant la coupe où l’eau tombe avec tant de lenteur que le visiteur s’arrête le plus longtemps lorsqu’on lui montre les merveilles de la grotte de Mac-Dougal. La tasse de Joe l’Indien figure en première ligne sur la liste des curiosités de la caverne.
On ensevelit le métis à l’entrée de la grotte. Une foule de gens vinrent de la ville dans des charrettes ou dans des canots ; il en arriva d’autres de toutes les fermes et de tous les hameaux des environs à sept milles à la ronde. Les badauds amenèrent leurs enfants, apportèrent des provisions et déclarèrent qu’ils s’étaient amusés presque autant que si l’on avait pendu le métis.
L’enterrement mit fin à une de ces niaiseries qui sont trop communes en Amérique, c’est-à-dire à une pétition à l’adresse du gouverneur de l’État, demandant la grâce de Joe l’Indien, qui avait été condamné par contumace. La pétition portait de nombreuses signatures, grâce à des meetings où l’on avait prononcé des discours larmoyants contre la peine de mort. Un comité de femmes fortes se disposait même à se rendre en grand deuil auprès du gouverneur pour le supplier de remplir le rôle d’un âne miséricordieux. Il était démontré que Joe l’Indien avait tué cinq citoyens de Saint-Pétersbourg, sans compter ceux qu’il avait assassinés ailleurs. La belle raison ! S’il eût été Satan en personne, il se serait trouvé des idiots pour verser une larme sur la pétition et pour la signer.
Le lendemain des funérailles, Tom emmena Huck loin de toute oreille indiscrète afin de lui confier un secret important. Huck connaissait déjà l’aventure de la grotte ; mais Tom lui dit qu’il y avait une chose que personne n’avait pu lui apprendre.
— Bah ! je sais ce que c’est, répliqua son ami dont le visage s’allongea. Tu es entré au numéro deux et tu n’y as trouvé que du rhum. Non, personne ne me l’a appris ; je l’ai deviné quand on m’a raconté l’affaire. Si tu avais déniché le trésor tu aurais trouvé le moyen de me prévenir.
— Eh bien, tu barbotes, Huck. Ce n’est pas moi qui ai dénoncé le tavernier. Tu oublies que la maison était encore ouverte le samedi où je suis allé au pique-nique et que tu devais veiller ce soir-là.
— Il me semble qu’il y a au moins un an de ça. C’est cette nuit-là que j’ai suivi Joe l’Indien jusque chez la veuve.
— Tu l’as suivi ?
— Oui, mais motus ! Il peut avoir laissé des amis, et je ne tiens pas à ce qu’ils me jouent quelque mauvais tour. Sans moi, il serait au fond du Texas, au lieu d’être enterré.
Alors Huck raconta à Tom ce que le Gallois n’avait révélé à personne.
— Vois-tu, dit-il en terminant, c’est sans doute le tavernier qui a mis la main sur la caisse. Nous pouvons faire notre deuil du trésor.
— Huck, le trésor n’a jamais été dans la taverne.
— Hein ! Tu as retrouvé la piste ?
— Le trésor est dans la grotte.
— Tu ne plaisantes pas ? Tu en es sûr ?
— Sûr et certain. Veux-tu venir avec moi et m’aider à l’emporter ?

Tu as retrouvé la piste ?
— Tu peux le parier, pourvu que nous ne risquions pas de nous perdre.
— Merci, je n’ai pas envie de recommencer cette histoire-là. Ne crains rien.
— Qu’est-ce qui te fait croire que le trésor est dans la grotte ?
— Attends un peu ; lorsque nous y serons, tu verras. Si nous ne le trouvons pas, je consens à te donner mon tambour et tout ce que j’ai au monde.
— Quand irons-nous ? demanda Huck.
— Aujourd’hui, si le cœur t’en dit. Te sens-tu assez fort ?
— Est-ce bien loin dans la cave ? Voilà trois ou quatre jours que je suis sur mes quilles ; mais je ne pourrais pas faire plus d’un mille — du moins, je ne crois pas.
— L’endroit est à cinq milles environ de l’entrée de la grotte par la route que tout le monde suivrait ; mais il y a un chemin beaucoup plus court, que moi seul connais, Huck. Je t’y conduirai dans un canot, et tu n’auras pas à ramer.
— Bon ! Partons, Tom.
— Pas encore, pas encore ! Il nous faudra de quoi manger, un petit sac ou deux, de la ficelle, des chandelles et quelques-unes de ces machines qu’on appelle des allumettes. Je te réponds que j’aurais bien voulu en avoir un petit paquet la dernière fois que j’étais là-bas.
Un peu avant midi, les deux amis empruntèrent le canot d’un citoyen qui se trouvait absent et poussèrent aussitôt au large. Arrivé à plusieurs milles au-dessous de l’ouverture de la grotte, Tom dit :
— Nous allons descendre. Tu vois que cette partie de la rive ressemble au reste de la colline depuis l’entrée de la cave — pas de maisons, pas de fermes, rien que des buissons. Mais regarde là-haut, la place blanche où il y a eu un éboulement. Eh bien, c’est une de mes marques. Maintenant, continua-t-il lorsqu’ils eurent mis pied à terre, tu pourrais toucher d’ici avec une canne à pêche le trou par lequel nous allons entrer sans avoir besoin de clef. Ouvre l’œil et cherche.
Huck ouvrit l’œil sans rien découvrir. Tom s’engagea dans un buisson, s’avança fièrement et s’arrêta en face de la crevasse par laquelle il s’était échappé.
— Admire-moi ça, Huck, dit-il alors. Voilà un vrai repaire, hein ? J’ai toujours voulu être chef de brigands ; mais je savais qu’un chef de brigands a besoin d’un repaire introuvable. Le difficile, c’était de découvrir une bonne cachette. À présent, nous avons notre repaire, et nous n’en dirons rien à personne, excepté à Joe Harper, à Ben Rogers et à deux ou trois autres, parce qu’il faut une bande. Un chef de voleurs sans bande ne compte pas. La bande de Tom Sawyer, ça sonne bien.
— Oui, Tom ; mais qui volerons-nous ?
— Les gens qui passent ; c’est comme cela que l’on fait dans les livres.
— Et nous les tuerons ?
— Non. Nous les enfermerons dans la caverne jusqu’à ce que leurs amis payent une rançon.
— Une rançon ? Qu’est-ce que c’est ?
— De l’argent. On les oblige à écrire à leurs amis pour demander une certaine somme. Ensuite on les garde pendant trois mois et alors, si l’argent n’est pas déposé au pied d’un arbre, on les tue. Seulement on ne tue jamais les femmes. On prend leurs montres et leurs affaires, mais on les salue et on leur parle poliment. Il n’y a personne d’aussi poli que les voleurs. C’est pour cela que les femmes aiment les brigands, et lorsqu’elles sont restées dans la cave pendant une semaine ou deux, elles ne pleurent plus, et après ça elles ne veulent plus s’en aller. Si on les mettait il la porte, elles reviendraient. On voit ces choses dans toutes les histoires.

Passe-moi les provisions
Je crois que ça vaut mieux que d’être pirate, parce qu’on est près d’une ville et qu’on peut aller au cirque ou au théâtre… Maintenant, je vais entrer, tu me passeras les provisions et je t’aiderai à me suivre.
Une fois entrés, ils allumèrent leurs chandelles, gagnèrent l’extrémité du tunnel souterrain et fixèrent leur corde. Quelques pas de plus les amenèrent à la source, et Tom sentit un frisson parcourir ses membres. Il montra à Huck le fragment de mèche qui avait charbonné contre le mur et lui raconta comment Becky avait sangloté en voyant la flamme s’éteindre.
Nos explorateurs parlaient à voix basse, car la grotte leur semblait bien sombre. Enfin ils longèrent la galerie au bout de laquelle Tom avait entrevu Joe l’Indien.
— À présent, je vais te montrer quelque chose, dit Tom. Vois-tu une marque tracée avec la fumée d’une chandelle sur ce rocher ?
— Tom, c’est une croix !
— Eh bien, cela prouve que nous sommes au vrai numéro deux. Sous la croix, tu te rappelles, hein ? C’est à deux pieds de ce rocher que j’ai vu arriver Joe l’Indien.
Huck contempla un instant le signe mystique, puis il s’écria d’une voix tremblante :
— Tom, allons-nous-en !
— Nous en aller et abandonner le trésor ?
— Oui. Le fantôme de Joe l’Indien rôde par ici, pour sûr.
— Allons donc, Huck ! S’il rôde quelque part, c’est à l’endroit où il est mort — bien loin de la place où nous sommes.
— Pas du tout. Il doit errer autour de l’argent. Tu connais aussi bien que moi les habitudes des revenants.
Tom commença à craindre que son ami n’eût raison, et il ne se sentit pas rassuré ; mais bientôt ses appréhensions se calmèrent.
— Nous sommes bien bêtes de nous effrayer. Le fantôme de Joe l’Indien ne se montrera jamais près d’un endroit où il y a une croix.
— C’est juste, dit Huck, convaincu par ce raisonnement.
Le grand rocher se dressait à l’entrée d’une salle peu spacieuse et humide où quatre couloirs aboutissaient. Dans un de ces passages, le plus rapproché de la base du rocher, on découvrit un renfoncement naturel qui contenait plusieurs couvertures, une vieille bretelle et des os rongés ; mais nos chercheurs eurent beau fouiller, le trésor n’était pas là.
— Il a dit sous la croix’, s’écria Tom. Eh bien, il me semble que nous sommes aussi près que possible du but. Pour cacher quelque chose sous le rocher, il aurait fallu le soulever, ce qui n’eût pas été facile !
Ils continuèrent en vain leurs fouilles et s’assirent découragés. Huck paraissait de mauvaise humeur. Tom réfléchissait.
— Il me vient une idée, dit-il enfin. J’ai remarqué des traces de pas et des gouttes de suif par terre d’un côté du rocher ; elles n’y sont pas pour rien : creusons sous la pierre et sous la croix.
Le couteau de Tom fut bientôt à l’œuvre à l’endroit qu’il indiquait. La lame n’était pas arrivée à six pouces de la surface du sol qu’elle frappait sur du bois.
— La boîte ! s’écria Huck, qui se mit à aider son compagnon en enlevant la terre avec ses mains.
Hélas ! ce n’était pas la boîte ; on ne découvrit que des planches ; mais on reconnut qu’elles servaient à dissimuler l’entrée d’une petite galerie souterraine qui conduisait sous le rocher. Tom avança sa chandelle tant qu’il put et déclara qu’il ne voyait que du noir. Après s’être glissé par l’étroite ouverture, il n’eut plus besoin de ramper. Il se redressa et suivit les détours du couloir, d’abord à droite, ensuite à gauche, Huck marchant sur ses talons. Enfin une dernière courbe le mena au bout de la galerie, et il s’arrêta court.
— Bonté divine, Huck, voilà notre trésor !
La fameuse caisse reposait dans une petite caverne bien sèche, à côté d’un barillet vide qui avait contenu de la poudre, de deux fusils, d’une paire de mocassins, d’une ceinture de cuir et de divers autres objets sans valeur.
— Nous le tenons enfin ! s’écria Huck, faisant ruisseler les pièces d’or entre ses doigts.
— Huck, j’ai toujours compté que nous mettrions la main dessus, mais j’ose à peine y croire ! Ne perdons pas notre temps. Laisse-moi voir si je pourrais déménager la caisse.
Il réussit à la soulever, mais il n’aurait pas pu la porter loin.
— C’est la boîte qui pèse le plus, dit-il. Ils avaient l’air de la trouver lourde le jour où ils nous ont fait si peur. J’ai eu bon nez d’apporter des sacs.
Ils mirent l’or dans les sacs, qu’ils portèrent hors du souterrain.
— Maintenant, allons chercher les fusils, dit Huck.
— Non, répliqua Tom. Nous n’en avons pas encore besoin ; ils nous serviront pour effrayer le monde quand nous nous mettrons voleurs. Laissons-les dans cette petite caverne, qui me paraît très commode. C’est là que nous nous livrerons à nos orgies, comme on dit dans les histoires de voleurs.
— Qu’est-ce que c’est que des orgies ?
— Je ne sais pas au juste… une espèce de fête. Ben Rogers nous l’apprendra. Il a lu les aventures de Jack Sheppard. Les voleurs se livrent toujours à des orgies lorsqu’ils viennent de faire un bon coup. Allons, en route ! J’ai faim, mais nous mangerons dans le bachot.
Une heure plus tard, ils étaient installés dans le canot. Leur appétit satisfait, ils se mirent à fumer, car ils ne voulaient regagner la ville que lorsque le jour commencerait à baisser. Enfin Tom prit les rames et longea la côte, causant gaiement avec Huck. Il faisait déjà presque nuit lorsqu’ils débarquèrent. Dès qu’il eut mis pied à terre, Tom dit à son compagnon :
— Je suis descendu ici, parce que c’est le chemin le plus court pour arriver à Cardiff-House. Nous allons cacher le trésor dans le bûcher de la veuve. Nous reviendrons demain matin ; nous compterons et nous partagerons, puis nous chercherons un bon endroit pour l’enterrer dans la forêt. Attends-moi et surveille le canot, tandis que je cours emprunter la charrette de Ben Taylor. Il ne faut pas que l’on devine tout de suite que nous rapportons un trésor. Je serai de retour en un clin d’œil.
Il s’éloigna et reparut bientôt avec la charrette, à laquelle il s’attela après y avoir placé les deux sacs qu’il recouvrit de quelques vieux chiffons restés au fond de la voiture. Ils n’avaient pas beaucoup de chemin à faire pour gagner la demeure de Mme Douglas ; mais Cardiff-House dominait une colline qu’il fallait gravir, de sorte que notre héros dut s’arrêter plus d’une fois afin de se reposer. Enfin on arriva au bûcher, espèce de hangar qui se trouvait près de l’habitation.
— Ouf ! dit Tom après avoir poussé la charrette derrière un tas de fagots, nous la laisserons là jusqu’à demain matin. Je suis trop fatigué pour la ramener ce soir. D’ailleurs, il y a des lumières à toutes les croisées de la maison. Mme Douglas donne à souper, et le bruit des roues pourrait attirer l’attention des domestiques.
Au moment où les deux gamins sortaient du hangar, ils furent arrêtés par le Gallois, qui se dirigeait vers la maison.
— Qui va là ? demanda le fermier.
— Huck et Tom Sawyer.
— Voilà qui est heureux. Il y a deux heures que je vous cherche. Venez avec moi, garçons. On vous attend chez la veuve.
Tom, intrigué, voulut savoir pourquoi on les attendait.
— Vous le saurez quand nous serons chez la veuve Douglas, répondit le vieillard, qui saisit les deux enfants par le collet.
— Monsieur Jones, je n’ai rien fait, dit Huck non sans une certaine appréhension, car il était habitué à se voir injustement accusé d’une foule de méfaits.
Le Gallois se mit à rire.
— Je n’en répondrai pas, Huck, je n’en répondrai pas, dit-il. Est-ce que la veuve et toi n’êtes pas bons amis ?
— Elle a été joliment bonne pour moi, en tout cas. Elle m’a soigné quand j’avais la fièvre.
— Eh bien, pourquoi aurais-tu peur ?
Huck cherchait encore une réponse à cette question quand il se vit poussé, en compagnie de Tom, dans le salon de Mme Douglas.
Le salon était brillamment éclairé, et tous les gens bien posés de la ville s’y trouvaient réunis : les Thatcher, les Harper, les Rogers, tante Polly, Sid, Marie, le pasteur, le rédacteur du journal de la localité, et bien d’autres. La veuve accueillit les nouveaux venus aussi cordialement que l’on peut accueillir des personnages d’une mise aussi peu soignée. Les deux visiteurs involontaires avaient les vêtements couverts de boue et de suif. Tante Polly rougit d’humiliation, fronça les sourcils et lança à Tom des regards courroucés.

Je vous amène ces messieurs
— J’avais promis de vous amener ces messieurs, madame Douglas, dit le Gallois ; mais Tom n’était pas encore rentré, et Huck demeurait introuvable. Par bonheur, je les ai rencontrés juste devant votre porte et je les ai obligés à m’accompagner.
— Et vous avez bien fait, répliqua la veuve. Venez avec moi, mes enfants.
Elle les emmena dans une chambre à coucher et leur dit en riant :
— Je devinais bien que Huck ne serait guère présentable, Tom ; mais tu es dans le même cas. Heureusement, le cas paraît avoir été prévu. Débarbouillez-vous et habillez-vous. Il y a là deux habillements complets — chemises, bas, tout ce qu’il faut. Cela appartient à Huck — non, pas de remerciements. M. Jones en a acheté la moitié. Vous êtes à peu près de la même taille, et ces vêtements vous iront à l’un et à l’autre. Habillez-vous et descendez dès que vous serez prêts ; on ne soupera pas sans vous.
Chapitre XXXII
LA SURPRISE
— Tom, dit Huck, dès que son hôtesse eut disparu, il sera facile de filer, si nous trouvons une corde. La fenêtre n’est pas haute.
— Filer, allons donc ! Pourquoi veux-tu filer ? Tu vas voir comme on soupe chez Mme Douglas.
— M’asseoir avec ce tas de gens-là ? Je n’oserai jamais ; je ne descendrai pas.
— Bêta ! Ce n’est rien du tout. Tu seras aussi bien habillé qu’eux. Je n’y fais pas attention, moi. Nous nous mettrons à côté l’un de l’autre, et j’aurai soin de toi, n’aie pas peur.
À ce moment Sid se montra.
— Tom, dit-il, j’ai couru après toi tout l’après-midi, et personne ne savait où tu étais. Marie a préparé tes habits des dimanches… Tiens, il a plu des gouttes de suif sur ton pantalon ; tu es donc allé…
— Sid, mêle-toi de tes affaires, ou gare à toi. Apprends-nous plutôt pourquoi il y a un grand tra-la-la ici ce soir.
— Oh ! la veuve aime à jeter son argent par les fenêtres, et elle a du monde trois ou quatre jours par semaine. Cette fois, c’est pour le Gallois et ses fils qui l’ont défendue contre les voleurs… Je pourrais aussi te dire pourquoi elle tenait tant à avoir Huck.
— Eh bien, dis.
— Eh bien, le Gallois va essayer de surprendre les gens à la fin du souper. Je lui ai entendu raconter ça à tante Polly, en la priant de garder le secret, et j’ai idée que ce n’est plus un secret maintenant. La mèch est éventée. La veuve fera semblant de s’étonner ; mais elle sait aussi à quoi s’en tenir. Le Gallois a cherché Huck partout pour l’amener. La grande surprise aurait raté si Huck n’avait pas été là.
— Quelle surprise ?
— Le Gallois doit raconter comment Huck a suivi les voleurs qui en voulaient à la veuve. Je te parie que son effet sera raté.

Va te plaindre à tante Polly !
Sid ricana avec un air de jubilation qui montrait qu’il était très satisfait de lui-même.
— Sid, est-ce toi qui a gâté la surprise ? demanda Tom d’un ton indigné.
— Quelqu’un l’a gâtée, voilà tout.
— Sid, il n’y a qu’un individu dans la ville assez pleutre pour agir ainsi, et cet individu c’est toi. À la place de Huck, tu aurais pris tes jambes à ton cou et tu n’aurais pas osé dénoncer les voleurs. Tu es un méprisable envieux, et cela t’agace d’entendre louer ceux qui valent mieux que toi… Tiens, prends ça et ça… Pas de remerciements, comme dit la veuve.
Tom appliqua deux bons soufflets sur les joues de Sid et l’aida à regagner la porte en lui administrant plusieurs coups de pied.
— Va te plaindre à tante Polly, si tu l’oses, ajouta-t-il, et demain tu auras de mes nouvelles.
Quelques minutes plus tard, il avait réussi à entraîner Huck, et les invités de la veuve se trouvaient attablés. Au dessert, le Gallois prononça un petit discours où il remercia Mme Douglas de l’honneur qu’elle lui faisait, à lui et à ses fils, mais déclara qu’il y avait une quatrième personne dont la modestie, etc., etc.
Bref, il lâcha son secret et raconta de la façon la plus dramatique qu’il put le rôle que Huck avait rempli ; mais la surprise que l’on exprima ne fut pas aussi bruyante qu’elle l’eût été sans l’indiscrétion de Sid. Néanmoins la veuve joua assez bien l’étonnement. Elle combla Huck de tant d’éloges, de tant de témoignages de gratitude que le pauvre garçon oublia la gêne intolérable que lui causaient ses vêtements neufs pour ne songer qu’à la gêne plus intolérable encore qu’il éprouvait en se voyant le point de mire de tous les regards.
La veuve dit qu’elle comptait offrir à Huck un asile sous son toit et le mettre à même de gagner sa vie. Alors Tom jugea l’occasion bonne pour rendre aux auditeurs la surprise dont on les avait frustrés.
— Huck n’a besoin de rien, dit-il ; Huck est riche.
Le sentiment des convenances empêcha seul les invités de répondre par des éclats de rire à cette plaisanterie. Mais le silence qu’ils gardèrent ensuite était un peu embarrassant ; ce fut Tom qui se chargea de le rompre.
— Huck a de l’argent, continua-t-il. Vous ne me croyez peut-être pas ; mais il a un tas d’argent. Oh ! vous pouvez sourire tant qu’il vous plaira, je ne plaisante pas. Attendez une minute.
Tom courut vers la porte. Les invités se regardèrent d’un air perplexe et adressèrent des regards interrogateurs à Huck, qui semblait frappé de mutisme.
— Sid, qu’a donc Tom ? demanda tante Polly. Décidément, il n’y a pas moyen de comprendre ce garçon-là. Je n’ai jamais…
Tom rentra, ployant un peu sous le poids de ses sacs, et tante Polly n’acheva pas sa phrase. Tom versa la masse d’or sur la table et s’écria :
— Là, me croyez-vous, maintenant ? Une moitié est à Huck, l’autre moitié est à moi !
Tout le monde demeura bouche béante, contemplant le trésor ; puis les demandes d’explications se mirent à pleuvoir. Tom ne se fit pas prier. Son récit, bien que long, fut palpitant d’intérêt, et personne ne l’interrompit. Lorsqu’il eut terminé, M. Jones dit :
— Je croyais avoir ménagé une petite surprise à la présente réunion ; mais je ne garde nullement rancune à maître Tom Sawyer qui m’a coupé l’herbe sous le pied.
On compta l’argent. Les sacs contenaient un peu plus de douze mille dollars. Aucun des assistants n’avait eu sous les yeux une aussi forte somme, bien que plusieurs d’entre eux possédassent en biens fonds une fortune beaucoup plus considérable.
Chapitre XXXIII
MISÈRES DE HUCK LE RENTIER
Le lecteur devinera sans peine que la trouvaille de Tom et de Huck causa une vive sensation dans la petite ville de Saint-Pétersbourg. Douze mille dollars ! C’était presque incroyable. Ce prodigieux coup de filet troubla bien des cervelles. Toutes les maisons abandonnées de Saint-Pétersbourg et des villages voisins furent disséquées planche par planche. Les fondations furent creusées et fouillées par des chercheurs de trésor, non par des enfants, mais par des hommes d’âge, dont quelques-uns passaient pour des gens sérieux et très peu romanesques. Partout où Tom et Huck se montraient, on les fêtait et on les admirait. Les deux enfants ne se rappelaient pas que leurs observations eussent jamais attiré la moindre attention avant la découverte du trésor ; mais maintenant on répétait, on commentait leurs paroles. Il semblait qu’ils fussent tout à coup devenus incapables de dire ou de faire des choses triviales. Ils étaient des personnages si remarquables que le journal de la localité publia leur biographie.
La veuve Douglas plaça l’argent de Huck à six pour cent, et, à la requête de tante Polly, le juge Thatcher en fit autant avec la part de Tom. Chacun d’eux se trouva ainsi posséder un revenu qui était tout simplement inouï, près d’un dollar par jour. C’est ce que touchait le pasteur ; non, c’est ce qu’on lui promettait, car beaucoup de fidèles oubliaient de payer leur quote-part. Un dollar et quart par semaine suffisait en cet heureux temps pour l’entretien et l’instruction d’un écolier.
Le juge Thatcher avait conçu une haute opinion de Tom. Il affirmait qu’un enfant ordinaire ne serait jamais parvenu à tirer Becky de la grotte. Lorsque sa fille lui raconta, sous le sceau du secret, comment Tom s’était fait punir pour elle et se reprocha d’avoir été complice d’un gros mensonge, le juge affirma, dans un bel accès d’éloquence, que c’était là un noble, un généreux, un magnanime mensonge, digne d’être enregistré dans les fastes de l’histoire. Becky trouva que son père n’avait jamais paru aussi grand, aussi superbe que le jour où il arpenta le salon et frappa du pied en émettant cette opinion. Le lendemain même, elle communiqua l’opinion paternelle à son sauveur, qui se montra très fier d’être ainsi apprécié.
Le juge Thatcher annonça à tante Polly qu’il espérait que Tom serait un jour ou l’autre un grand soldat ou un grand avocat. Il ajouta qu’il dirigerait les études de son protégé de façon qu’il fût reçu à l’Académie militaire de Westpoint et qu’il suivît ensuite les cours de la meilleure école de droit du pays, ce qui le mettrait à même de choisir entre les deux carrières.
La richesse de Huck et le fait qu’il était patronné par Mme Douglas le firent admettre dans la bonne société de Saint-Pétersbourg — ou plutôt l’y lancèrent malgré lui — et la légère dose de patience qu’il possédait fut soumise à une dure épreuve. Les domestiques de la veuve veillaient à ce qu’il fût convenablement débarbouillé, peigné et brossé. Le bon lit où il dormait chaque soir lui semblait une prison. Il lui fallait se mettre à table pour manger dans une assiette, avec un couteau et une fourchette, s’essuyer la bouche avec une serviette, aller tous les dimanches à l’église. Il lui fallait tenir un langage si convenable que les paroles qui lui sortaient de la bouche lui paraissaient avoir un goût fade. De quelque côté qu’il se tournât, les mailles de la civilisation l’enserraient.
Pendant trois semaines, il rongea bravement son frein, puis il disparut. Au bout de quarante-huit heures de vaines recherches, la veuve commença à se désespérer. Toute la ville fut bientôt en émoi. Le matin du troisième jour, Tom eut la bonne idée de fureter derrière le vieil abattoir, dans un endroit où il y avait des boucauts vides, et il découvrit le fugitif. Notre Diogène avait dormi dans son tonneau ; il venait de déjeuner de quelques bribes dérobées çà et là, et il savourait sa pipe à l’ombre d’un marronnier. Les cheveux plus ébouriffés que jamais, il portait les guenilles qui lui donnaient un aspect pittoresque à l’époque où il se trouvait libre et heureux. Tom lui adressa une verte semonce, lui reprocha les tracas qu’il avait causés et l’engagea à retourner chez Mme Douglas. Le visage de Huck perdit aussitôt son expression de béatitude.

Huck le rentier
— Ne me parle pas de retourner là-bas, Tom. J’ai essayé, et j’en ai assez. C’est tannant ! La veuve est très bonne pour moi ; mais je ne me ferai jamais à ces manigances. On me réveille tous les matins à la même heure. Il faut se laver tous les matins, et avec du savon encore ! On me peigne tous les matins à me rendre aussi chauve que M. Dobbins. La veuve m’empêche de dormir dans le bûcher. Elle veut que je porte ces satanés habits qui m’étouffent. Des habits si diantrement neufs qu’ils ne laissent pas entrer l’air et que je n’ose pas rouler par terre avec ; je n’ai pas glissé le long d’une berge depuis… depuis des années, on dirait. Il faut que je reste enfermé tous les dimanches dans l’église où je bâille comme quatre ; on crierait après moi si j’attrapais seulement une mouche ! Il faut que je garde mes souliers du matin au soir. La veuve mange à la cloche ; elle se couche à la cloche ; elle se lève à la cloche, et l’on recommence chaque jour. Non, c’est à n’y pas tenir !

Je ne veux pas être riche !
— Mais tout le monde fait comme ça, Huck.
— Possible, Tom ; mais je ne suis pas tout le monde, et je n’y tiens plus. Toujours la bride au cou ! Quand j’ai envie d’aller pêcher ou d’aller me baigner, il faut que je demande permission. Et puis la mangeaille vient si facilement qu’il n’y a plus de plaisir à se refaire le torse. La veuve me défend de crier ou de jurer, ou de bâiller ou de me gratter devant le monde. Par-dessus le marché, cette satanée école va ouvrir, et l’on veut m’y faire aller. Il ne manquait que ça ! Tu vois que je n’avais plus qu’à filer.
— Quand on est riche, il faut bien savoir lire et écrire, autrement tout le monde te volerait.
— Tom, ce n’est pas aussi amusant qu’on le dit d’être riche. Ce n’est qu’embêtement sur embêtement. Mes habits me conviennent, mon tonneau me convient, et je ne les lâche pas. Sans cet argent, on me laisserait tranquille. Eh bien, prends ma part avec la tienne. Tu me donneras une pièce de dix cents de temps en temps, pas trop souvent, de façon que je ne compte pas dessus. Arrange la chose avec la veuve et prie-la de me planter là.
— Non, Huck ; je ne peux pas faire ça. Ce n’est pas juste, et d’ailleurs si tu essayes un peu plus longtemps, tu t’y habitueras.
— M’y habituer ? Oui, comme je m’habituerais à rester assis sur un poêle rouge. Je ne veux pas être riche et je ne veux pas moisir dans une maison. J’aime les bois et la rivière, et les tonneaux. Que le diable emporte le trésor ! Faut qu’il arrive juste au moment où nous avions des fusils et une caverne de voleurs !
Tom saisit la balle au bond.
— Tu te trompes joliment, dit-il, si tu crois que parce que je suis riche ça m’empêchera d’avoir une bande.
— Bien vrai ?
— Aussi vrai que je suis ici ; mais tu comprends que nous ne pourrons pas t’admettre dans la bande si tu n’es pas habillé proprement.
La joie qui avait éclairé le visage de Huck se dissipa aussitôt.
— Tu as bien voulu de moi pour pirate, répliqua-t-il.
— Ce n’est pas la même chose. Les voleurs sont plus comme il faut que les pirates, en général
— Voyons, Tom, tu as toujours été mon ami ; tu ne vas pas me lâcher, hein ?
— Je suis toujours ton ami, et je voudrais t’avoir dans ma bande ; mais que dirait le monde ? On dirait : « La bande de Tom Sawyer ? Hum ! il y a des pas grand’choses dans sa bande. » C’est à cause de toi qu’on me débinerait ; tu n’aimerais pas ça, ni moi non plus.
Huck demeura un moment silencieux.
— Eh bien, dit-il enfin, je retournerai chez la veuve pour un mois, et je tâcherai de m’y habituer, si tu me laisses entrer dans ta bande.
— Convenu, Huck ! Arrive, mon vieux, et je demanderai à la veuve de ne pas tant te rembarrer pour commencer.
— Bon ! Si elle me lâche un peu la bride, je me rebifferai moins. Qui aurons-nous dans la bande ?
— Nous verrons. Quand j’aurai choisi mes lieutenants, nous aurons une initiation.
— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— C’est un meeting où l’on jure de se défendre les uns les autres et de ne jamais révéler les secrets de la bande, lors même qu’on vous couperait en mille morceaux, et de brûler la cervelle aux traîtres. Moi, je serai le chef, mais les autres passeront tous lieutenants à tour de rôle.
— Cela vaut mille fois mieux que d’être pirate, s’écria Huck.
CONCLUSION
Ainsi finit cette chronique. Comme je n’ai voulu raconter que l’histoire d’un écolier, il me serait difficile d’aller plus loin sans risquer de sortir du cadre que je me suis tracé. Quand on compose un roman dont les héros sont arrivés à l’âge de raison, le romancier sait où s’arrêter, c’est-à-dire à un mariage ; mais lorsqu’il s’agit d’enfants, on s’arrête où l’on peut.
La plupart des personnages qui figurent dans ce récit vivent encore. Il se peut que je sois tenté un jour ou l’autre de reprendre l’histoire des plus jeunes d’entre eux et de montrer ce qu’ils sont devenus en vieillissant. Le plus sage est de m’abstenir, pour le moment, de fournir aucun renseignement sur cette partie de leur existence.
FIN